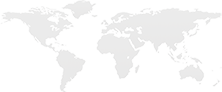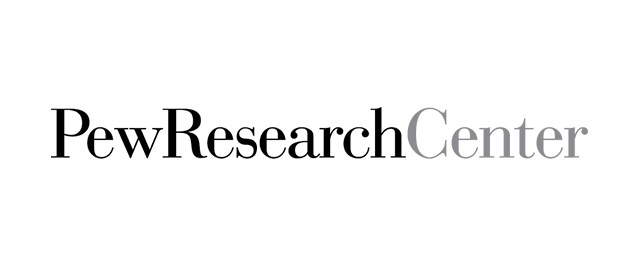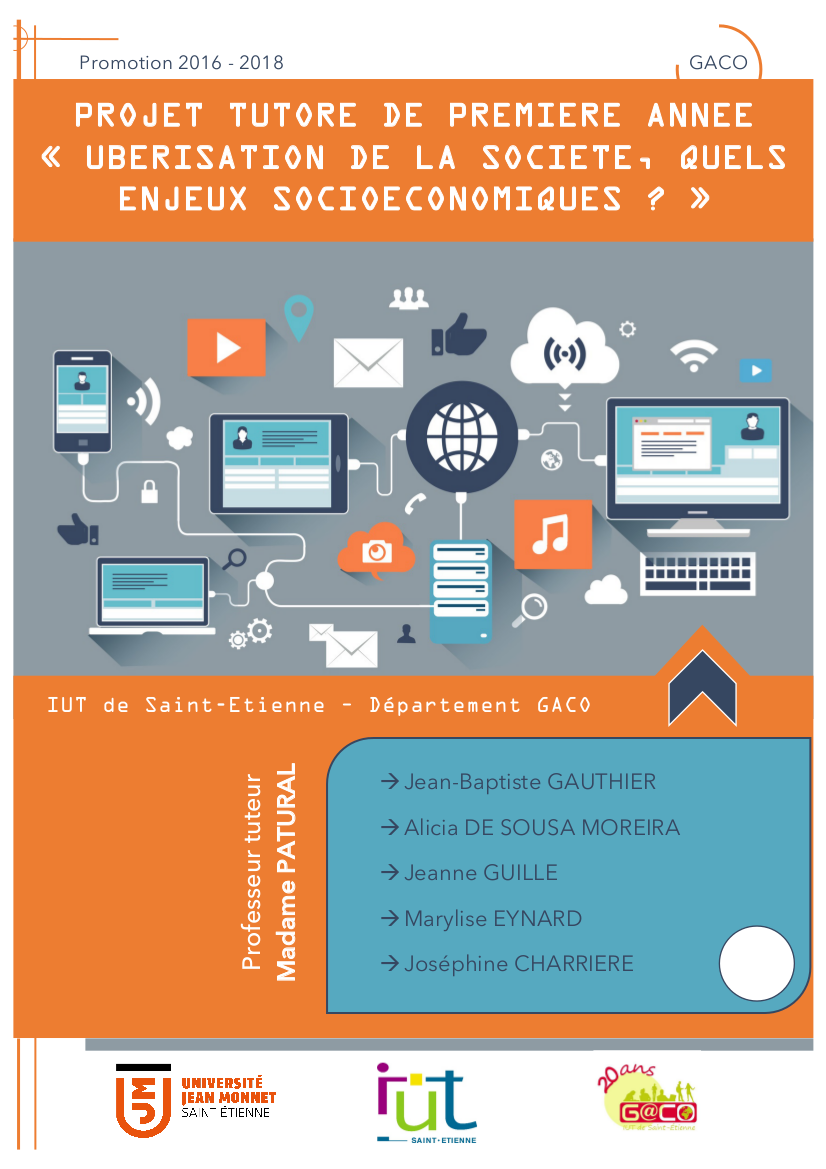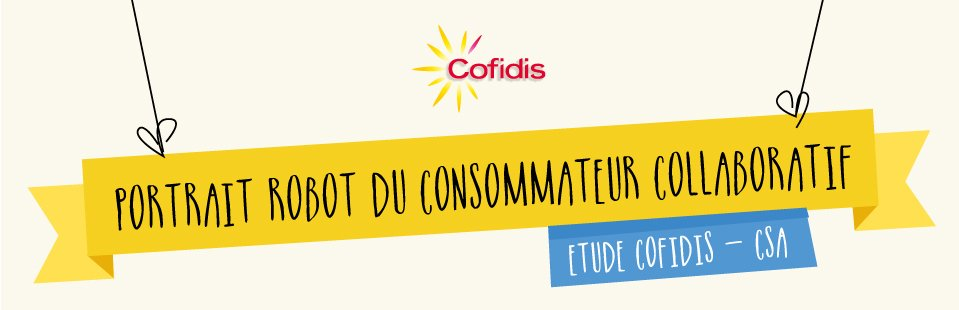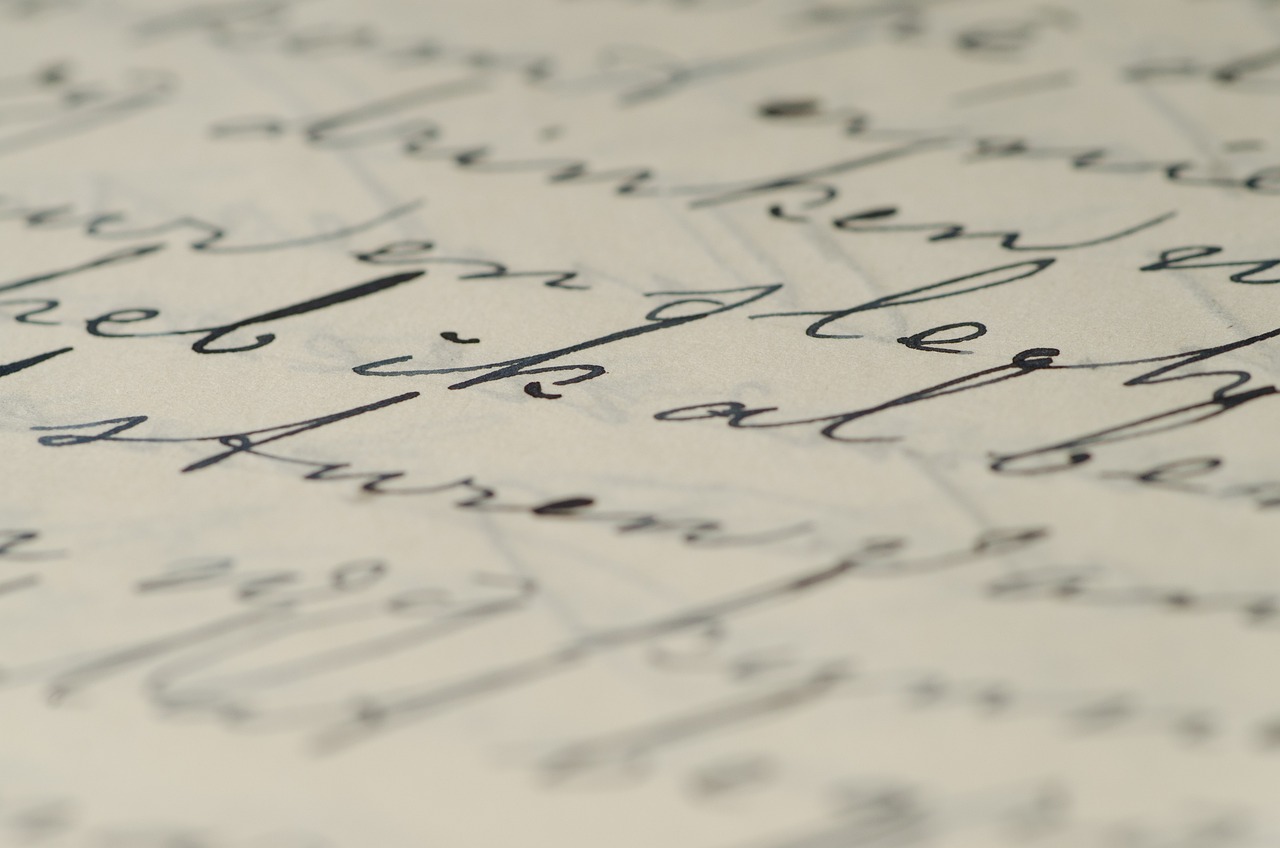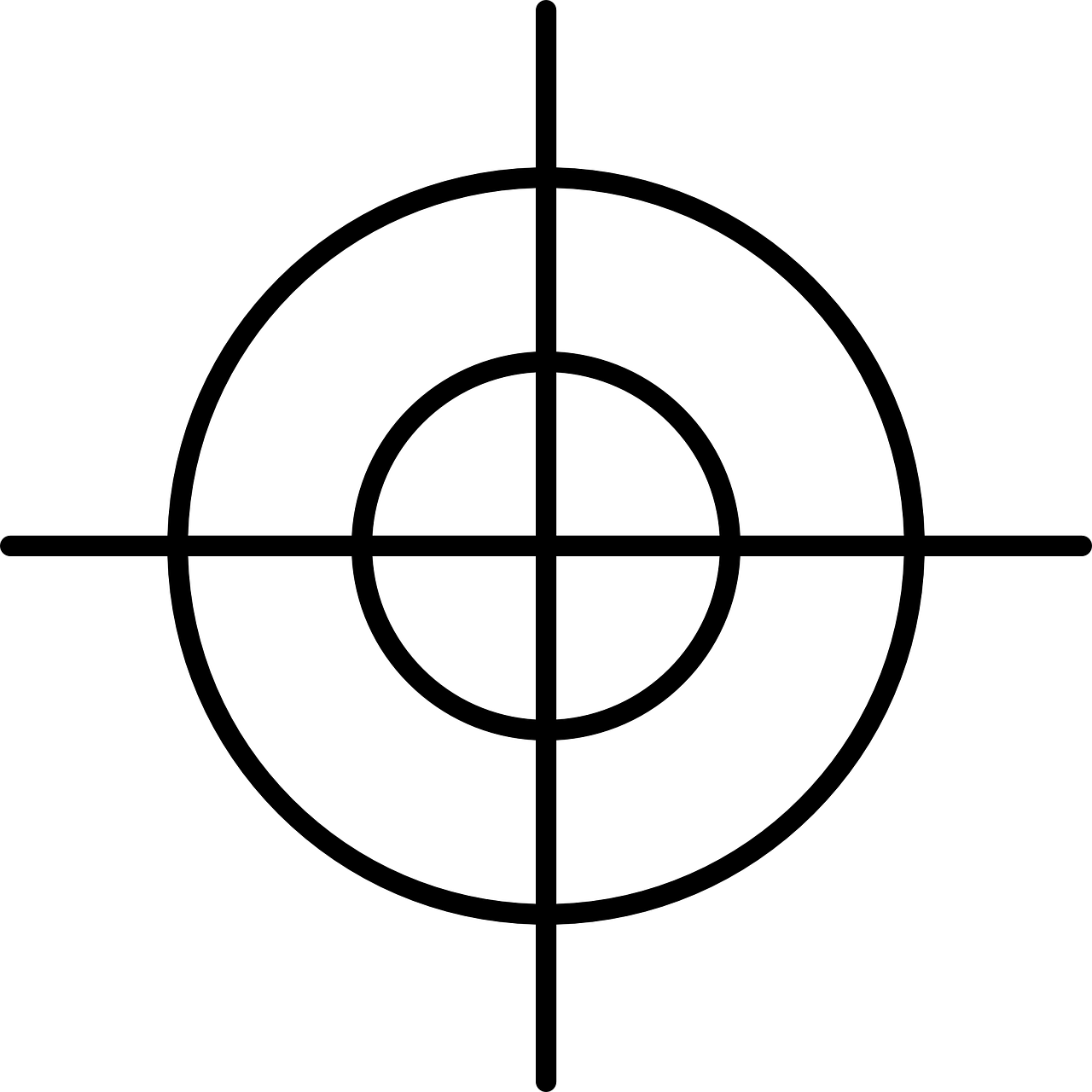Description
"L’UE devrait avoir pour objectif de récolter les bénéfices de l’économie "collaborative" tout en garantissant le respect d’une concurrence équitable, des droits du travail et des obligations fiscales."
Résoudre les "zones grises" de l'économie collaborative
Dans une résolution non contraignante adoptée mercredi 03/05/2017, les députés ont souligné la nécessité de résoudre les "zones grises" sur le plan réglementaire, qui provoquent des différences significatives entre États membres en raison des réglementations et jurisprudences nationales et locales. Ces nouveaux modèles d’entreprises vont des services de fourniture d’hébergement (par exemple Airbnb) aux trajets en voiture (comme Uber), en passant par les services domestiques.
Parmi les recommandations des députés figurent notamment les points suivants:
- Fournisseurs particuliers vs professionnels: des critères effectifs pour distinguer les "pairs" (soit les citoyens qui fournissent des services de façon occasionnelle) des "professionnels" sont nécessaires, incluant des principes généraux au niveau européen et des seuils au niveau national (basés par exemple sur les revenus);
- Droits des consommateurs: des informations doivent être fournies aux consommateurs quant aux règles applicables à chaque transaction et à leurs droits; les plateformes collaboratives devraient mettre en place des systèmes pour introduire les plaintes et résoudre les litiges;
- Responsabilité: la Commission européenne devrait rapidement clarifier la responsabilité des plateformes collaboratives;
- Droits des travailleurs: des conditions de travail équitables et une protection adéquate pour tous les travailleurs de l’économie collaborative devraient être garanties; les travailleurs devraient également pouvoir transférer et accumuler les notations et évaluations électroniques des utilisateurs - qui représentent leur "valeur marchande numérique";
- Fiscalité: des obligations fiscales similaires devraient être appliquées aux entreprises qui fournissent des services comparables, que ce soit au sein de l’économie traditionnelle ou de l’économie collaborative; les députés plaident pour des solutions innovantes afin de renforcer le respect des obligations fiscales et appellent les plateformes à collaborer en ce sens.
Néanmoins, le règlement ne devrait pas limiter l’économie collaborative, affirment les députés, condamnant en particulier les règlementations imposées par certaines autorités nationales "qui cherchent à restreindre l’offre d’hébergement touristique mis à disposition".
Le rapporteur de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, Nicola Danti(S&D, IT), a déclaré
L’économie collaborative est un nouveau phénomène qui est source tant de nouvelles opportunités que de multiples défis. Nous avons, par conséquent, besoin d’une stratégie européenne pour ouvrir la voie à un ‘écosystème’ harmonisé et dynamique, composé de règles spécifiques et de principes généraux. Notre priorité devrait être de garantir une concurrence équitable entre les secteurs économiques traditionnels et le nouveau monde de l’économie collaborative, afin d’assurer un niveau élevé de protection pour les consommateurs et d’encourager un modèle collaboratif européen qui contribuerait au développement durable de la société européenne
Infographie
Que ce soit pour se déplacer, se loger ou trouver des financements, l’économie du partage fait désormais partie de notre quotidien : un Européen sur six a déjà utilisé une plateforme collaborative, et la France est l’État membre qui compte le pourcentage le plus élevé d’utilisateurs. Dans un rapport adopté ce 3 mai en commission du marché intérieur, les députés soulignent l’importance d’une stratégie européenne pour garantir le respect de la concurrence équitable et des droits du travail.
L’économie collaborative désigne un modèle d’offre, d’échange ou d’utilisation de services entre particuliers. Parmi les plates-formes les plus connues, on retrouve Uber, Deliveroo, Airbnb ou encore Blablacar. Ainsi, une transaction implique en général trois parties : le consommateur, le fournisseur et la plateforme qui peut obtenir une commission sur le paiement.
Pourtant, toutes les plateformes ne cherchent pas à générer du profit : certaines reposent par exemple sur les contributions volontaires de leurs utilisateurs. C’est le cas de Wikipedia, aujourd’hui plus grande encyclopédie au monde avec près de 5,4 millions d’articles disponibles en anglais.
Le succès de ces plateformes pose de nouveaux défis liés aux droits des travailleurs. Par exemple, les chauffeurs ou les livreurs ne sont pas directement des employés des plateformes. Les considérer comme des travailleurs indépendants permet aux plateformes de s’affranchir de garantir certains droits sociaux, tels qu’un salaire minimum.
A lire
- Le rapport, adopté en commission parlementaire par 31 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, sera mis aux voix lors de la session plénière des 12-15 juin.
- Un sondage Eurobaromètre de 2016 a révélé qu’une personne sur six dans l’UE avait déjà eu recourt à des plateformes collaboratives. Ce rapport représente la réponse du Parlement à la communication de la Commission sur un agenda européen pour l'économie collaborative.
- L'infographie
|
Pièces jointes :
- Date de Publication: 27/03/2017
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Les modes de consommation sont bouleversés par l’apparition de nouveaux services, appuyés notamment sur l’implication des particuliers, qui deviennent offreurs et demandeurs à la fois. Sur quels mécanismes de confiance ce système, appelé « économie de partage » ou « économie collaborative », repose-t-il ?
Malgré sa très forte croissance, l’économie collaborative est aujourd’hui confrontée à de nouvelles problématiques. En effet, elle repose sur un système composé d’individus acteurs, qui interagissent entre eux, d’une manière directe ou indirecte mais sans encadrement légal. Ainsi, du côté des clients, et parfois des prestataires, surgissent des moments de doute et d’incertitude.
Ce livre blanc, publié par le Cercle Performance des Organisations, étudie les mécanismes déployés par les entreprises de l’économie collaborative pour instaurer une relation de confiance dans une atmosphère bienveillante et non intrusive. Le Cercle Performance des Organisations a vu le jour en Mars 2012, avec le soutien du groupe AFNOR. Son objectif est de contribuer à l’avancée des connaissances dans la gestion de la performance des organisations.
Des exemples concrets permettent de dresser un panorama des mécanismes existants pour différentes activités : se financer, se loger, se déplacer, se nourrir, s’équiper, se faire aider, s’habiller, se divertir, transporter/stocker.
Enfin, cette analyse s’interroge sur les initiatives qui émergent pour établir des standards internationaux de l’économie collaborative.
|
Description
Une étude du Pew Research Center vient de sortir de nombreux enseignements sur l'économie de plateformes. Conduire pour Uber, louer son logement sur Airbnb, vendre des objets sur eBay ou encore livrer des produits alimentaires pour Instacart… a permis à 24% des Américains de gagner de l’argent en 2016 !
L’économie à la demande ou la gig economy prend de l’ampleur. 42% de la population américaine aurait déjà eu recours à un service à la demande. Mais quelle est la part de clients et celle des travailleurs dans ce chiffre ? D’après une récente étude du Pew Research Center, 24% des Américains majeurs (soit quasiment un sur quatre) ont gagné de l’argent grâce à ces nouvelles plateformes. Certains en proposant leurs services (8% des adultes américains) et d’autres en vendant ou louant leur patrimoine ou des objets (18% des adultes aux Etats-Unis).
Ventes en ligne et petits jobs
Ceux qui utilisent les plateformes de l’économie à la demande pour vendre des biens ont un profil radicalement différent de ceux qui l’utilisent pour travailler. Les premiers sont surtout blancs, entre 30 et 49 ans, plutôt diplômés et favorisés. À l’inverse, ceux pour qui il s’agit d’un emploi sont plus souvent noirs (14%), peu diplômés, et peu favorisés.
Et pour certains d’entre eux il s’agit davantage d’un revenu vital que d’un simple extra. C’est le cas pour 56 % des adultes aux Etats-Unis qui ont travaillé sur ces plateformes, en conduisant pour Uber par exemple ou en réalisant des jobs ponctuels pour TaskRabbit.
Petits jobs essentiels ou en extra
En revanche, ceux qui vendent des objets sur internet sont moins nombreux à considérer cette activité comme essentielle. 80% d’entre eux estiment que ce revenu supplémentaire n’est qu’un simple bonus.
Les 20% restants qui considèrent ces ventes comme importantes ou essentielles sont majoritairement peu favorisés (52% gagnent moins de 30 000 dollars par an) et sont 55% à souffrir d’une maladie chronique. Ils sont aussi 22% à vendre des objets faits main sur des plateformes comme Etsy par exemple, contre 8% seulement parmi ceux qui voient les revenus de ces ventes en ligne comme une bonne chose, non primordiale.
Deux profil-types d’Américains qui ont gagné de l’argent en ligne se dégagent donc de cette étude. Mais les contre-exemples existent en masse, la gig economy n’est pas réservée aux moins favorisés tout comme l’économie à la demande ne concerne pas que les jeunes générations.
Quelques autres enseignements
23% de ceux qui utilisent des plateformes numériques pour le travail sont des étudiants. Une majorité d'entre eux se disent employés à temps plein (44%) ou à temps partiel (24%), mais 32% disent qu'ils ne sont pas employés.
Un vendeur en ligne sur cinq (19%) disent que les médias sociaux sont extrêmement importants pour les aider à vendre leurs marchandises; Les femmes qui vendent en ligne sont plus susceptibles que les hommes de dire qu'ils comptent sur les médias sociaux.
26% des utilisateurs de plates-formes se considèrent comme des employés des services qu'ils utilisent pour trouver du travail; 68% se considèrent comme des entrepreneurs indépendants.
29% des travailleurs ont effectué des travaux en utilisant ces sites pour lesquels ils n'ont pas reçu de paiement.
|
Pièces jointes :
- Date de Publication: 01/03/2017
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
L’ubérisation ; phénomène dévastateur ou perspective d’avenir et de prospérité ?
C'est la question à laquelle ont souhaité répondre 5 étudiants de première année de l'IUT de Saint-Etienne – Département Gestion administrative et commerciale des organisations - GACO (Jean-Baptiste GAUTHIER, Alicia DE SOUSA MOREIRA, Jeanne GUILLE, Marylise EYNARD et Joséphine CHARRIERE). Grégoire Leclercq, cofondateur de l'Observatoire les a accompagné dans leurs réflexions. En voici le résumé.
Simple phénomène de mode ou renouvellement durable d’un système désormais « dépassé » ? Le modèle socioéconomique serait-il donc arrivé à expiration ? Est-ce vraiment la révolution annoncée ?
Depuis quelques temps, les polémiques et débats autour du sujet inondent la toile et les médias. Tout le monde s’interroge, tente d’évaluer le phénomène, de mesurer son ampleur afin de déterminer la menace que l’ubérisation pourrait représenter ou au contraire, l’opportunité qu’elle pourrait être.
- Les auteurs traditionnels de l’économie en tremblent
- les start-up s’en inspirent
- les politiques s’interrogent
- les économistes mesurent, doutent, prévoient et se perdent en conjectures improbables sous le poids de ce nouveau marché
- les syndicats hurlent à la concurrence déloyale contre ce nouveau phénomène.
Nous nous sommes donc interrogés sur ce phénomène qui agite tant l’actualité et qui ne cesse de prendre de l’ampleur ; nous avons mené l’enquête.
Le terme « Ubériser », est entré en 2017 dans le Petit Robert sous cette définition : « Déstabiliser et transformer avec un modèle économique innovant tirant parti des nouvelles technologies ». Wikipédia, pour sa part, en donne une définition plus large : « L’ubérisation est un phénomène récent dans le domaine de l’économie consistant à l’utilisation de services permettant aux professionnels et aux clients de se mettre en contact direct, de manière quasi instantanée, grâce à l’utilisation des nouvelles technologies. La mutualisation de la gestion administrative et des infrastructures lourdes permet notamment de réduire le coût de revient de ce type de service ainsi que le poids des formalités pour les usagers. Les moyens technologiques permettant l’ubérisation sont la généralisation du haut débit, de l’internet mobile, des smarphones et de la géolocalisation. Elle s’inscrit de manière plus large dans le cadre de l’économie collaborative. »
Les étudiants ont voulu aller plus loin que ces définitions et étudier ce phénomène, ses causes et ses effets afin de comprendre l’impact qu’il pourrait avoir sur notre société et sur nos modes de vie et pourquoi il effraie autant qu’il séduit. Cependant, le sujet est vaste, très récent et en perpétuelle évolution, et l'équipe est restée sur une observation large du phénomène.
En quoi l’Ubérisation de la société pourrait déstabiliser le modèle socio-économique français actuel, considéré comme traditionnel ? »
A travers cette problématique, on retrouve les causes et les conséquences de ce phénomène qui soulève tant d’interrogations
- origines de l’uberisation
- quels secteurs sont touchés
- effets socioéconomiques engendrés
- dispositions juridiques envisagées
|
Description
EY publie les résultats de son étude sur la « Gig Economy », ou « économie des petits boulots ». Cette étude s’appuie sur 2 sondages menés auprès de 214 organisations et plus de 1 000 travailleurs indépendants pour examiner les tendances principales de cette dynamique aux Etats-Unis.
La « Gig economy » repose sur des contrats de courtes durées entre l’entreprise et des travailleurs indépendants. L’étude EY révèle que ce phénomène en expansion est porté à la fois par un choix stratégique des entreprises et une volonté personnelle de la plupart des travailleurs concernés.
Le recours aux travailleurs indépendants a augmenté
Le recours aux travailleurs indépendants dans les grandes entreprises a augmenté de 49% au cours des 5 dernières années.
40% des organisations interrogées comptent avoir davantage recours à ce type de travailleurs dans les 5 années à venir.
Parmi les principales raisons citées, 56% des employeurs ont recours aux travailleurs indépendants afin d’acquérir une expertise spécifique que leurs salariés ne possèdent pas.
Pour 55% des organisations sondées, le bénéfice des « Gig workers » réside dans le contrôle des coûts du travail.
L’étude montre également que le travail indépendant est un choix pour une majorité des personnes interrogées :
- 73% des travailleurs indépendants interrogés assurent choisir ce régime de travail pour des raisons positives. Dans seulement 20% des cas, cette situation est indépendante de leur volonté.
- 66% pensent que les avantages du travail indépendants sont généralement supérieurs aux inconvénients.
- 80% des sondés apprécient notamment la flexibilité offerte par cette condition.
En revanche, pour 68% des travailleurs indépendants, l’accès à une couverture médicale et le droit à la retraite restent une préoccupation majeure, de même que le recours aux congés payés ou maladie.
|
Description
Uber, Airbnb, Pretoo... Depuis plusieurs années, l'économie collaborative fait partie du quotidien des consommateurs. Une étude CSA pour la société de crédit à la consommation Cofidis permet de chiffrer l'utilisation que font les Français de ce nouveau secteur. Il apparaît que 95% des Français ont recours à l'économie collaborative dont 62% régulièrement. Et les utilisateurs en tirent un pécule non négligeable : 495 euros en moyenne.
Ces nouveaux modes de consommation sont massivement adoptés par les Français. Leur principale motivation est d'économiser de l'argent.
La consommation collaborative à la rescousse du pouvoir d'achat des Français! Ces nouveaux modes de consommation, qui privilégient l'échange de biens et de services entre personnes à l'achat de nouveaux produits, gonflent le portefeuille des Français de 495 euros par an en moyenne, constate une étude réalisée par CSA pour l'organisme de crédit à la consommation Cofidis.
257 euros d'économie, 238 euros de revenu,
Les consommateurs qui achètent un bien d'occasion plutôt qu'un produit neuf ou encore recourent au covoiturage plutôt qu'au train économisent ainsi de l'argent. C'est chaque année 257 euros, en moyenne, qu'ils ne déboursent pas, selon l'étude de Cofidis. Parallèlement, d'autres pratiques de consommation collaboratives rapportent directement de l'argent aux Français. C'est le cas de la location de son propre logement, ou de la revente d'un de ses biens. En moyenne, cette activité fait gagner aux Français 238 euros par an.
La motivation des Français pour consommer autrement est principalement... pécuniaire. 87% des Français recourent à l'économie collaborative pour économiser de l'argent et 76% pour en gagner. Une préocupation cependant compatible avec le désir de se sentir utile, que revendiquent 41% des consommateurs. «L'économie collaborative permet aussi soigner un maux de notre société qui est la distanciation du lien social. Le covoiturage rompt par exemple la solitude et permet de faire de nouvelles rencontres, en même temps que des économies», constate Céline François, directrice marketing de Cofidis France.
L'économie collaborative, un phénomène de masse
La quasi-totalité de la population a déjà eu recours à l'économie collaborative. 95% des Français ont déjà fait du covoiturage, vendu un objet sur le Boncoin ou encore loué un logement sur Airbnb au moins une fois, tandis que 62% d'entre eux le font régulièrement. Les récalcitrants sont chaque année moins nombreux. Huit Français sur dix sont même acteurs de cette économie puisqu'ils proposent leurs biens à vendre ou à louer à d'autres particuliers.
Les jeunes et les catégories sociales favorisées, plus investis
Plus connectés, les jeunes et les catégories sociales favorisées sont plus impliqués dans l'économie collaborative. Elle leur rapporte donc davantage. Les jeunes de 25 à 34 ans économisent et gagnent 613 euros par an, et les cadres et professions libérales 686 euros. Les catégories sociales moins favorisées revendent en revanche plus volontiers les objets qu'ils n'utilisent pas et recourent plus souvent au troc.
L'achat d'occasion et la revente de biens, pratique de consommation collaborative la plus populaire
76% des Français ont déjà acheté un bien de seconde main, et 71% ont déjà revendu un objet dont ils ne voulaient plus, que ce soit sur le boncoin ou dans un vide-grenier. Cette pratique est en hausse de 8% par rapport à l'année dernière. L'achat groupé est une autre pratique en forte hausse cette année (+13%). 45% des Français qui ont déjà acheté une fois de cette façon, sur un site comme Groupon). «Les Français sont à l'affût de bons plans pour faire des économies», explique Céline François.
Le covoiturage (un Français sur trois l'a déjà pratiqué) et la location du logement d'un autre particulier figurent ensuite parmi les modes de consommation collaboratifs les plus répandus. Le troc ou l'échange sont en revanche extrêmement marginaux puisqu'ils ne concernent que 3% de la population. Quand aux services de chauffeurs privés tels qu'Uber ou Heetch, ils apparaissent comme principalement «franciliens».
|
Pièces jointes :
- Date de Publication: 03/01/2017
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
L'Ordre des Experts-Comptables Paris publie une analyse sur le modèle des plateformes de mise en relation entre experts-comptables et leurs clients.
Ce guide s’adresse aux experts-comptables référencés, qui demeurent soumis à leur déontologie (page 4) ainsi qu’aux opérateurs de plateformes en ligne assurant la mise en relation d’experts-comptables avec des clients (page 7).
La commission déontologie et études techniques du Conseil régional de l’Ordre de Paris IDF a été saisie à de nombreuses reprises s’agissant de plateformes en ligne qui ne respectaient pas les règles fondamentales de déontologie et référençaient des officines illégales.
Le constat est le suivant :
- il existe, d’une part, une confusion sur la qualité des opérateurs de plateforme étant susceptible de constituer un délit d’exercice illégal
- il existe d’autre part, une violation récurrente de règles déontologiques fondamentales.
Face à ce constat, le Conseil régional a souhaité encadrer les pratiques des opérateurs de plateforme référençant des experts-comptables. Par ailleurs, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique oblige les opérateurs de plateforme (dépassant un seuil de nombre de connexions qui sera fixé par décret) à élaborer et diffuser aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer des obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l’article 111-7 du code de la consommation.
Parmi les règles retenues :
- conserver son indépendance quand on est expert-comptable
- rester vigilant sur les termes de sa communication
- rester soumis au secret professionnel et au devoir de discrétion
- Rester neutre dans le cadre de la mise en relation et des relations experts-comptables/clients
- Participer à la lutte contre l’exercice illégal
- Appliquer la réglementation sur le traitement des données personnelles
|
Pièces jointes :
- Date de Publication: 21/12/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
L'ARCEP, le Conseil Général de l'Economie et l'Agence du Numérique, viennent de publier une grande enquête 2016, le Baromètre du numérique, analysant les équipements des français et l'évolution de leurs utilisation du numérique au quotidien.
Des français toujours plus connectés, surtout en mobilité !
Pour son édition 2016 du Baromètre Numérique, publié conjointemant par l'Agence du Numérique, l'ARCEP et le CGE (Conseil Général de l’Economie), le CREDOC (Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie), a interrogé un échantillon 'représentatif' plus de 2 000 personnes, âgées de plus de 12 ans, lors de face-à-face chez eux, plus un 'sur-échantillon' de 100 personnes résidant en zone peu dense (des chiffres qui datent de juin 2016).
Le bilan dressé par ce baromètre semble plutôt optimiste, pour ne pas dire euphorique. Il confirme cependant des tendances déjà observées l'an dernier par de nombreuses études, avec un usage massif et inconditionnel d'Internet : 100% des 12-39 ans sont des internautes !
Selon cette étude, un internaute sur deux annonce même ne pas pouvoir se passer d'Internet plus de deux ou trois jours, un sur quatre seulement est prêt à être coupé du net pendant plus de 3 semaines, avec 74 % de la population française qui se connecte au Web tous les jours.
Par ailleurs, une étude Médiamétrie récente sur les usages des internautes français montre qu'ils utilisent quotidiennement en moyenne 1 heure trente minutes Internet depuis leur ordinateur (en octobre 2016), le plus souvent sur des jeux en ligne (49 minutes et 29 secondes chaque jour), puis sur des Blogs et Sites Communautaires (32 m. 24 s.) suivi des sites de Vidéos et de Cinéma (24 m. 33 s.).
Les français et la connexion aux réseaux numériques
Ce sont 78% des plus de 40 ans qui sont des internautes avérés, avec 80% des français qui accèdent à Internet sur leur PC/Mac, et 65% depuis leur téléphone portable. Sur le mobile, ce serait 42% qui utiliseraient la 4G, 3 fois plus qu'en 2014, avec deux Français sur trois (65%) qui ont un smartphone.
Cette étude donne des résultats assez surprenants tout de même, sur la perception des français au niveau de la qualité des réseaux numériques. Ainsi, la connexion internet mobile (donc plutôt en 4G logiquement) est considérée comme satisfaisante pour 83% de la population, et même 77% en zone peu dense !
Plus logiquement, ce sont 85% de l'ensemble des utilisateurs de téléphones mobiles qui ne rencontrent pas de difficultés majeures à envoyer des SMS ou à passer des appels, et 75% en zone peu dense, ce qui semble déjà plus logique puisque la couverture 2G des territoires oscille entre 90,7% à 97,8%... 80% à 92.6% pour la 3G (source ARCEP janvier 2016).
Des français multi-équipés
De même, à domicile, les internautes fixes seraient satisfaits à 88% de leur connexion à Internet dans leur logement, notamment à 73% en ce qui concerne l'utilisation de la télévision. Des chiffres qui descendent seulement à 84% et 66% respectivement en zones peu denses… Devant le nombre de personnes qui se plaignent de la qualité de leur connexion à Internet et de ceux qui changent d'opérateur, on reste perplexe devant ces chiffres.
Un élément important qui ressort de ce baromètre vient du transfert des usages de la télévision vers Internet. Si entre 2012 et 2016, le temps passé devant la télévision reste stable, 20 heures par semaine, le temps passé sur Internet progresse de 13 heures à 18 heures.
Pour finir sur le taux d'équipement, 30% de la population possède à la fois un ordinateur, une tablette et un smartphone, en progression de 5% en un an. Ceux qui ont un ordinateur et un smartphone sont également 29%, tandis que seulement 11% n'ont aucun de ces matériels. Plus important, 93% des personnes interrogées ont un téléphone portable, contre seulement 88% pour le fixe.
Pour ce dernier, 58% de ceux qui n'ont pas de ligne fixe déclarent que ce critère n'est pas du tout gênant, le mobile remplaçant de plus en plus la téléphonie fixe ! Des chiffres évidemment nettement plus faibles sur la population de plus de 70 ans, avec 89% des individus interrogés alors très attachés à leur numéro de téléphone fixe. Par ailleurs, 67% des sondés avec une ligne fixe passent par un téléphone fixe via leur box internet, une proportion stable depuis deux ans (+1%).
Un bilan positif
Cette étude dresse un bilan plutôt très positif des usages digitaux des français.
|
Description
Deux ans après la déclaration de Maurice Levy, le patron de Publicis, qui utilisait pour la première fois l'expression d'«ubérisation de l'économie» qui remet en cause le positionnement des entreprises leader sur leur secteur, où en est-on réellement Selon une étude de la banque d'affaire Clipperton, d'autres secteurs vont être touchés par l'ubérisation comme la santé. Mais ce ne sera pas le raz-de-marée observé dans les transports.
Inquiétude
L'ubérisation de l'économie va-t-elle tout emporter sur son passage ? Le mot déchaîne en tout cas les passions des économistes et cristallise les peurs, sur l'emploi par exemple. Confrontés à la digitalisation de leurs activités, près de la moitié des dirigeants s'inquiètent de la possible obsolescence de leur entreprise dans un délai de 5 ans à peine. Une étude, réalisée par la banque d'affaires Clipperton Finance, nuance toutefois la situation. Cette étude a été conçue à partir d'une série d'entretiens réalisés au cours des six derniers mois avec les acteurs du secteur, sur leurs manières de travailler, leurs modèles économiques, leur stratégie…
Qu'est-ce qui distingue l'évolution progressive d'un secteur, amené à intégrer le digital à son coeur de métier de l'«ubérisation»? C'est à cette question qu'a souhaité répondre la banque d'affaires Clipperton avec son rapport «The 'Uber-Economy': how marketplaces empowering casual workers disrupt incumbents».
Parmi les principales caractéristiques de ce que les auteurs appellent l'«Uber-economy», on retrouve notamment des modèles d'entreprises centrés sur l'humain, dans le sens où elles apportent un complément de revenu à une partie de leurs utilisateurs. Leurs modèles peuvent être soit centrés sur le capital travail, à l'image d'Uber ou d'Upwork, soit sur la mise à disposition d'actifs tangibles, comme AirBnB.
Definition
Premier apport de Clipperton au débat : la définition d'un terme qui a souvent été galvaudé. Les sociétés gravitant dans l'« uber-économie » ne sont pas synonymes de plates-formes digitales, mais n'en sont qu'un sous-groupe. Elles ne sont pas, non plus, synonymes, d'automatisation ou de robotisation. Elles réunissent plusieurs critères : il s'agit de plates-formes qui facilitent l'échange, mais aussi la transaction entre une offre et une demande, qui agissent sur des marchés vastes en fournissant une solution globale à des problèmes locaux. En général, ce sont aussi des services plus centrés sur le travail que sur les actifs physiques - Airbnb étant l'exception. Ainsi, plusieurs sociétés se retrouvent exclues du champ de l'observation, comme notamment BlaBlaCar. « La notion de dépendance économique est assez importante dans la relation entre ces sociétés et leurs partenaires. Or, chez BlaBlaCar, on ne peut pas vraiment gagner de l'argent si l'on suit les recommandations de tarification, on couvre surtout ses frais », explique Thibaut Revel, associé chez Clipperton Finance.
Société de la qualification
Selon l'étude, l'ubérisation a touché en priorité les marchés des transports, de l'hôtellerie et, à un degré moindre, des services à domicile et des free-lances. « Ceux qui ont subi l'ubérisation, ce sont les secteurs où la relation hiérarchique était assez simple et où la valeur ajoutée de la hiérarchie était fine. Les sociétés de taxis, par exemple, apportaient des clients à leurs chauffeurs et les aidaient dans la gestion administrative. Des tâches qu'une plate-forme informatique peut très bien réaliser », note Nicolas von Bulow, associé chez Clipperton.
Dans le cas des services à domicile, le constat est plus nuancé. « Pour qu'il y ait ubérisation, il ne faut pas qu'entre en jeu un fort intuitu personae. Pour me rendre d'un point A à un point B, peu importe la personne qui m'y conduit. Si l'on confie les clefs de sa maison ou son enfant, c'est différent », ajoute Thibaut Revel. Ce qui expliquerait l'échec d'une société comme Homejoy, ou le repositionnement de plates-formes de baby-sitting.
Les prochains secteurs à ubériser
Dès lors, se pose la question des prochains secteurs à connaître les foudres de l'ubérisation. L'étude s'est penchée sur trois d'entre eux : la santé, l'éducation et le conseil. Des secteurs qui ne réunissent pas les critères définis précédemment, mais qui ne sont pas à l'abri de profonds bouleversements. « Tout le monde ne va pas devenir médecin, il y aura toujours une forte attache à la relation patient-médecin, opine Nicolas von Bulow. Mais des poches d'ubérisation peuvent apparaître. Par exemple, cette relation n'est pas la même quand on passe une radio. » D'autant que la notion de « qualification » ou de « réputation » (les notes des chauffeurs sur Uber, par exemple), qui se développe avec l'ubérisation, est à même de gommer en partie cet intuitu personae. Et qu'une partie de l'évolution dépendra des réglementations…
|
Description
Etude de la COFACE : Ubérisation en Ile de France.
Quelques éléments :
- la France, est un des leaders de l’économie collaborative en Europe, avec plus de 50 entreprises dans ce domaine
- avant 2012, un déséquilibre entre l’offre et la demande des secteurs traditionnels : une situation de quasi-monopole des taxis et hôteliers en Ile-de-France car seulement 4000 licences supplémentaires de taxis créées en 70 ans et un déficit de 7000 chambres à Paris
- après 2012 et l’arrivée d’Uber et AirBnB : un taux d’occupation stable dans l’hôtellerie parisienne jusqu’aux attentats, 45000 VTC créés en France depuis 2009
LES DÉFAILLANCES DE TAXIS SONT LARGEMENT COMPENSÉES PAR LES CRÉATIONS DE VTC EN RÉGION PARISIENNE
Les défaillances de taxis ont augmenté en France de près de 60% en un an, passant de 141 cas à fin août 2015 à 224 cas à fin août 2016. Une défaillance détruit en moyenne 3,38 emplois. En Ile-de-France, les défaillances de taxis ont augmenté de 135% entre 2013 et 2016 et représentent 1/4 de l’ensemble des défaillances du secteur en France. En parallèle, on assiste à une accélération des créations de VTC, multipliées par 7 depuis 2013, pour atteindre 14 404 entrepreneurs sur un an à fin août 2016 et 12 964 emplois créés. La région parisienne connaît la plus forte progression de ces créations (multipliées par 9,5) et concentre 78% du total des créations de VTC en France (en août 2016).
En comparant les défaillances de taxis d’une part et les créations de VTC de l’autre, les données démontrent que l’arrivée de nouveaux VTC sur le marché couvre largement les défaillances, et ce, même après 3 ans, âge critique pour une entreprise.
A PARIS, L’HÔTELLERIE TRADITIONNELLE RÉAGIT MOINS BRUTALEMENT À L’ARRIVÉE D’AIRBNB QU’AUX ATTENTATS
Malgré l’arrivée d’Airbnb sur le marché de la capitale en 2012, les défaillances dans le secteur de l’hôtellerie ont fortement diminué, de -58%, entre 2012 et 2014. Et cela même si le nombre de chambres disponibles via Airbnb a été multiplié par plus de 8. L’offre hôtelière parisienne étant insuffisante, cela n’a fait que combler un vide.
La dynamique tend cependant à s’inverser en 2015 et marque une rupture : les défaillances des hôteliers parisiens connaissent une hausse brutale de 117%. Les attentats terroristes à Paris de début et fin d’année ont plombé la fréquentation hôtelière parisienne qui a diminué d’environ 5 points (entre juin 2015 et juin 2016) alors que le trafic aérien a augmenté de 3% sur la même période. Airbnb a certainement capté une partie de ce changement, les chambres disponibles doublant en un an, pour dépasser 55000 à fin août 2016.
Pour contrer cette pression le gouvernement prévoit d’encadrer de manière plus stricte le fonctionnement des plateformes: taxation des revenus complémentaires pour les loueurs, limitation du nombre de jours loués pour la résidence principale ou bien harmonisation des conditions d’accès aux statuts VTC et taxis. Cependant, dans le cas d’une baisse du nombre de VTC de 20%, environ 2600 emplois seraient détruits en France.
|