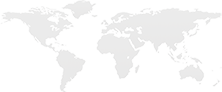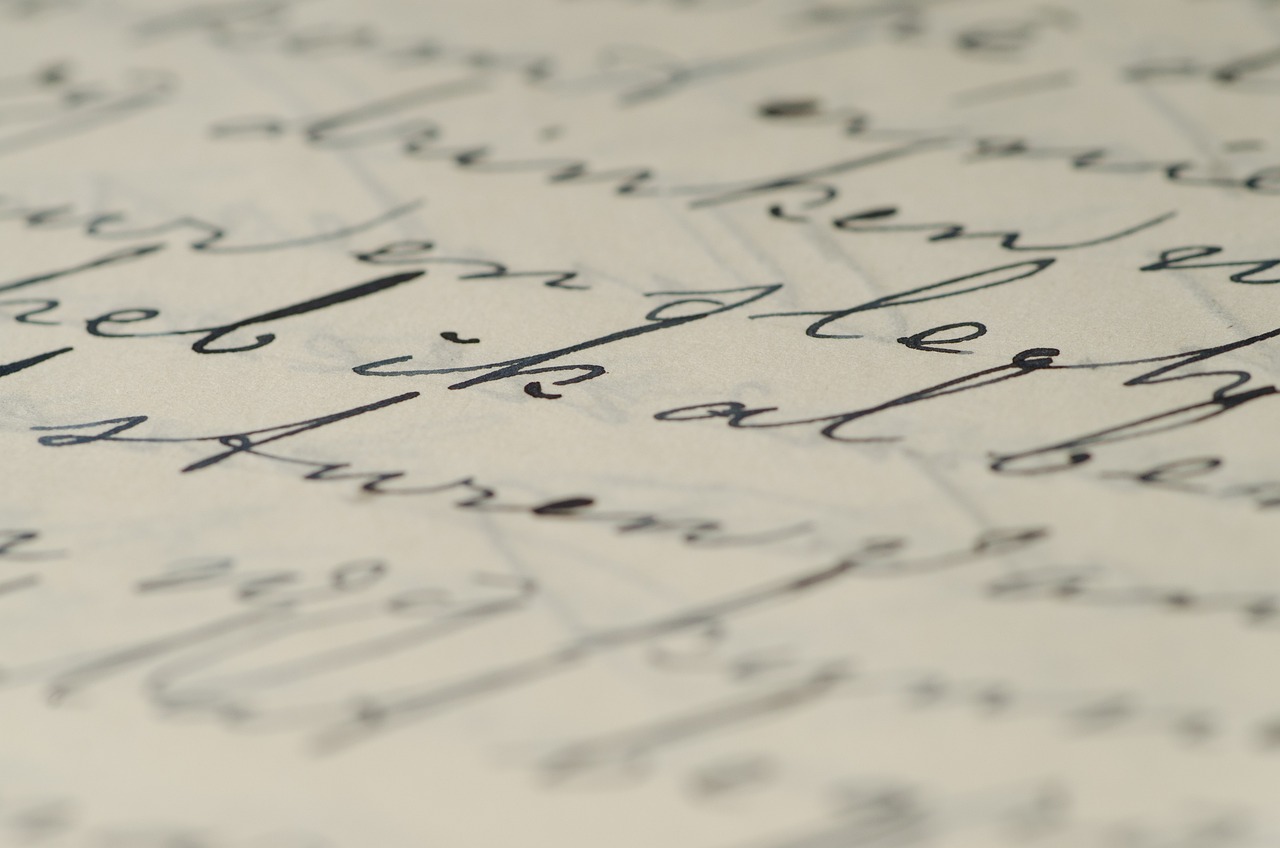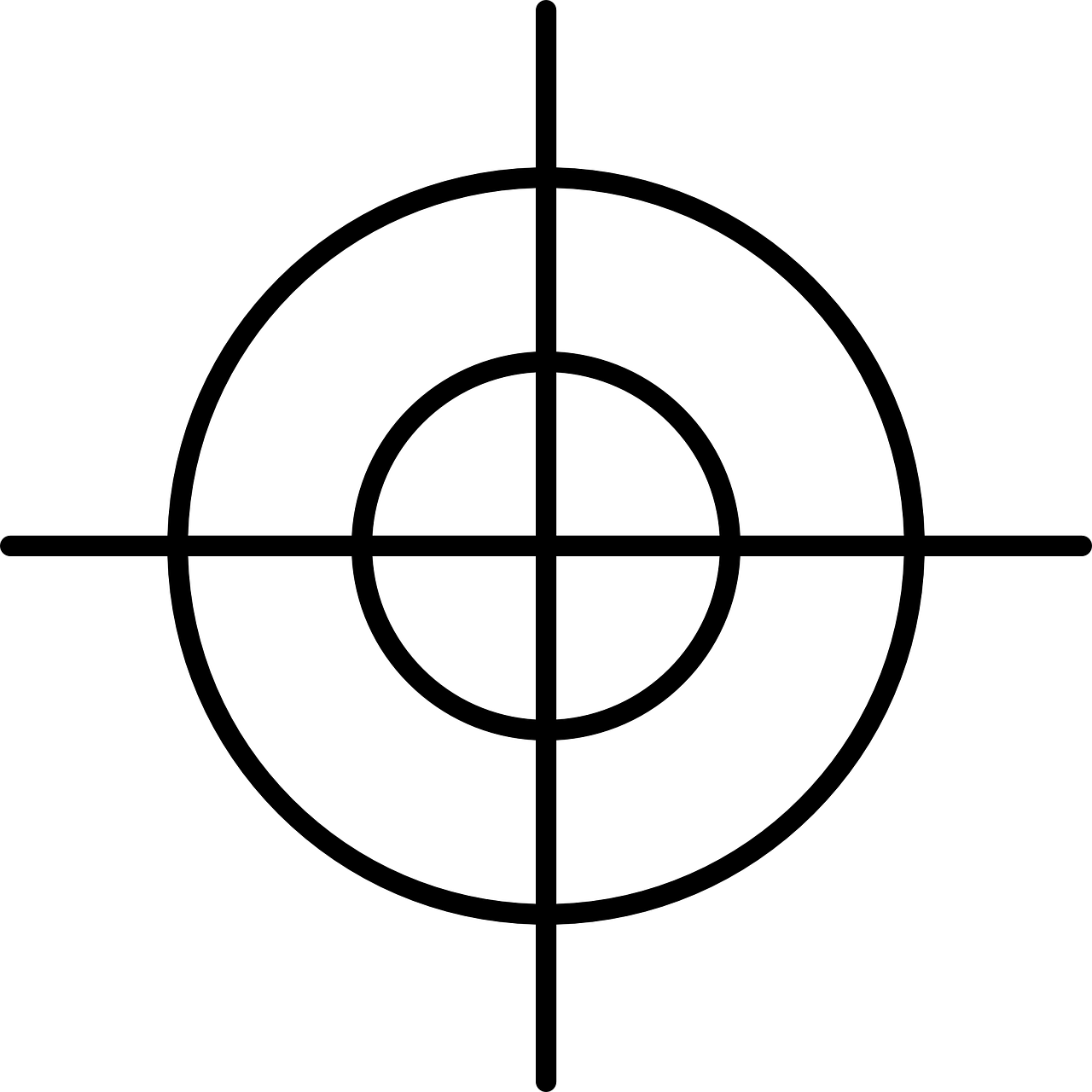Description
Depuis quelques années, les succès mondiaux des Uber, Airbnb ou encore Blablacar, intimement liés à la transformation numérique, ont braqué les projecteurs sur une autre manière de consommer, qui privilégie le partage et la mutualisation des moyens. Selon le dernier sondage réalisé par Syntec Numérique et Odoxa1, les Français ont adopté cette révolution collaborative, qu’ils associent souvent à des valeurs positives, telles que la réalisation d’économies ou de nouvelles rencontres.
Les Français et l’économie collaborative
82 % des personnes interrogées en ont une opinion positive
Pour 83 % des sondés, elle permet de faire des économies pour un produit ou un service équivalent
65 % des interviewés y ont déjà eu recours ou comptent en faire usage
Un phénomène plébiscité par la population française
L’économie collaborative est sortie de sa « niche » et fait désormais partie du quotidien de chacun : le sondage révèle que plus de 8 Français sur 10 sont convaincus par cette nouvelle forme d’organisation. Cette quasi-unanimité est d’ailleurs vraie dans toutes les catégories de la population, jeunes (85 % des 18-24 ans) et moins jeunes (82 % des 65 ans et plus).
Préoccupés par la baisse de leur pouvoir d’achat, 83 % des Français estiment en effet que le collaboratif permet de réaliser des économies, pour un produit ou un service. Il offre également la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes (79 %), de moins polluer (74 %) ou encore de gagner du temps (66 %).
Les critères négatifs proposés sont majoritairement rejetés : l’idée que l’économie collaborative serait avant tout destinée aux jeunes (56 % pensent que ce n’est pas le cas), dangereuse pour l’emploi (59% estiment que non), ou encore une mode passagère (64 % ne sont pas d’accord).
Seul bémol, 64 % des Français considèrent que cette économie présente de nombreux risques d’arnaques. Il s’agit d’un enjeu de taille pour le développement de l’économie collaborative. Ces sites n’étant pas des entreprises comme les autres, ils ne peuvent pas garantir la loyauté de tous leurs « collaborateurs », mais bien rassurer les usagers sur la sécurité des paiements, la fiabilité des systèmes de notation et la possibilité d’avoir des recours en cas de problème.
Un usage qui s’installe dans le quotidien des Français
Souvent fustigé pour ses lourdeurs, l’Hexagone montre toutefois une véritable ouverture pour le développement de l’économie de partage. S’il y a quelques années les études montraient un usage de « niches » (jeunes urbains notamment), les Français sont aujourd’hui deux tiers à déclarer qu’ils y ont déjà eu recours (36 %) ou comptent en faire usage (29 %) dans les mois à venir. Seul un tiers (34 %) d’entre eux n’envisage pas encore de franchir le pas.
Les usagers ou futurs usagers sont majoritaires dans toutes les catégories d’âge même si la proportion des jeunes est supérieure aux plus âgés : 72 % chez les 18-25 ans (dont 45 % d’usagers actuels), 54 % chez les 65 ans et plus (dont 24 % d’usagers actuels), avec une baisse continue au fur et à mesure que l’âge augmente.
« Ce bouleversement de l’économie a été permis par le numérique qui facilite la mise en relation entre les acteurs économiques - professionnels ou particuliers - et leur constante évaluation. La compétitivité des prix et la qualité des services qui en résultent entraînent des taux de satisfaction élevés qui amplifient constamment son adoption. Il est d’ailleurs intéressant de noter que le recours à ces modes de consommation alternatifs est réputé faire gagner du temps pour deux tiers des Français.
Surtout, nos concitoyens rejettent majoritairement l’idée qu’il s’agirait d’un mouvement éphémère et réservé aux jeunes. Pour eux, l’économie collaborative s’adresse à l’ensemble des citoyens et va durablement s’installer. C’est un formidable défi à relever pour nos entreprises et une belle opportunité pour les générations à venir qui trouveront sans doute dans cette économie de partage les solutions à bien des problèmes de nos modes de vie actuels » déclareMuriel Barnéoud, Présidente du Collège éditeurs de Syntec Numérique.
|
Description
Prisma Media Solutions développe depuis 4 ans des observatoires sectoriels pour donner des réponses concrètes aux questions spécifiques des annonceurs et de leurs conseils. Après l’Alimentaire, l’Automobile, la Beauté…, PMS lance son premier observatoire consacré à la Banque, intitulé « Vers l’ubérisation bancaire ».
Le but est de mettre en perspective les changements de paradigme majeurs qui secouent et challengent les réseaux traditionnels aujourd’hui.
Avec l’appui d’une enquête quantitative ad hoc exclusive menée par l’institut CSA (échantillon représentatif des Français 15+, notamment en termes de bancarisation), cette étude aborde :
– Le buzzword « Uberisation » et sa pertinence dans le secteur bancaire
– La relation des Français à la banque aujourd’hui : degrés de connaissance et d’autonomie, perception et niveau de confiance
– L’attractivité des ‘nouveaux’ acteurs : aujourd’hui les banques en ligne, demain les GAFA
– Les intentions de churn : quelles projections pour l’ouverture d’un compte courant / une nouvelle épargne / la souscription d’un crédit immobilier
– Les nouveaux produits et nouveaux services : zooms sur le crowdfunding / les cagnottes en ligne / le compte-nickel / les nouveaux moyens de paiement
– Les phénomènes des cibles les plus sensibles aux nouveaux comportements (early-adopters)
Etude à lire avec infographies claires et passionantes
|
Pièces jointes :
- Date de Publication: 18/03/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
À quoi ressemblera le travail demain ? Serons-nous tous entrepreneurs nomades ? Le contrat commercial aura-t-il remplacé le contrat de travail et l’intermittence sera-telle devenue la règle ? L’entreprise modulaire et les fabs labs auront-ils eu raison du bureau et de l’usine traditionnels ? Les espaces de co-working et les réseaux professionnels se substitueront-ils au travail en équipe et aux espaces de dialogue social ? Autant de questions qui émanent des bouleversements portés par la révolution technologique et par la numérisation de l’économie. Ceux-ci renouvellent aujourd’hui les termes de la réflexion, déjà engagée, sur les mutations du travail et sur son avenir.
Cécile Jolly et Emmanuelle Prouet réalisent pour France Stratégie une étude intitulée : "L'avenir du travail : quelles redéfinitions de l'emploi, des statuts et des protections ?"
Depuis les années 1980, la mondialisation, la fragmentation des chaînes de valeur, l’externalisation, le changement technologique et la montée du taux d’activité des femmes ont profondément transformé l’emploi et le travail. L’économie s’est tertiarisée, les qualifications se sont polarisées, le salariat s’est précarisé, la poly-activité s’est développée, le travail indépendant a cessé de reculer, le morcellement des parcours s’est accentué (changements de statut, passages plus fréquents par le chômage). Les frontières ont eu tendance à se brouiller : la distinction entre salariés et indépendants est devenue floue, l’entreprise « étendue », les lieux et le temps de travail flexibles.
Les nouvelles vagues de technologie, notamment numérique, et les nouveaux modèles d’affaires nés des plateformes sont susceptibles d’amplifier des phénomènes déjà anciens, voire d’en modifier plus radicalement la nature. L’approfondissement du morcellement des parcours et la montée en puissance des formes d’emploi non salariées ou hybrides peuvent dès lors remettre en cause la protection des actifs (protection juridique, protection salariale, assurances contre les risques) qui dépend encore largement du statut d’emploi et notamment de la norme du salariat en CDI. La nature des réformes à engager en ce sens dépend néanmoins du diagnostic rétrospectif et prospectif que l’on peut porter sur ces mutations.
Or de fortes incertitudes demeurent sur l’ampleur à attendre de la transformation en cours et sur sa capacité disruptive. La désintermédiation, l’élargissement du spectre de l’automatisation/robotisation et la mise en place de modèles d’affaires à une échelle immédiatement mondiale vont-ils avoir un impact plus fort sur le volume et la qualité de l’emploi que les évolutions passées ?
En France, les contrats courts et la précarisation de l’emploi sont ainsi très concentrés sur certaines catégories de travailleurs (jeunes, femmes, peu qualifiés), sur certaines activités particulièrement saisonnières (hôtellerie restauration) ou à fort turn over (services d’aide et de soin, distribution), tandis que l’essor du travail indépendant semble concerner certains métiers (arts et spectacles, designers, graphistes, services aux particuliers, etc.). Ce spectre est-il susceptible de s’élargir ou ces types de contrats et de statut sont-ils consubstantiels à un nombre restreint de professions et de profils ?
Quelle est la part de la conjoncture et des effets de composition démographique et sectorielle dans les évolutions observées ? Plus largement, la transformation en cours de l’économie va-t-elle emporter une domination du droit commercial sur le droit du travail et une extension de l’intermittence des parcours ? Ou bien, la porosité des statuts et des revenus d’activité n’est-elle que le reflet d’une certaine « immaturité » des activités nouvelles dont les formes d’organisation et d’inscription dans le droit et les protections se normaliseront avec le temps ?
Selon le diagnostic posé, les réformes envisagées ne sont pas de même nature.
Soit on considère que c’est une lame de fond à laquelle il ne sera guère possible de résister, et il est dès lors nécessaire de changer radicalement les régulations du travail et les protections sociales associées.
Soit on considère que le changement est réel mais lent et contrasté, et il est possible d’adapter, comme on a su le faire jusqu’à présent, les régulations et les protections existantes. Les questions posées aujourd’hui par les « travailleurs du numérique » rejoignent en effet pour partie des questions plus anciennes et pour certaines partiellement traitées par le législateur. Elles appellent néanmoins des réponses complexes puisqu’il s’agit à la fois d’offrir des protections dans un cadre financier contraint et de réguler sans faire obstacle aux opportunités de développement de l’emploi.
L’ensemble de ces mutations amène à s’interroger sur le devenir du travail et sur ses conséquences sur la protection des actifs.
|
Pièces jointes :
- Date de Publication: 21/02/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Le cabinet Elia Consulting accompagne ses clients dans l’innovation et la transformation de leur business model, leurs nouvelles stratégies, leurs nouvelles expériences clients et leurs nouvelles manières de collaborer. il a lancé une étude sur "Les Français et l'Ubérisation".
Premier enseignement : 77% des Français se disent aujourd’hui capables de donner un avis sur le sujet. 83 % associent ce terme à des offres plus compétitives. Une réponse ni tout à fait positive, ni tout à fait négative, directement suivie par une autre qui laisse peu de doutes sur le sentiment des Français à l’égard de ces nouvelles offres : pour 80% d’entre eux, l’ubérisation est en effet synonyme d’offres mieux adaptées aux attentes des consommateurs.
Si les acteurs de la nouvelle économie sont plus que jamais orientés consommateurs, les Français n’en pensent pas moins que ces nouvelles entreprises engendrent également des emplois plus précaires (pensent 70% des Français) et la destruction de secteurs professionnels (selon 66% des sondés).
Questionnés sur les secteurs impactés par le phénomène, les Français pensent que les trois secteurs les plus concernés sont
- le transport (81%)
- l’hôtellerie (57%)
- la distribution (42%)
La justice arrive en fin (pour 7% des Français) alors qu'elle subit pourtant elle aussi sa petite révolution.
Pour ou contre, tout est une question de casquette
En tant que consommateurs, près de 2 Français sur 3 considèrent que « l’ubérisation est une bonne chose » (64%). Les moins de 35 ans (73%), les demandeurs d’emplois (73%) et les Franciliens (74%) y sont les plus favorables. Mais lorsque les Français sont interrogés en tant que travailleurs, seuls 52% d’entre eux voient alors l’ubérisation comme « une bonne chose ». Ceux qui la considèrent négativement sont particulièrement représentés parmi les plus de 50 ans (61%) et la fonction publique (57%).
Signe de ce dédoublement de perception, près d’un Français sur 5 (17%) considère à la fois : l’ubérisation comme positive si on le questionne en tant que consommateur, l’ubérisation comme nuisible si on l’interroge en tant que professionnel.
|
Description
Lors d’une conférence de presse, le Medef a présenté les fruits d’une étude intitulée « Numérique et nouvelles activités », lancée en septembre dernier à la demande de Pierre Gattaz, président du Medef, et menée par trois vice-présidents du Medef - Alexandre Saubot, Geoffroy Roux de Bézieux et Thibault Lanxade.
Le Medef est convaincu qu’il faut tout faire pour favoriser la nouvelle économie et les nouvelles formes d'activité qu’elle engendre : elles sont des opportunités pour nos entreprises et répondent à une demande des citoyens. Il est cependant indispensable de veiller à ce que les règles trop rigides auxquelles sont soumis les acteurs économique existants ne les empêchent de s’adapter aux bouleversements en cours.
Le Medef formule donc 15 propositions autour de 4 grands axes :
- Rééquilibrer l’asymétrie de concurrence fiscale : non pas en accroissant la pression fiscale sur les nouveaux entrants mais en diminuant celle qui pèse sur les acteurs existants et en assurant leur financement ;
- Mieux financer les nouveaux acteurs et les plateformes d’activité : il est très important de favoriser l’émergence d’acteurs qui peuvent devenir des leaders mondiaux dans leur secteur très rapidement ;
- Sécuriser et accompagner les nouvelles formes d’activité, notamment en agissant sur le risque de requalification ;
- Enfin, et surtout, rendre les entreprises « traditionnelles » plus agiles en leur permettant de s’adapter plus simplement. A ce titre, le Medef attend beaucoup du projet de loi de Mme El Khomri.
Ce travail s’inscrit dans le cadre des actions du Medef en faveur de l'entrepreneuriat et de la transformation numérique des entreprises françaises, de toutes tailles et de tous secteurs. Le Medef a déjà organisé trois délégations de chefs d’entreprise au CES de Las Vegas et dans la Silicon Valley et y a dédié une commission (« transformation numérique ») très active. Il lancera également la deuxième édition de l’Université du numérique les 16 et 17 mars 2016.
|
Pièces jointes :
- Date de Publication: 12/02/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
D’après le sondage OpinionWay mené pour Capgemini Consulting, les Français sont prêts à partager leurs données personnelles pour obtenir des services de meilleure qualité. Sondage réalisé par OpinionWay pour Capgemini Consulting auprès d’un échantillon de 1014 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas). Les interviews ont été administrées par questionnaire autoadministré en ligne le 21 et 22 octobre 2015.
Capgemini Consulting, la marque de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini, dévoile une étude portant sur « les Français et l’ubérisation de l’économie » visant à
- décrypter l’opinion des Français sur les nouveaux acteurs de l’économie numérique
- comprendre leurs attentes en matière de services collaboratifs.
A retenir :
- Un Français sur cinq (20%) a déjà utilisé un service issu de la nouvelle économie collaborative, lié par exemple au transport de personnes (taxi, co-voiturage) ou à l’hébergement
- 15% des personnes interrogées comptent faire appel à l’un de ces services prochainement
- la génération des 18/24 ans se trouve la plus impliquée dans ce phénomène d’adoption de masse, qu’il s’agisse d’offrir ou bien de consommer ces nouveaux services
- 21% d’entre eux ont déjà proposé du covoiturage ou offert leur appartement à une location ponctuelle
- 43% de cette tranche d’âge les utilisent déjà ou comptent les utiliser prochainement.
Le premier facteur qui explique cette courbe d’adoption globalement ascendante, c’est la confiance désormais accordée par 70% des Français aux services d’e-commerce et aux vendeurs tiers référencés sur ces sites qu’ils côtoient et utilisent depuis maintenant une bonne dizaine d’années.
Ensuite, ce sont le prix (en pole position avec 65% des suffrages) et la qualité des services proposés (citée par 44% des Français) qui font pencher la balance en leur faveur.
L’on constate par ailleurs que le recours à des services « ubérisés » s’explique aussi par la dégradation de l’offre des entreprises traditionnelles, dont 24% des 18-24 ans se disent mécontents.
D’ailleurs, une personne sur cinq ( 20%) estime que ces nouveaux services, innovants, pratiques et le plus souvent gratuits, menacent l’existence même de leurs concurrents traditionnels, qui semblent, par contraste en perte de vitesse…
Mais le constat va encore plus loin. Au-dela de l’usage personnel qu’ils peuvent faire de ces outils, les Français sont désormais enclins, pour plus de la moitié d’entre eux (55%), à partager leurs données personnelles si, à la clé, ils sont certains de bénéficier d’un service plus intéressant en termes de tarif (74%), de qualité (64%) et de personnalisation (59%).
Pour Arnaud Bouchard, Senior Vice President en charge de l’entité Marketing & Sales chez Capgemini Consulting : « Via ce sondage, les Français expriment très clairement une exigence de qualité ainsi, que le souhait d’accéder à des services innovants, renouvelés. Nous observons peut-être ici le passage d’une société de la possession à une société qui fait la part belle à l’économie collaborative, au sein de laquelle la co-création de nouveaux services ou produits avec les entreprises deviendrait monnaie courante ».
|
Pièces jointes :
- Date de Publication: 05/01/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
L'économie du partage, mise au point par des entreprises comme Airbnb et BlaBlaCar, se met en place en Europe. Cette enquête menée par ING en juillet 2015 auprès de 15 000 consommateurs dans 15 pays révèle l'effet profond que les technologies de partage pourraient avoir sur les économies dans le monde entier, avec une accélération à venir dans les 12 prochains mois.
Environ un tiers des personnes en Europe ont entendu parler de l'économie de partage (52% en Turquie, 17% en Australie et 19% en Autriche). Toutefois, la participation réelle dans l'économie du partage est beaucoup plus faible, ce qui suggère que les gens vont se familiariser avec le concept et passer très prochainement à l'action.
Environ un tiers des personnes en Europe pensent que leur participation à l'économie de partage va augmenter dans les 12 prochains mois. L'économie de partage est connue sous plusieurs autres noms, y compris la consommation collaborative et le peer-to-peer Entreprise.
Dans cette enquête, l'économie du partage est décrite aux participants comme "l'utilisation partagée des biens (tels qu'une voiture, une maison ou une tondeuse) qui serait autrement inactif ou inutilisé".
La montée en puissance du numérique joue un rôle important. Les "partageurs" sont généralement plus jeunes (moins de 35 ans) et sont bien éduqués. Ils ont tendance à être ouverts aux nouvelles technologies de paiement et disent que l'activité économique qui en découle a amélioré leur revenu dans les trois derniers mois.
Airbnb a fait les une des journaux partout dans le monde comme une force perturbatrice du modèle de logement traditionnel. Il est en réalité un modèle parmi de nombreux autres modèles de partage d'une chambre, ce qui pourrait expliquer pourquoi le logement de vacances est le bien que les propriétaires en Europe sont les plus susceptibles de partager dans les 12 derniers mois. En outre, presque la moitié - soit 49% - des propriétaires d'hébergement envisagerait de le partager contre rémunération dans les 12 prochains mois. Les vêtements sont les biens les moins susceptibles d'être partagés. La voiture est l'élément le plus partagé en Europe au cours des 12 derniers mois, mais à l'avenir, les logement de vacances seront encore plus partagés.
L'économie du partage représente encore un petit revenu pour les participants en Europe. La grande majorité des gens en Europe qui a partagé quelque chose qu'ils possèdent a gagné 1.000 € ou moins dans les 12 derniers mois. Les réponses allaient de 1 euro à 50.000 €. La moyenne était de € 2.500. Cependant, le chiffre d'affaires médian est de 300 €.
Le besoin d'économiser de l'argent joue fortement sur la consommation de biens et services dans l'économie du partage à travers L'Europe, les Etats-Unis et l'Australie. Des quatre atouts sur l'économie de partage, le fait d'économisre de l'argent est cité par le plus grand nombre de personnes comme facteur influent. Le fait qu'il soit bon pour l'environnement est également influent, comme le fait que c'est un moyen facile de faire de l'argent supplémentaire. Aider à construire une communauté arrive en quatrième position.
Des trois déclarations négatives sur l'économie du partage, c'est celle qui dit "je n'aime pas le fait que d'autres personnes utilisent mes biens" a le plus haut niveau d'accord dans L'Europe. Les soucis d'assurance sont également répandus, notamment en Espagne. La confiance dans la qualité du bien partagé est une préoccupation moins répandue, mais monte à 50% en Autriche, Pologne, Turquie et aux Etats-Unis.
|
Pièces jointes :
- Date de Publication: 05/01/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Le site de la Commission européenne a publié une note en date du 20 octobre dernier sur la libéralisation des services, intitulée "Améliorer le marché unique : de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises"
En mai 2015, la Commission a dévoilé sa stratégie pour le marché unique numérique, conçue pour relever les défis de l’économie numérique. Un marché unique numérique et connecté améliorera l’accès des consommateurs et des entreprises aux biens et services en ligne, tout en 2 créant les conditions nécessaires à l’expansion des réseaux et en maximisant le potentiel de croissance de l’économie numérique européenne.
La Commission relève que le mode de mise à disposition et de consommation de nombreux biens et services change rapidement : on assiste au développement rapide de l’économie collaborative, un écosystème complexe, fondé sur des services à la demande et l’utilisation temporaire de biens reposant sur des échanges conclus sur des plateformes en ligne. Pour les consommateurs, l’économie collaborative se traduit par une diversification des choix et un abaissement des prix, tandis que, pour les jeunes pousses du secteur de l’innovation et les entreprises européennes établies, elle est synonyme de perspectives de croissance aussi bien sur le territoire national que dans d’autres États membres. Elle accroît aussi l’emploi et bénéficie aux salariés puisqu’elle autorise une plus grande souplesse, qui va des micro-emplois non professionnels à l’entrepreneuriat à temps partiel. Les ressources peuvent être utilisées de manière plus efficiente, ce qui accroît la productivité et la durabilité.
Selon une étude récente , les cinq grands secteurs de l’économie collaborative (financement entre pairs, recrutement en ligne, location de logements entre particuliers, partage de voitures, diffusion en continu de musique et de vidéo) peuvent faire passer à 300 milliards d’euros en 2025 le chiffre d’affaires mondial, qui se situe aujourd’hui autour de 13 milliards d’euros. Un tiers des consommateurs européens déclarent qu’ils prendront de plus en plus part à l’économie collaborative.
Cependant, l’émergence de nouveaux modèles économiques a souvent des répercussions sur les marchés en place, créant des tensions avec les prestataires de biens et de services. De part et d’autre, les critiques ont trait au flou réglementaire entourant l’application des règles sur la protection des consommateurs, la fiscalité, l’octroi de licences, les normes de santé et sécurité, la sécurité sociale et la protection de l’emploi. Les réactions hâtives ou inappropriées à ces enjeux risquent de créer des inégalités et d’entraîner une fragmentation des marchés.
Face à ces difficultés et incertitudes, il convient d’agir. Il faut un environnement réglementaire clair et équilibré, qui permette à l’économie collaborative de se développer, protège les travailleurs, les consommateurs et d’autres intérêts publics, et garantisse aux opérateurs déjà établis ou aux nouveaux venus sur le marché l’absence de toute entrave réglementaire inutile, quel que soit le modèle économique qu’ils utilisent. Dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique, une analyse du rôle des plateformes, y compris dans l’économie collaborative, a déjà été engagée. Cette initiative sera complétée par d’autres études intersectorielles et la sollicitation active des opérateurs économiques, des consommateurs et des pouvoirs publics.
|
Pièces jointes :
- Date de Publication: 03/12/2015
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Comment anticiper la disruption ? Dans une récente étude de Deloitte University Press, le cabinet de conseil Deloitte tente de donner les clés pour comprendre ce phénomène afin de l’anticiper et en éviter les dommages.
En s’appuyant sur plusieurs dizaines de cas, Deloitte a recherché les modèles symptomatiques de la disruption et de ses acteurs, et, dans un second temps donne aux entreprises en place une grille d’analyse pour tenter de prédire le cataclysme avant son avènement sur son marché.
Etudier la vulnérabilité
Pour Deloitte, éviter le désastre, c’est d’abord étudier la vulnérabilité de son marché et en imaginer les contre-feu en se posant les bonnes questions à des fins d’actions. En guise d’exemple générique, Deloitte prend comme exemple Kodak. Firme emblématique du ratage absolu en n’ayant pas vu arriver la photo numérique malgré son invention par un de ses employés. D’où cette question lancinante posée par tous les décideurs, « Comment Kodak n’a-t-il pas vu arriver la photo numérique ? », avec en corrélat, « En quoi cette technologie était-elle si disruptive qu’elle a ébranlée Kodak, pourquoi Kodak n’a pas réagi et comment se fait-il qu’elle n’ait pas pu se relever de cette rupture ? »
Pourquoi la disruption est-elle si difficile à identifier ?
Le problème avec la disruption peut se résumer simplement : elle n’est identifiable qu’une fois son action réalisée. Donc trop tard. Repensons à l’Encyclopédie Universalis, leader sur Internet jusqu’à l’explosion de Wikipedia. Aujourd’hui, un directeur d’hôtel voit-il Airbnb comme potentiel disrupteur ? Si oui, quelle réponse y apporter ? Etudier la stratégie d’Accord ou d’Expedia peut être une piste intéressante.
Avant toute analyse, Deloitte modélise l’entrée des disrupteurs sur un marché et les pertes occasionnées par ces nouveaux entrants. Il y a 5 façons pour les nouveaux entrants d’occuper le marché :
– Déplacement du marché : par exemple Amazon qui bouscule la filière traditionnelle de l’édition en offrant un meilleur service au détriment de la rentabilité recherchée par les acteurs traditionnels.
– Attaque du marché par plusieurs acteurs
– Occupation d’une large part de marché par les nouveaux entrants
– Création d’un nouveau marché qui cohabitera avec le marché traditionnel
– Consolidation entre nouveaux entrants et occupation du marché. Mort des autres.
Les analyses techno-économiques sur les nouveaux entrants sont aujourd’hui relativement complètes, on peut se reporter aux écits de Nicolas Collin ou Bernard Stiegler. Toutefois, l’identification de la menace à venir reste problématique. Pour tenter d’identifier le danger, Deloitte a dégagé 9 leviers de disruption
Les analystes reconnaîtront dans ce schéma les leviers utilisés par bon nombre de licornes à savoir :
– L’effet de réseau : profiter de la traction offerte par les réseaux dont la valeur est égale au carré du nombre d’utilisateurs.
– Utiliser les actifs sous potentialisé (les appartements pour Airbnb)
– Plateformiser : créer une plateforme de type marketplace ou lieu de médiation
– Connecter la communauté : via les applications et réseaux sociaux
– Mobiliser la communauté pour créer le produit : crowsourcing/crowdfunding
– Découpler produit et services et favoriser l’usage
– Raccourcir la chaîne de valeur : désintermédier
– Fixer le bon prix selon le service rendu
– Faire converger les produits pour que la valeur soit supérieure à la somme des parties
Malgré sa simplicité, cette matrice ne serait pas complète sans une étude du contexte et de ce que Deloitte appelle les catalyseurs. A titre d’exemple, si la photo numérique a émergé, c’est aussi parce que le contexte technique et économique le permettait. Technique avec l’industrialisation des appareils photos (et la baisse de prix associée), l’extension du parc de PC, et le coût marginal de zéro offert par la duplication des photos. Un phénomène similaire a celui connu par le marché de la musique. Bien sûr, les catalyseurs sont nombreux et touchent à tous les secteurs : économie, technologies, droit public et privé, politique publiques, comportement clients etc.
Dans tous les cas, la disruption viendra toujours d’un lieu hors du champ de vision de l’entreprise. En second lieu, en guise de leçon, Deloitte met en garde contre la crispation sur les modèles anciens sur lesquels l’entreprise à tendance à fonder ses analyses stratégiques et qui l’empêche de voir venir la menace tout en gardant le statu quo. Pour Deloitte, les entreprises qui réussissent la transition sont celles qui sont à la fois optimistes et humbles, mais qui sont conscientes que l’entreprise doit sortir de ses modèles et de son inertie, certes garants du succès passé, mais tout autant de l’échec futur. Autrement dit, les dirigeants doivent sortir du cadre et de leur zone de confort intellectuel pour endosser de nouveaux modèles de pensée et d’analyse.
En dernier lieu, Deloitte livre 3 réponses possibles envers la disruption
- Contenir ou sortir : l’entreprise peut céder une partie de son marché pour en exploiter un autre pan plus rentable. Une possibilité si l’entreprise est dans le bon timing de sortie.
- Etre le disrupteur : difficile, mais chaque barrière est surmontable si la dynamique prévisionnelle du marché est positive et autorise l’entreprise a anticiper le changement et les lignes de revenus.
- Saper le disrupteur : selon la configuration du marché et des leviers utilisés par le disrupteur, l’entreprise peut tenter un court-circuit en minimisant l’effet attendu.
|
Pièces jointes :
- Date de Publication: 03/12/2015
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Difficile d’échapper ces derniers mois à « la folie de l’ubérisation ». Pas un jour ne se passe, en effet, sans que cette thématique ne soit abordée dans les médias, qu’ils soient professionnels ou grand-publics. Et pourtant ce mot d’ubérisation a moins d’un an !
Depuis, ce terme a tendance à être utilisé à toutes les sauces et le moindre acteur innovant est immédiatement présenté comme le futur ubérisateur de la profession dans laquelle il intervient (ubérisateur devant ici être entendu comme un synonyme très proche de fossoyeur). In fine, l’effet anxiogène est garanti pour les acteurs historiques des secteurs d’activité concernés. Difficile, en effet, de se protéger d’une menace que l’on peine à qualifier….
Cette étude menée le par le Think Tank "Les Moulins" est née de la volonté des membres du comité de pilotage d’y voir plus clair sur ce concept d’ubérisation et sur les menaces réelles ou supposées qu’il représente pour la profession comptable.
L’objectif est :
- de fournir une grille d’analyse rigoureuse permettant de catégoriser les différentes sortes d’innovateurs qui gravitent dans et autour de la profession. Sont-ils tous des ubérisateurs en puissance ? Sont-ils tous des menaces pour la profession ? Comment s’en protéger, voire même s’en inspirer ? Etc. Les innovateurs de rupture, que nous avons regroupés sous le terme de « barbares » dans le cadre de cette étude sont en effet loin d’être une population homogène. Les catégoriser a été notre première ambition.
- d’aider le lecteur à prendre la mesure des menaces et opportunités que ces différents types de barbares font naître dans la profession. Car si la face obscure des barbares est bien souvent mise en avant, il ne faut pas oublier que les barbares ont également des aspects extrêmement positifs trop souvent ignorés.
Afin de compléter nos analyses des évolutions en cours au sein de la profession comptable, l'enquête a été réalisée auprès des professionnels du secteur. Celle-ci a permis de « prendre le pouls » du terrain sur ces phénomènes de barbarisation, d’ubérisation, d’automatisation… Les principaux résultats de cette enquête réalisée au cours de l’été 2015 sont présentés dans le cadre de cette étude.
L'étude est trés complète et aborde, pour la première fois, la différenciation entre les "barbares" : différenciateur, lowcoster, automatisateur, uberisateur, neodistributeur et connecteur
Tous les secteurs de l’économie sont impactés par les barbares et, ce, dans le monde entier. Comment imaginer que la profession comptable française fasse exception ? La profession va, dans des délais très courts, traverser une période de turbulences fortes liée à l’arrivée de nouvelles solutions technologiques.
Au-delà des mots, l’impact le plus probable sur la profession n’est pas celui de l’ubérisation (se faire remplacer par des acteurs extérieurs à la profession), peu probable en pratique, mais celui de l’automatisation (remplacer du temps homme par du temps machine).
C’est fondamentalement différent et de meilleur présage pour les experts-comptables. En effet, l’automatisation libère les cabinets de tâches sans valeur ajoutée et leur permet de se consacrer à des activités plus créatrices de valeur, plus fidélisantes, plus rémunératrices.
|