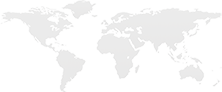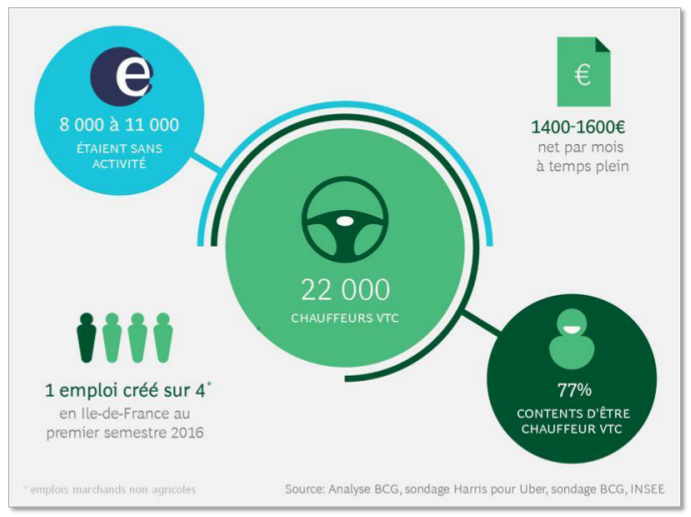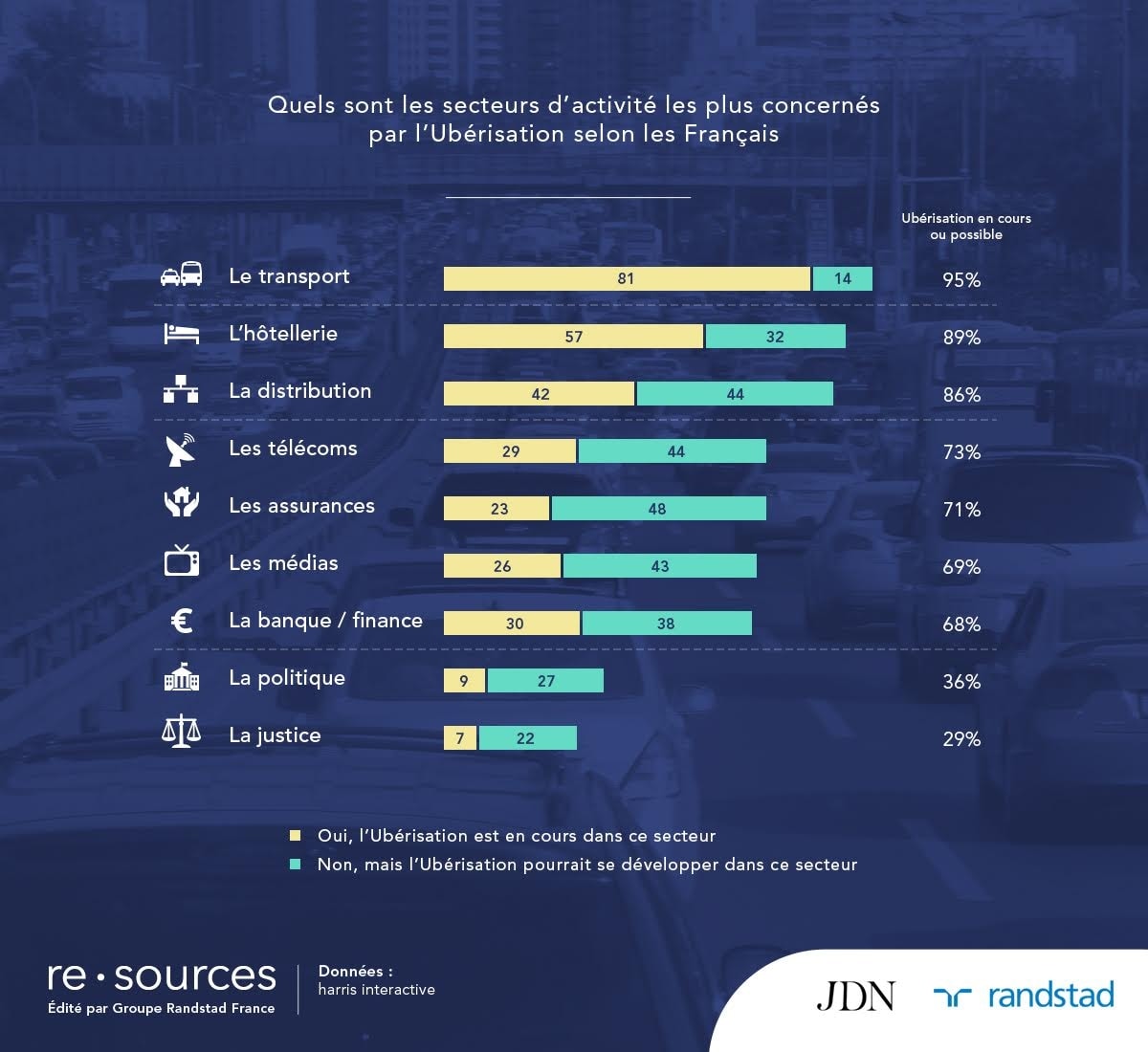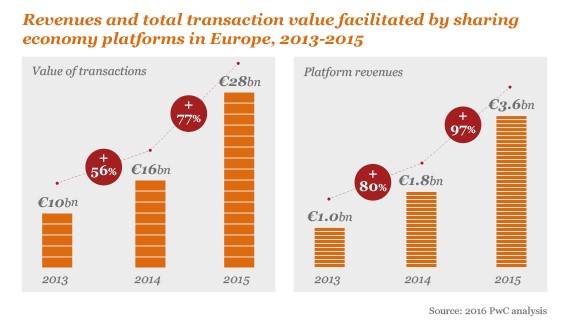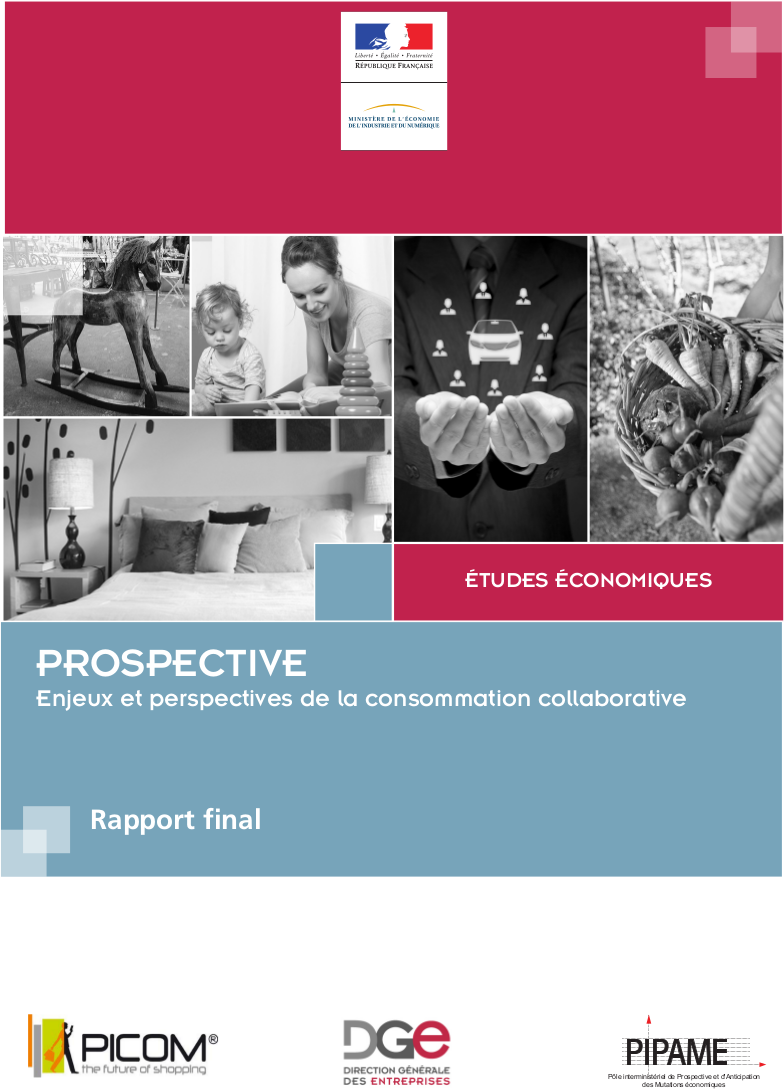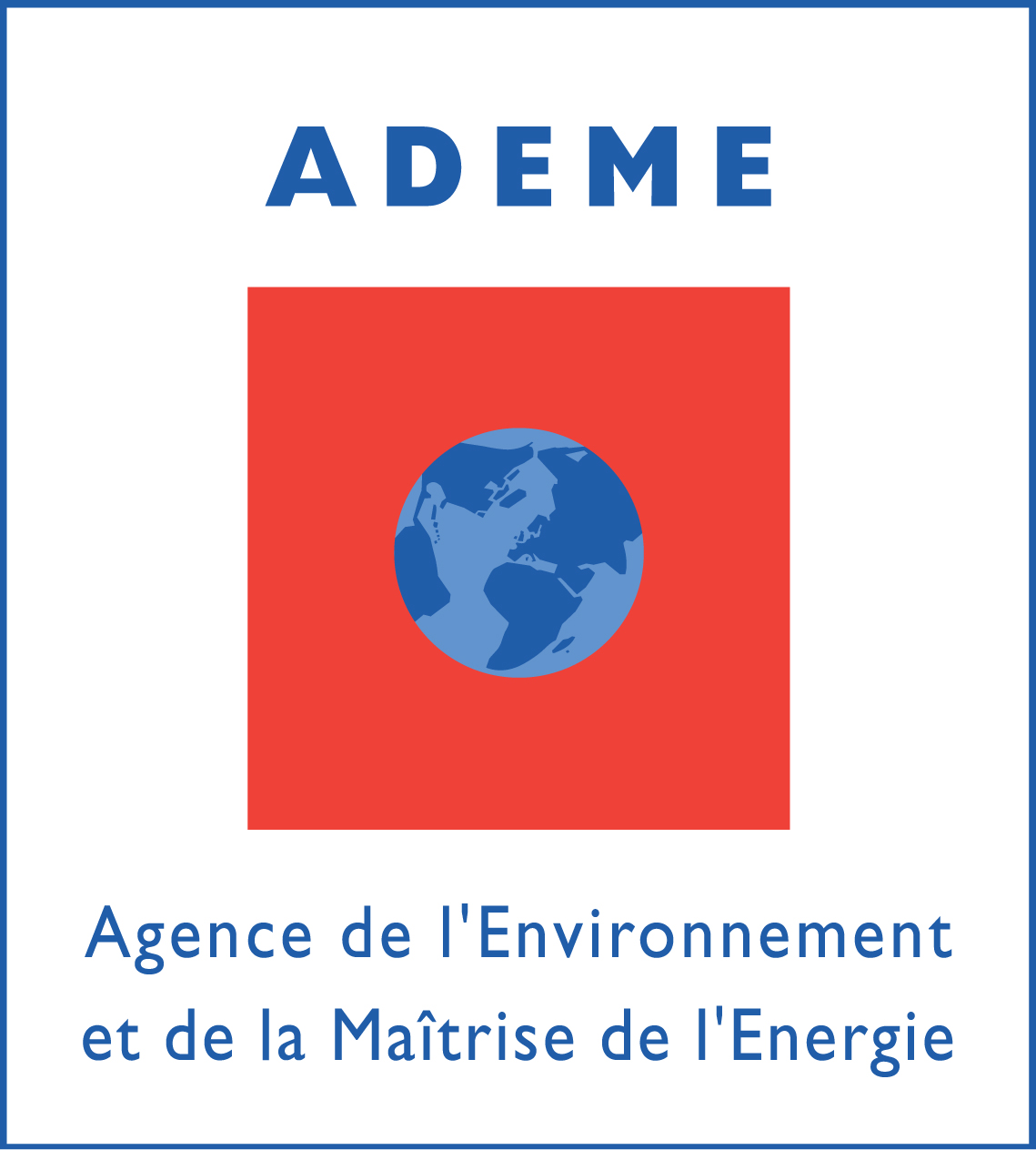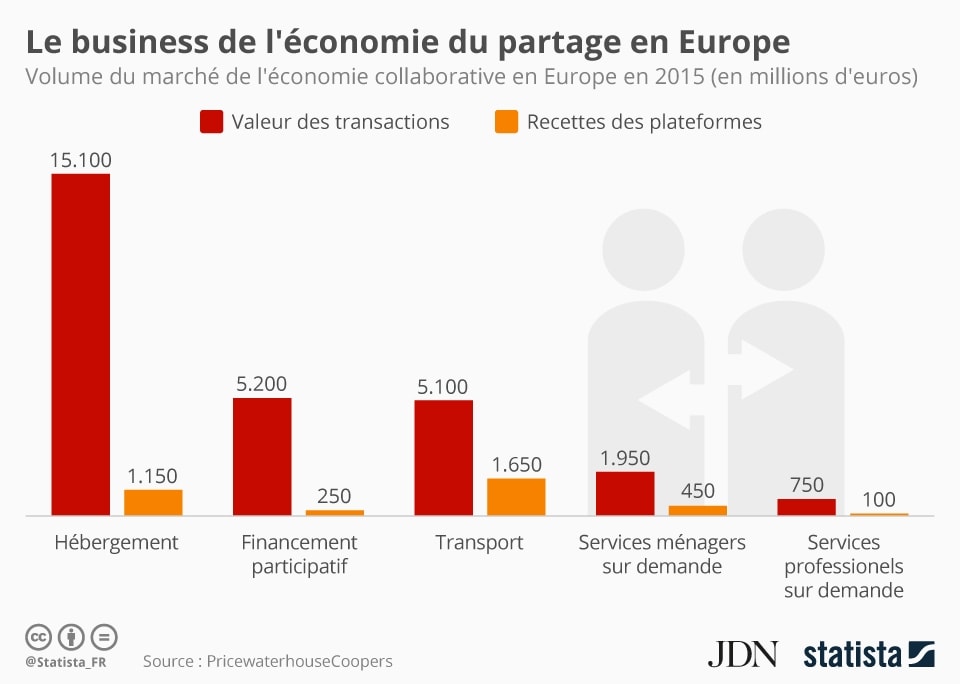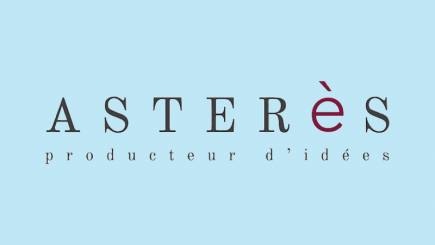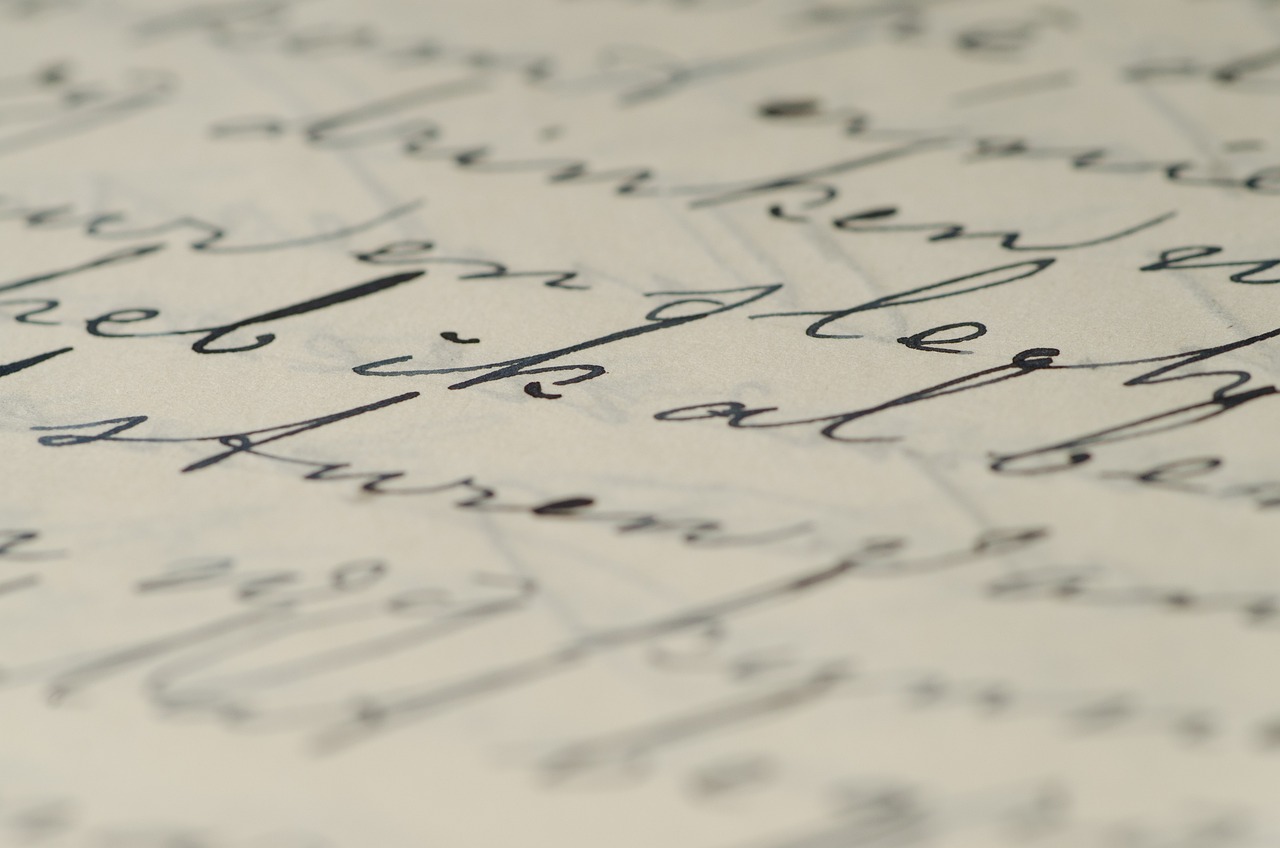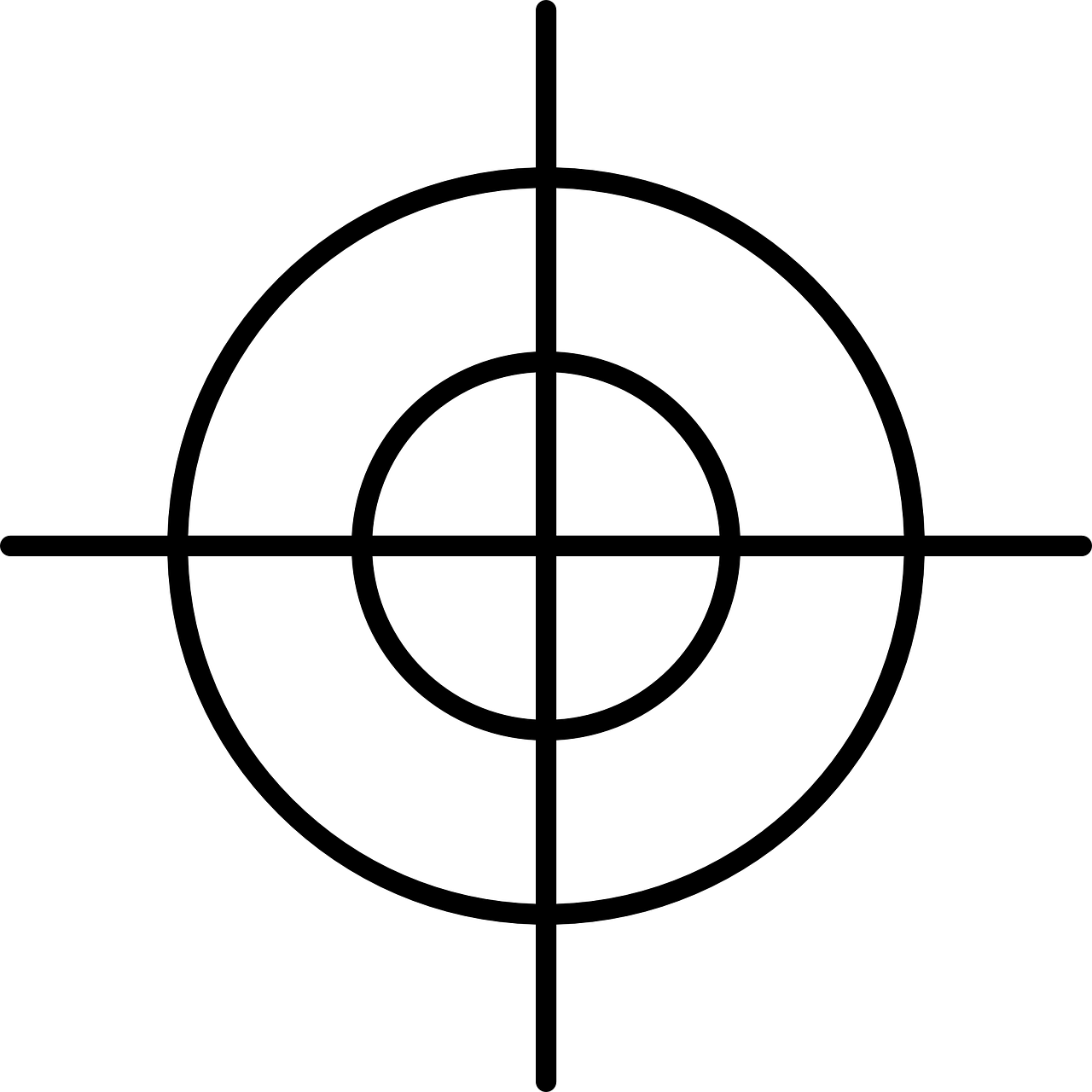En application de l'article 12 du CGI, les revenus réalisés par les particuliers dans le cadre de leurs activités de toute nature sont en principe imposables, y compris les revenus de services rendus à d'autres particuliers avec lesquels ils ont été mis en relation par l'intermédiaire notamment de plates-formes collaboratives.
Toutefois, il est admis de ne pas imposer les revenus tirés d'activités de "co-consommation" qui correspondent à un partage de frais à condition qu'ils respectent les critères cumulatifs suivants liés à la nature de l'activité et au montant des frais partagés.
Lorsque ces critères ne sont pas respectés, le revenu réalisé constitue un bénéfice imposable dans les conditions de droit commun applicables à la cédule d'imposition correspondante (ainsi, sont retranchées de ce revenu les seules dépenses nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel).
1. Première condition : revenus perçus dans le cadre d'une "co-consommation" entre particuliers
Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l'exonération sont ceux perçus dans le cadre d'une "co-consommation", c'est-à-dire d'une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis.
N'entrent pas dans le champ de la "co-consommation" et donc de l'exonération, les revenus qui sont perçus par des personnes morales, ni les revenus qui sont perçus par des personnes physiques dans le cadre de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité professionnelle.
Ne bénéficient pas non plus de cette exonération les revenus tirés par un contribuable de la location d'un élément de son patrimoine personnel comme, par exemple, la location de son véhicule de tourisme ou la location, saisonnière ou non, de sa résidence principale ou secondaire.
2. Deuxième condition : nature et montant des frais
Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l'exonération s'entendent des revenus, perçus dans le cadre d'une "co-consommation", qui n'excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation objet du partage de frais, part du contribuable non comprise.
Cette condition relative au montant perçu doit être appréciée strictement : le montant perçu ne doit couvrir que les frais supportés à l'occasion du service rendu, à l'exclusion de tous les frais non directement imputables à la prestation en question, notamment les frais liés à l'acquisition, l'entretien ou l'utilisation personnelle du ou des bien(s), support(s) de la prestation de service partagée.
En outre, les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service. En effet, les notions de partage de frais et de "co-consommation" supposent que cette personne supporte personnellement sa propre quote-part de frais et ne bénéficie d'aucune forme de rémunération, directe ou indirecte, au titre de la prestation qu'il rend et dont il bénéficie en même temps. En d'autres termes, le contribuable qui propose une prestation dont il partage les frais compte pour une personne dans le calcul des frais à partager.
Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au premier euro.
3. Activités concernées et utilisation de barèmes
Peuvent notamment bénéficier de la présente exonération les revenus tirés du partage de frais dans le cadre des activités suivantes, qu'elles soient ou non réalisées par l'intermédiaire de plates-formes Internet :
- co-voiturage ;
- sorties de plaisance en mer ;
- organisation de repas (ou "co-cooking").
Il est admis d'exonérer l'activité consistant pour un particulier à proposer des sorties de plaisance en mer avec d'autres particuliers, sous la condition que la somme demandée à chaque participant corresponde à une participation aux seuls frais directement occasionnés par l'expédition, soit les frais de carburant, de nourriture, d'amarrage et de rémunération du personnel de bord pendant ladite expédition.
Il est également admis de ne pas imposer les revenus tirés du "co-cooking" consistant pour un particulier en l'organisation à son domicile de repas dont il partage les seuls frais de nourriture et de boisson avec les convives et pour lesquels il ne reçoit aucune autre rémunération.
Remarque : Les pratiques de livraison payante de repas par lesquelles un particulier fournit des repas à des consommateurs qui les récupèrent à leur domicile ou à celui du cuisinier ne constituent pas des prestations de service partagées et ne peuvent bénéficier de la présente mesure.
Les revenus tirés de l'activité de covoiturage peuvent également bénéficier de l'exonération.
Aux termes de l'article L. 3132-1 du code des transports, le covoiturage se distingue des activités de taxi et de voitures de transport avec chauffeur en ce qu'il consiste en l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.
L'activité de covoiturage ainsi définie pratiquée entre particuliers relève des activités de "co-consommation" exonérées, sous réserve que le prix proposé couvre les seuls frais directement supportés à raison du déplacement en commun (carburant et péage).
Remarque : L'activité de covoiturage doit être distinguée de l'activité de location de véhicules. La seconde activité ne requérant pas la participation personnelle du propriétaire, elle ne relève pas des activités de "co-consommation" et est imposable dans les conditions de droits commun.
Pour plus de précisions sur le régime fiscal des particuliers se livrant à une activité de location de véhicules, RM Teissier n° 52946, JO AN, 24 mai 2016, p. 4505.
Le contribuable doit être en mesure de justifier l'itinéraire parcouru dans le cadre de son activité de covoiturage, ainsi que les frais correspondants.
A titre de règle pratique, il est admis que le contribuable puisse appliquer le barème kilométrique forfaitaire pour évaluer le coût total de son activité. Il existe deux barèmes, l'un pour les véhicules de tourisme, l'autre pour les véhicules deux roues motorisés publiés au BOI-BAREME-000001.
Il s'agit alors d'une évaluation forfaitaire exclusive de tout autre frais.
Par ailleurs, comme exposé au II-A-2 § 70 à 80, le partage des frais ne doit porter que sur les frais qui excèdent la quote-part du conducteur.
Exemple : Un particulier habitant en région parisienne se rend tous les week-ends dans sa résidence secondaire située à Rennes. Sur une plate-forme spécialisée dans le covoiturage entre particuliers, il propose ce trajet dans la limite de 2 places disponibles. La puissance fiscale du véhicule de tourisme est de 6 CV. Le carburant utilisé est du super sans plomb :
- nombre de kilomètres parcourus par trajet : 360 km ;
- frais de péage inhérents au trajet : 29 € ;
- barème forfaitaire pour un véhicule de 6 CV: 0,568 € / km ;
- évaluation forfaitaire du trajet : 360 x 0,568 = 204,48 € ;
- nombre de places disponibles : 2.
Si le contribuable souhaite recourir au barème kilométrique, le coût du trajet par personne s'élève à 204,48 / 3 = 68 € .
Si le prix proposé sur la plate-forme n'excède pas 68 € par personne, le revenu ainsi réalisé est exonéré.
4. Obligations des contribuables
Les revenus perçus dans le cadre du partage de frais qui sont exonérés à ce titre ne sont soumis à aucune obligation déclarative pour les contribuables concernés.
Bien entendu, l'absence d'obligation déclarative ne dispense pas les contribuables de conserver tous les éléments et pièces de nature à justifier du bien-fondé de l'exonération, ces éléments et pièces devant être fournis à l'administration sur sa demande.
Précision relative à la déduction de certains frais selon un mode réel.
Lorsque des frais sont partagés, mais font par ailleurs l'objet d'une déduction du revenu imposable du contribuable pour leur montant réel, il est précisé que cette déduction ne peut être effectuée que pour le montant net des remboursements perçus.
Dans le cas du covoiturage, cette règle vise les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail du contribuable, qui peuvent faire sous certaines conditions l'objet d'une déduction selon un mode réel des revenus imposables en catégories des traitements et salaires (BOI-RSA-BASE-30-50-30-20), des bénéfices industriels et commerciaux (BOI-BIC-CHG-40-20-40), des bénéfices agricoles (BOI-BA-BASE-20-30-50) ou des bénéfices non commerciaux (BOI-BNC-BASE-40-60-40).
En cas de partage de frais, seul le montant des frais qui demeure à la charge personnelle du contribuable une fois le partage effectué peut donc être déduit du revenu professionnel.
Cette règle ne concerne pas les personnes dont les frais et charges ne sont pas déduits pour leur montant réel, mais par un abattement forfaitaire (la déduction forfaitaire de frais professionnels de 10 % pour les salariés, les abattements forfaitaires représentatifs de frais des régimes "micro-BIC", "micro-BNC" ou "micro-BA" pour les indépendants).