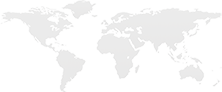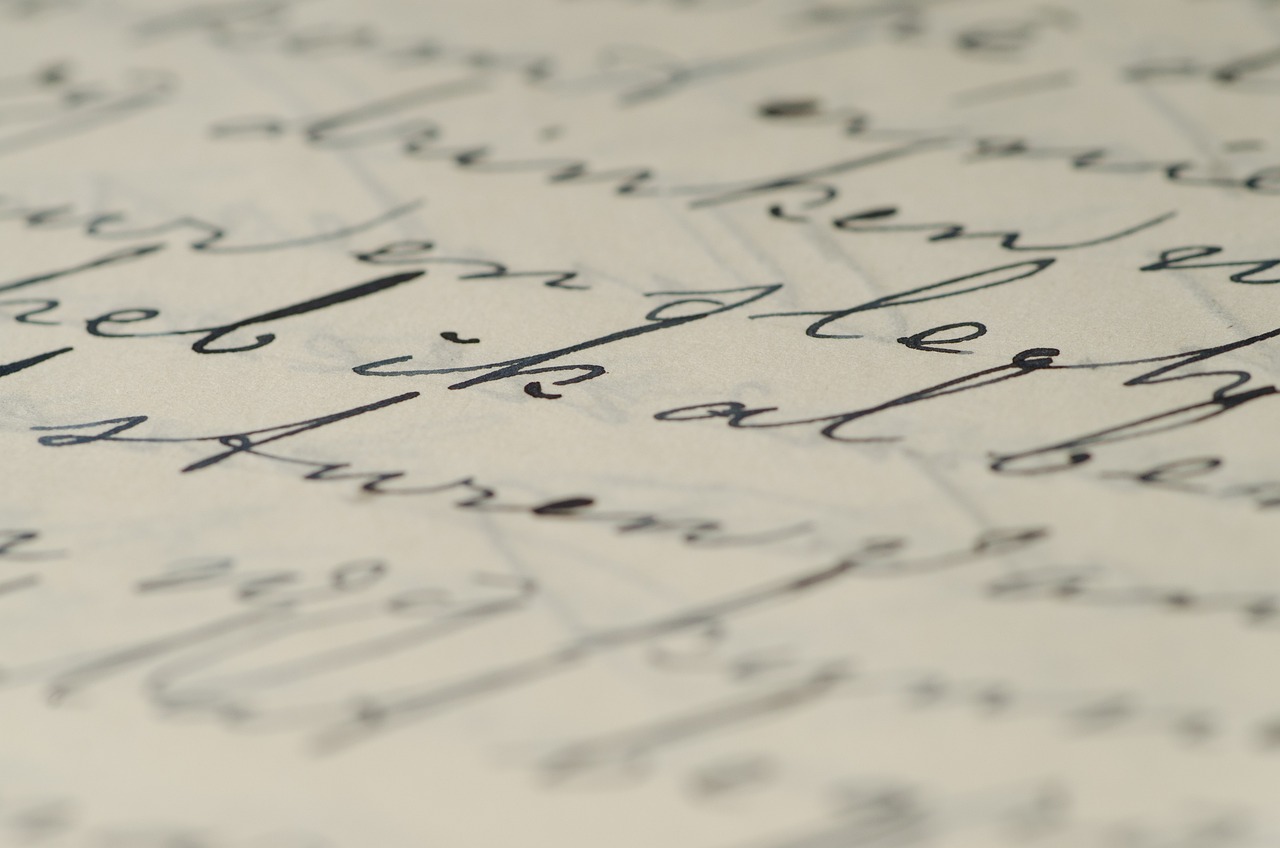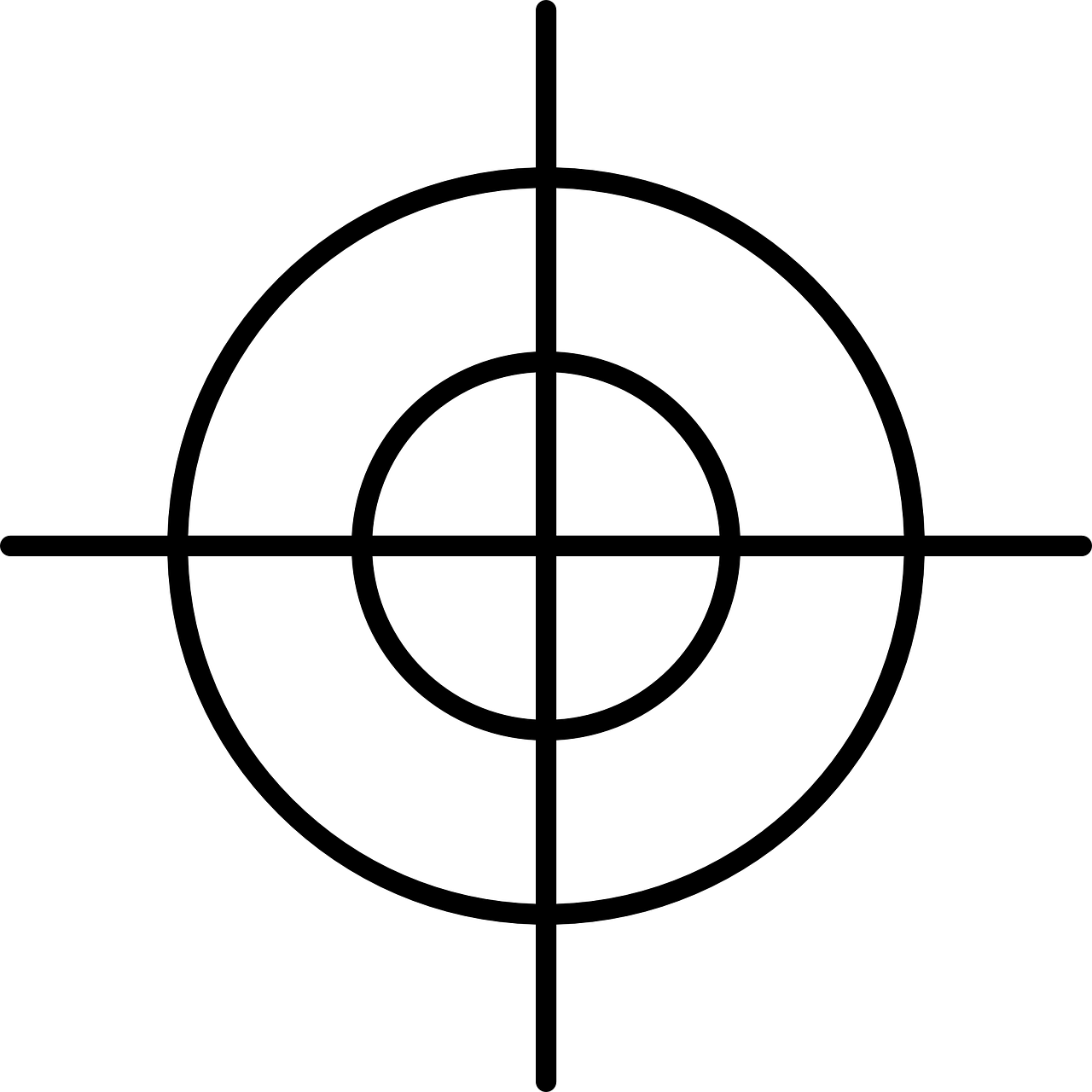- Date de Publication: 29/04/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
|
- Date de Publication: 21/03/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Nathalie Chiche est rapporteure de l’étude « Internet : pour une gouvernance ouverte et équitable » du Conseil économique sociale et environnemental, et membre du comité de pilotage de l'Observatoire e l'Ubérisation.
Une nouvelle page s’ouvre cette semaine dans le conflit qui oppose les taxis et les VTC. Une semaine après la manifestation des taxis, les chauffeurs de véhicule de tourisme (VTC) manifesteront ce mercredi 3 février.
Face à ce nouveau conflit qu’on pensait réglé, après la loi Thévenoud interdisant notamment aux VTC d’être repérées par les clients depuis leurs smartphones, le gouvernement a nommé Laurent Grandguillaume comme médiateur, afin de trouver durablement une solution.
Rappelons que la médiation est un mode alternatif – confidentiel et volontaire - de règlements des conflits, encore trop peu utilisée en France au profit des procès. Ce processus consiste à faire appel à un tiers neutre et impartial, le médiateur.
Le fait que le médiateur soit nommé par l’État, indépendamment des qualités démontrées de Laurent Grandguillaume dans le conflit des « poussins » [en 2013-2014], pose le problème de l’impartialité de la médiation en cours.
En effet, il y a trois parties « médiées » - concernées - dans ce conflit :
- Les taxis qui, au départ, ont bénéficié d’une rente, celle des licences accordées gratuitement au compte-gouttes par l’État, leur conférant de fait un monopole. Devenir taxi devenait de plus en plus cher au fur et à mesure des départs à la retraite des anciens qui cédaient leur licence à prix d’or (près de 200 000 euros) ;
- Les VTC, qui répondaient à un vrai besoin des utilisateurs de taxis, face à leur raréfaction. L’avènement du numérique avec les outils comme les smartphones, les applications et la géolocalisation d’une part ; la mise en place de plateformes mettant en relation une offre et une demande, ont laissé le champ à leur expansion qui change définitivement l’économie de services traditionnelle ;
- L’État, qui ne peut empêcher l’innovation sans se soustraire à sa responsabilité dans la réforme des taxis.
Par ailleurs, outre le caractère volontaire des parties, la confidentialité et la neutralité sont des conditions essentielles, avec l’impartialité du médiateur, pour conduire une médiation dans les règles de l’art.
Aussi, il est préjudiciable, pour la suite de la médiation qui oppose taxis et VTC, que le député Laurent Grandguillaume fasse part de son point de vue sur le réseau social Twitter ce week-end à propos du conflit dont il est le médiateur. Et en s’en prenant directement aux plateformes numériques qui, je le cite, « veulent imposer leur monde sans règle à la République, la République sera toujours plus forte ».
Pendant une médiation en cours, le médiateur ne stigmatise jamais une partie contre l’autre, au risque d’être partial. Or, l’État a assurément un rôle déterminant dans ce conflit dont il est partie prenante.
Aussi, il convient de nommer très rapidement un médiateur externe au conflit afin de reprendre une médiation sur ses principes fondateurs : impartialité, confidentialité et neutralité.
La souffrance légitime des taxis et l’incompréhension des VTC qui se voient comme les boucs émissaires d’une économie numérique en marche, sont de la responsabilité de nous tous, à commencer par l’État.
|
- Date de Publication: 18/03/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Pierre Aïdan, Co-fondateur @ Legalstart.fr. Ancien avocat aux barreaux de Paris et de New York, docteur en droit et diplômé de l'Université de Harvard, Pierre Aïdan a co-fondé le site legalstart.fr, 1ère plateforme de services juridiques en ligne à destination des TPE/PME. Legalstart.fr permet aux entrepreneurs de faire eux-mêmes un certain nombre de démarches juridiques simples : créer une société (SAS, SASU, etc.), embaucher un salarié, recouvrer une créance ou encore déposer une marque.
Margaux Dalon, diplômée de l’EDHEC Business School et de la faculté libre de droit de Lille
Après le secteur du transport de personnes, de la location saisonnière ou encore de la finance, le secteur des services juridiques serait à son tour sur le point d’être « ubérisé ». Certains y voient les prémices d’une atomisation du droit, voire de la disparition pure et simple des avocats, notaires et juristes en général. La réalité d’aujourd’hui et de demain est probablement toute autre.
L’« Ubérisation » n’est pas un concept aux contours bien définis et fait l’objet de débats sémantiques. Cela étant dit, il existe un certain consensus autour de l’idée selon laquelle le phénomène « d’Ubérisation » redéfinirait le mode de fonctionnement et les règles de concurrence de la plupart des secteurs d’activité. L’origine de cet effet disruptif ? L’entrée de nouveaux acteurs qui, grâce à l’usage qu’ils font des technologies numériques, offrent un accès à moindre coût à certains services. Mais ce phénomène ne doit pas nécessairement être interprété comme la mort annoncée des acteurs traditionnels d’un marché, mais plutôt comme une redéfinition de l’ordre et des régulations établies sur celui-ci. Cela est particulièrement vrai, selon nous, dans le domaine juridique.
Sous l’impulsion d’un nombre croissant de start-up et autres entreprises innovantes, le marché du droit se trouve en effet confronté à une véritable transformation structurelle. Les professions juridiques réglementées connaissent aujourd’hui la mutation la plus radicale depuis celle engendrée par la fusion des professions juridiques dans les années 1990.
Le développement des nouvelles technologies promet de transformer de manière profonde les méthodes et formes de travail des professionnels du droit : justice prédictive, moteurs de recherche juridique, gestion automatique et dématérialisée des procédures juridiques, outils de gestion de données juridiques, blockchains, intelligence artificielle, etc. Aujourd’hui, l’accès aux services juridiques se fait de plus en plus à partir d’une requête Web et la récurrence et standardisation de certaines tâches valident une approche logicielle ou numérique du droit.
Cela étant dit, l’essor du numérique n’entraine toutefois en rien une remise en cause de l’existence des acteurs traditionnels. Bien au contraire, le recours aux technologies numériques contribue à remodeler la chaîne de valeur des praticiens du droit. Plus précisément, il s’agit de repositionner le juriste là où il est susceptible de fournir une plus forte valeur ajoutée, à savoir sur des missions d’expert et de stratège du droit.
L’« Ubérisation » n’est en soi, ni bonne ni mauvaise : elle implique simplement des changements structurels qui convient d’analyser individuellement. Autrement dit, l’impact du numérique dans le domaine juridique mérite, selon nous, donc d’être compris et accompagné plutôt que subi et antagonisé. A cet égard, le partenariat récemment mis en place entre Legalstart.fr et le réseau de notaires NCE matérialise, pour la première fois en France, une approche collaborative entre legaltechs et professions réglementées. En mettant à disposition des notaires une plateforme numérique permettant de simplifier la création d’entreprise, NCE et Legalstart.fr s’associent pour servir l’internaute de la manière la plus efficiente et sécurisante possible.
Prédire l’impact futur des technologies numériques sur les professions du droit est hasardeux. Constater le recours massif des français aux solutions Web dans le domaine juridique et réfléchir, aux côtés des professionnels du droit, au meilleur service pour le justiciable est indispensable. L’essor du numérique ne signifie en rien l’appauvrissement ou la disparition des avocats, notaires, huissiers et autres professionnels du droit. Sans écarter les débats nécessaires qui devront avoir lieu sur les modalités d’intervention des legaltechs et autres acteurs de l’innovation juridique (éthique, concurrence), les transformations actuelles du secteur peuvent aussi être vues comme génératrices d’opportunités et de croissance pour les acteurs français.
|
Pièces jointes :
- Date de Publication: 09/03/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Comme chaque année, la sécurité privée était à l’honneur lors du congrès de l’International Association of Security and Investigative Regulators (IASIR), organisé en novembre à la Nouvelle Orléans. Occasion pour Cédric Paulin, adjoint du directeur de cabinet au Conseil national des activités privées de sécurité, de dresser une synthèse des thèmes qui animent les régulateurs de la sécurité privée outre-Atlantique : le rôle de la sécurité privée en matière de gestion de crise, et notamment de catastrophes naturelles, les évolutions du métier des détectives privés confrontés au défi de l’« uberisation ». L’auteur en tire des enseignements pour le métier en général mais aussi pour l’univers de la sécurité privée hexagonale. Parmi ces enseignements, le rôle du transfert d’informations dans l’inéluctable coproduction de sécurité. 2015, nous rappelle Cédric Paulin, a vu la France entamer son rattrapage en matière de normalisation dans la sécurité privée. Cette prise en compte de la normalisation constitue une étape importante de la coproduction de sécurité.
Pour la deuxième année, la France était présente au congrès annuel de l’International Association of Security and Investigative Regulators (IASIR), qui se tenait du 11 au 13 novembre, à La Nouvelle Orléans1 . Etaient représentés les responsables des services de régulation de la sécurité privée de plus d’une dizaine d’Etats des Etats-Unis, du Bureau de la sécurité privée du Québec, des représentants de l’industrie de la sécurité privée et des détectives privés, ainsi que le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), même si la France n’est pas membre de l’IASIR. Il s’agit alors de dresser, par touches, un compte rendu synthétique des sujets traités lors de ce congrès, au regard ou à la différence de ceux existants en France ou en Europe, afin de tracer les contours d’une «big picture» future en matière de sécurité privée. Cette «big picture», que les attentats qu’a connus la France rendent d’autant plus urgente, passe par la coproduction -public-privé, par l’évolution de la régulation et l’économie de l’information appliquée à la sécurité privée. L’implication de la sécurité privée dans la gestion de crise et les évolutions concernant le métier de détectives privés ont notamment été traitées par le congrès de la Nouvelle Orléans, comme l’indiquaient d’ailleurs parfaitement le titre : « Regulation in the eye of the storm. Private Investigators, Security, Regulators: Partners in Emergency Preparedness and Disaster Response». Rôle de la sécurité privée lors d’une catastrophe naturelle Les retours d’expérience de la gestion de l’ouragan Katrina ayant touché La Nouvelle Orléans en 2005 ont montré – les forces de police et services d’urgence l’ont indiqué elles-mêmes lors des conférences – que la sécurité privée avaient dû être utilisée de manière obligatoire, et cela, pour une raison simple : près de 90 % des forces publiques et services d’urgence étaient indisponibles. La durée de la crise, la gestion des priorités innombrables, les phénomènes de pillage, même sporadiques, et la nécessité de redémarrer la vie sociale et économique ont nécessité la mobilisation de l’ensemble des ressources humaines un tant soit peu concernées parla sécurité, y compris donc, naturellement, la sécurité privée. Si cette leçon a été relativement comprise après cet événement, il a fallu davantage de temps pour conceptualiser puis concrétiser des solutions relatives à une gestion globale de crise, à la sécurisation et la surveillance d’une zone sinistrée. Ici, les conférences de l’IASIR ont apporté des éléments relatifs à la « réentrée » dans une zone de crise que l’on pourrait aussi définir comme un «contrôle d’accès d’urgence en zone de crise». Lors de ces trois jours, penser l’application de ce concept à la France est apparu plus complexe : la France ne connaît pas d’événements climatiques d’ampleur géographique et temporelle comparables à l’ouragan Katrina à La Nouvelle Orléans. Toutefois, les inondations récentes dans le Sud de la France et les attentats du 13 novembre à Paris rendent les notions de « zone de crise », de « zone de crise à contrôle d’accès d’urgence» et de «réentrée» davantage compréhensibles. Il devient indispensable de concevoir, des niveaux locaux au niveau national, pour le privé comme le public, des plans et pratiques de gestion de crise, qu’elle soit d’origine naturelle ou malveillante, qui incluent la sécurité privée. Aux niveaux locaux et privés, les entreprises, par le biais des directeurs de la sécurité, le cas échéant, sont sans doute déjà engagées dans cette voie (a minima elles ont une partie de la structure – le directeur de la sécurité en personne justement – pour le faire). Dans le secteur public, aux niveaux locaux comme au niveau national, rien de tel n’est encore prévu, hormis quelques dispositions en matière de réquisition mais jamais expertisées ni prévues initialement pour la gestion de crise. Ces réflexions et cette mise en place de dispositions spécifiques seront d’ailleurs de nature à faciliter l’articulation de la sécurité privée et des forces publiques, y compris en temps plus serein ou moins critique. A l’inverse, les habitudes de travail conjoint en période calme favoriseront aussi le travail conjoint en période plus intense.
Rôle des détectives privés à l’heure de l’«uberisation»
Une partie des conférences de l’IASIR a aussi porté sur les détectives privés, notamment leur rôle et ce qui les distingue des agents d’assurance, ainsi que leur rôle dans la gestion de crise et la résilience. En France, ce domaine est peu exploré, ou du moins n’est pas mis à la pointe de l’évolution et de la professionnalisation du secteur de la recherche privée. Surtout, l’IASIR a soulevé la question de l’«uberisation» des détectives privés, à travers la création récente, en février 2015, de Trustify, application pour smartphone. L’application Trustify met en relation des détectives privés et des clients, selon leur géolocalisation le type de services recherchés (adultère, vérification de la sécurisation de ses enfants, localisation d’une personne, vérification des antécédents d’une personne, enquête en matière de fraude, diagnostic de sécurité, clientmystère). Ces clients précisent leur adresse et leurs besoins sur l’application qui leur propose dès lors une liste de détectives préalablement référencés (environ 2000). Or, Trustify ne demande actuellement pas de licence pour exercer dans les Etats qui disposent d’un régime de licence. Son fondateur indique ne fournir qu’un service de courtier et de mise en relation entre une demande et une offre. Certains Etats, parmi les plus impliqués dans la régulation de la profession, indiquent cependant que Trustify fournit au moins une prestation de conseil de sécurité, et donc devrait justifier d’une licence. La question du flux financier entre le client, le détective privé et Trustify, peu identifié, est aussi posée comme un critère de la nécessité ou pas de posséder une licence. Trustify refuse catégoriquement de s’inscrire dans la tendance de «l’uberisation» appliquée aux taxis (en France comme aux Etats-Unis), car les détectives privés référencés sont eux, à la diffé- rence des particuliers utilisant leur voiture comme taxi et hors de tout examen, autorisés légalement. D’autres applications existent, pour la sécurité privée classique ou la protection rapprochée, comme «Bannerman» (du nom d’une start-up de San Francisco), et sont décrites comme participants de l’« uberisation » de la sécurité privée. Trustify est perçu, aux Etats-Unis, comme une difficulté pour les régulateurs, d’autant plus qu’ils sont potentiellement 50 Etats à pouvoir adopter une position différente. Les associations de détectives privés dénoncent, quant à elles, une concurrence déloyale, Trustify niant être une entreprise de sécurité privée et bien que fournissant des services de recherches privées. Face à ces évolutions numériques, la question stricte de la régulation – par exemple, Trustify doit-il demander une licence en matière de sécurité privée ? – n’est pourtant pas essentielle, bien qu’elle se pose de manière aigüe aux Etats-Unis puisque la régulation n’existe que «state by state». Le combat, le cas échéant, pour forcer ces nouveaux acteurs à obtenir une licence, est d’arrière-garde si l’on veut bien se placer du point de vue de l’évolution de la sécurité privée ellemême, de son offre et de sa demande. En effet, quand bien même Trustify demanderait une licence, il sera certes en règle mais constituera toujours un challenge pour le secteur et donc une concurrence forte et déstabilisante. La question n’est donc pas d’empêcher ce type d’initiatives mais de savoir comment les acteurs plus historiques s’y adapteront par adoption, par innovation, plus que par l’empêchement d’exister. En France, la problématique des commissionnaires, des courtiers, des offres de prestations de services de grands opérateurs venant d’autres secteurs et spécialisés dans l’abonnement et la gestion de l’information est similaire. A n’en pas douter, des applications pour smartphones vont émerger dans les prochains mois et l’« uberisation » de la sécurité privée, au sens de mise en relation numérique et géolocalisée d’une offre et d’une demande, va survenir. On notera que cette possibilité d’« uberisation » a été mentionnée, pour la France, directement après les attentats du 13 novembre, à Paris, mais dans le sens d’une plus grande participation des citoyens à la sécurité ou d’une circulation plus rapide et numérique de l’information et des alertes entre eux et les forces publiques de sécurité et d’urgence4 : la sécurité privée et ses liens avec les forces publiques n’étaient pas dans le spectre de cette première enquête sur l’d’«uberisation» appliquée à la sécurité. Enseignements de cette «big picture» Au final, une « big picture » utile et anticipatrice, à valeur ajoutée, doit tirer des leçons de ces pratiques et notions de gestion de crise, de «réentrée » en zone de crise, d’applications pour smartphones : l’information est essentielle tant pour l’évolution de la sécurité privée que celle de la coproduction de sécurité. La «réentrée» en zone de crise est une problématique de gestion de droits d’accès, différenciés, communiqués, partagés, et donc une gestion de l’information. Trustify n’est autre que la valorisation des informations relatives à une demande et à une offre de sécurité, optimisant la rencontre de l’une et l’autre. Il est possible de rappeler, à ce stade, le dysfonctionnement de l’entreprise de sécurité privée G4S lors des Jeux olympiques de Londres en 2012 : la question s’était focalisée sur l’incapacité de l’entreprise, pourtant l’un des leaders mondiaux, à fournirles effectifs promis. Face à cela, les forces militaires ont dû pallier au dernier moment le manque de ressources : en quelque sorte, il a été diagnostiqué une incapacité d’un transfert de missions publiques vers un acteur privé. Mais cela n’est que le résultat et la conséquence d’un autre dysfonctionnement ex ante. En effet, il s’agissait d’abord d’un dysfonctionnement de l’information et de sa transmission au sein même de la structure RH du prestataire, ainsi qu’entre la direction du prestataire et les organisateurs de l’événement. Prévoir des transferts de missions ou même des coopérations opérationnelles sans imaginer des transferts d’informations protocolisés, normés, suivis, en tout cas explicités, est voué à l’échec; et cela concerne à la fois la filière privée et le secteur public de la sécurité, non pas dans leurs structures opérationnelles mais dans leurs structures de support, de back office, dans la compréhension mutuelle de leurs organisations structurelles. La «big picture » correspondra ainsi à la capacité de cartographier la présence d’agents de sécurité privée et leur disponibilité sur le territoire ou une zone géographique donnée, par le biais des technologies numériques et individualisées, tant pour un recrutement direct par des employeurs ou pour des contrats avec des donneurs d’ordre que pour un recours et un soutien aux forces publiques, le tout essentiellement dans des situations de crise ou d’urgence. La diffusion de messages et d’alertes deviendrait serait également envisageable. Le défi consistera à relier les différents acteurs, publics et privés, dans le respect de leurs compétences et finalités respectives, c’est-à-dire «à chacun sa place, mais une place connue de chacun ». La « big picture » en construction, à partir d’outils et services numériques et connectés – comme dans tous les autres domaines de l’économie marchande ou non –, montre que la coproduction de sécurité est inéluctable, mais par le biais du transfert d’informations bien davantage que celui du transfert de missions. Elle passe par une analyse de l’économie, voire une e-conomie, de l’information et de la connaissance appliquée à la sécurité privée et se construit donc par le « big data ». Face à ces évolutions tous azimuts, l’Etat et le régulateur public peuvent s’interroger sur le périmètre à autoriser et à contrôler, tout comme les acteurs classiques de la sécurité privée peuvent penser qu’ils ne sont plus protégés par la réglementation. Ce n’est pas faux. Dimension française de la « big picture » Il faut quitter ici la scène nord-américaine, du moins l’IASIR, si l’on souhaite compléter cette « big picture » anticipatrice, afin d’évoquer la normalisation. Un passage par la France permet de montrer le changement de regard sur la normalisation en sécurité privée, pour laquelle l’année 2015 a été une année pivot. Trois signes en particulier illustrent cette nouvelle prise en compte de la normalisation, qui sont à la fois des défis et des réponses à la régulation publique et à ses possibles faiblesses : Des structures institutionnelles s’intéressent désormais à la normalisation et permettent une mise en commun et en réseau des acteurs et informations relatifs à la normalisation : - En septembre 2014, un Responsable ministériel aux normes au ministère de l’Intérieur, Patrick Butor, a été nommé5 . Il permet ainsi au ministère de s’investir sur cette problématique, d’en suivre l’évolution et surtout d’en formaliser les projets et positions des différents acteurs publics et privés français à défendre, en lien avec AFNOR Normalisation dans les comités de normalisation nationaux, européens et internationaux. Il convient de souligner que Patrick Butor a été élu, fin août 2015, animateur du groupe de travail relatif à la sécurité privée au sein du comité ISO TC 292 « Sécurité et résilience » et qu’à ce titre, il est de nature à influer sur le programme de travail des années à venir sur ce sujet. - En janvier 2015, le Collège du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a décidé de la création d’une commission « Normalisation », animée par Valérie Derouet, vice-présidente du Collège. Cette commission réunit régulièrement les acteurs de la sécurité privée, ainsi que les services du Responsable ministériel aux normes, afin de dresser l’état des lieux des normes et certifications en sécurité privée et les orientations futures dans le domaine. - Enfin, le CNAPS est membre de différents comités de normalisation/certification au niveau national (certification NF Service 241 « Service des entreprises privées de prévention et de sécurité », comité SGS sur le projet de certification pour les secteurs d’activité d’importance vitale, comités en matière de certifications en systèmes de télésurveillance, etc.). Des projets de normes et certifications sont en émergence, parfois concurremment, aux niveaux : - national avec des réflexions en matière de SAIV (Secteur d’Activité d’Importance Vitale) et en matière de référentiels de certification pour les organismes de formation en sécurité privée ; - européen avec la création du Technical Committee TC 439 « Private Security Services » au sein du Comité européen de normalisation (CEN). Ce comité s’est réuni pour la phase de lancement à Vienne en juillet 2015 ; - international avec la poursuite des travaux relatifs à l’évaluation de la conformité à la norme ISO 18788 « Management system for private security operations — Requirements with guidance for use ». Cette norme, publiée à l’été au niveau de l’ISO et à l’automne en collection française, pourrait désormais faire l’objet d’une deuxième étape, à savoir l’élaboration d’un guide de l’évaluation. Pour cette deuxième étape, la France est plutôt bien placée, avec l’élection du Responsable ministériel aux normes, à la tête du groupe de travail en charge, entre autres, de cette norme et des travaux ultérieurs. Depuis 2014, la législation relative à la sécurité privée recourt à la certification, ce qui est une nouveauté : - La loi du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires impose aux entreprises de protection des navires d’être certifiées ISO 28000 préalablement à leur demande d’autorisation d’exercer par le CNAPS. Les premières entreprises de protection des navires ont ainsi été autorisées en 2015, majoritairement anglaises, notamment de par leur avance sur la connaissance et la mise en œuvre de la norme ISO 28000. - La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « loi Rebsamen », prévoit également que les organismes de formation en sécurité privée obtiennent une certification, préalablement à leur demande d’autorisation d’exercer par le CNAPS. Cette certification sera fondée sur des référentiels d’exigences co-élaborés par les acteurs publics et privés concernés et donnant lieu à des arrêtés ministériels. Ces évolutions institutionnelles en matière de normalisation soulèvent alors des questions de fond sur la régulation, la coproduction public-privé et la gestion de l’information par la sécurité privée : - La normalisation apparaît comme une solution de régulation privée qui reprend vigueur, après quelques tentatives à la fin des années 1990. La normalisation se place dans une optique de régulation économique plutôt qu’administrative et remet au centre les donneurs d’ordre, qui sont ici des prescripteurs – c’est à eux de demander, dans leurs appels d’offre, des prestataires certifiés. Rien de nouveau ici, hormis, et c’est important, une profusion de démarches tous azimuts (nationale, européenne et internationale) : letravail à venir sera donc d’articuler ces démarches entre elles et de permettre aux acteurs français de se positionner en fonction de leurs pratiques actuelles et de leurs besoins futurs. - Plus innovant, la normalisation est utilisée par la réglementation administrative ou régulation publique de la sécurité privée, comme le montre la protection armée des navires ou le contrôle des organismes de formation en sécurité privée. Ce que le régulateur ne souhaite pas vérifier, il le laisse au certificateur : la certification est un préalable à l’autorisation administrative. Il s’agira aussi d’articuler ces deux types de régulation du point de vue des informations demandées, afin d’éviter les doublons et pour les rendre utilement complémentaires. Il conviendra aussi de ne pas dévoyer la logique de la normalisation : celle-ci doit rester une régulation privée et économique et être en mesure de distinguer les acteurs privés entre eux, ce qui devient peu possible dès lors qu’elle est rendue, par la réglementation publique, obligatoire pour tous. - Enfin, cette émergence globale de la normalisation et la certification va dans le sens d’une plus grande prise en compte de l’information. En effet, la certification correspond à la documentation et à la formalisation de pratiques déjà existantes ou nécessite la documentation de pratiques à améliorer. Elle pousse les entreprises à professionnaliser leur gestion de données et d’informations, leur recueil, leur traitement, leur traçabilité, leur valorisation marchande ou réputationnelle. Ne pas percevoir ni relier ces différentes évolutions et tendances de la sécurité privée en 2015, aux Etats-Unis comme en France , c’est en rater la « big picture » future et ne pas se donner les moyens d’établir une véritable coproduction de sécurité, fondée autant, sinon plus, sur le transfert et le partage de l’information que sur des transferts de missions du public vers le privé. n Cédric Paulin, adjoint du directeur de cabinet au Conseil national des activités privées de sécurité
|
- Date de Publication: 26/02/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Le mot « ubérisation » a été consacré parmi les 12 mots les plus cités de l’année 2015. A tort ou à raison, il occupe désormais le champ médiatique, économique, politique, entrepreneurial. Grégoire Leclercq, cofondateur de l'Observatoire de l'Ubérisation et Président d'Itool Systems (Comptabilité et Gestion en ligne), publie une analyse.
Le paysage
Tout le monde s’accorde à dire que sous les efforts conjugués de l’émergence du numérique, de la forte augmentation du volume de travailleurs indépendants et de l’évolution des habitudes de consommations des Français, une révolution de nos modèles économiques se fait jour. Pour les uns, cette révolution est le synonyme de nombreuses menaces qu’il faudrait absolument contrôler, et pour d’autres au contraire d’opportunités sans précédent.
Il y a toujours eu des « disrupteurs » qui répondent à un besoin non satisfait des consommateurs. Leur arrivée sur un marché bouscule le modèle économique des acteurs historiques et, en général, ils automatisent des tâches, inventent des produits, démocratisent certains types de biens ou de services. Souvent, la rupture est technologique, réglementaire, organisationnelle. Enfin, ils attaquent les secteurs monopolistiques, où la clientèle est insatisfaite[1].
Il existe un flou réel sur la définition même du terme « ubérisation ». Or, il est important de bien faire la différence entre économie collaborative, économie du partage, gig economy, disruption et ubérisation, dont le seul point commun est de s’appuyer sur une digitalisation généralisée de nos modes de vie, la France étant désormais première du classement européen et en 4ème place du classement mondial sur les services en ligne proposés par l’administration, les infrastructures de télécommunications, et le niveau d’éducation des habitants[2].
Dernier élément conjoncturel, la consommation de biens et de services subit une révolution qui va en s’accélérant. Les Français sont de plus en plus impatients, ils hésitent de moins en moins à s’affranchir de certaines règles, ils sont simultanément en demande de considération et de transparence, ils plébiscitent les circuits courts, et ils recherchent une expérience de consommation où le taux d’effort et les contraintes soient les plus faibles possibles[3]. Ce comportement, très marqué chez les particuliers, s’étend progressivement aux entreprises.
Impact du collaboratif : rien de nouveau
Les partages de biens et services, d’éducation, de production, de gouvernance sont devenus un réflexe, notamment chez les plus jeunes. Ces pratiques renforcées par un usage massif des réseaux sociaux, poussent le consommateur à faire « communauté » et donc à mettre en commun des biens, des services, des avis, des expériences, des productions. Pour autant, on ne partage pas un expert-comptable. Tout au plus, on recommande son expert comptable à sa communauté. Et il est vrai que, sur ce point, la réputation devient un enjeu majeur pour les cabinets. Mais jusque là, rien de nouveau.
L’intermédiation : un vrai levier
C’est sur la base d’une large insatisfaction - ressentie ou réelle - que de nombreuses startups émergent pour attaquer un marché en faisant la promesse d’un meilleur service, plus transparent et plus immédiat. Mais aussi sur une capacité à intermédier pour référencer. La capacité pour une start-up à référencer les experts-comptables selon de nombreux critères (adresse, notation, spécialité, prix, disponibilité, ancienneté) apporterait un réel avantage au client final. Et comme Booking ou TripAdvisor/La Fourchette, l’impact à moyen terme est évident : la relation clients est coupée entre le client et le cabinet, par la plateforme qui devient à la fois la marque de référence et le pourvoyeur de nouveaux clients. C’est une défragmentation du marché à prévoir.
La valeur ajoutée du cabinet
A l’heure de l’automatisation des tâches, des architectures Cloud, des espaces de travail collaboratifs et des portails « clients », la valeur ajoutée du cabinet évolue vers du conseil de plus haut niveau. La piste souvent évoquée est celle du rapprochement des professions comptables avec des professions d’avocats, d’huissiers et de notaires. Mais la loi française l’interdit alors que le besoin est particulièrement marqué chez les TPE et PME qui ne comprennent pas pourquoi il leur faut 4 interlocuteurs pour traiter le panier des « contraintes administratives et comptables ». On retrouve notre fameux taux d’effort qui laisse une place à prendre à l’acteur qui saura proposer le package global.
Expliquer le partage de la valeur
Avant l’arrivée des logiciels de Gestion et de Comptabilité, le mode de saisie traditionnel était purement manuel. Mais avec l’arrivée des premiers logiciels, puis avec leur généralisation dans le mode Cloud, les entreprises ont bien compris qu’elles réalisaient elles-mêmes une large part du travail. Cette redistribution des taches affecte celles des experts-comptables, mais ce n’est que le début ! Demain, les logiciels d’intégration bancaire complets, de révision de bout en bout, de vérification de tenue de comptes, d’établissement des actes juridiques, de télé-déclaration directe à la DGFIP risque de faire passer l’expert pour « accessoire » dans l’établissement de ces documents, et de le ramener à l’éternel sujet de sa valeur ajoutée. Pas de conseils, pas de disponibilité : pas d’expert !
L’expertise est challengée…mais n’est pas morte !
Cette révolution est vécue par quelques cabinets comme une menace mais c’est aussi une rare opportunité. Parmi les nombreux axes de réactions : se réjouir que la profession soit petit à petit dépoussiérée, ne pas compter sur la réglementation pour s’en sortir, optimiser ses processus et ses outils, développer de nouvelles compétences en conseil, tableaux de bord, prévisionnel, maitrise de la donnée… D’autre part, il faut adopter les mêmes cahiers des charges que les disrupteurs : une relation clients excellente, un conseil supérieur qui fédère autour d’outils et d’initiatives.
[1] Etude “Les Moulins” : La profession va-t-elle se faire ubériser ?
[2] Etude “United nations e-government survey 2014” : e-government for the future we want
[3] Observatoire Sociovision : La société française au miroir d’Uber
|
Description
Hayette Hamidi, Yassin Lamaoui et Farid Temsamani, sont membres fondateurs du think tank France Fière. Hayette Hamidi est avocate, élue municipale du Blanc-Mesnil, et présidente du think tank France Fière
Alors que le chômage de masse frappe principalement les habitants des quartiers populaires, débloquer le marché du travail serait une avancée dans la lutte contre les discriminations et la quête d’une cohésion nationale.
Le projet de réforme du droit du travail porté par Myriam El Khomri et défendu par Manuel Valls n'est qu'un pis-aller. Une accumulation de propositions parfois nécessaires, mais non suffisantes afin de renouer avec la croissance et la baisse durable du taux de chômage sans précédent que connait notre pays.
Pourquoi la réglementation bloque toute libération de croissance ? Pourquoi le maintien des charges d’une époque révolue alimente les discriminations ? La seule libéralisation du secteur réglementé du transport de personne développant les fameux VTC a davantage réalisé en matière de création d’emploi que nombre de politiques publiques.
Réalités françaises
À l’heure où le taux de non-emploi des jeunes dépasse les 25 %, à l’heure où le taux de non-emploi en quartiers dits populaires dépasse les 50 %, ces citoyens français ne cessent d’innover. Ils innovent afin de créer eux-mêmes les emplois qu’on leur refuse par ailleurs. Ils créent de véritables alternatives créatrices d’emploi et de richesse, mais se trouvent, là aussi, freinés par l’antagonisme de notre économie.
Antagonisme, car d’une part, nous souhaitons coûte que coûte renouer avec croissance et la grandeur d’antan tout en bloquant toute tentative de libéralisation de notre économie et du marché du travail nécessaire au XXIe siècle.
Aujourd’hui, nous plaidons pour abattre les barrières à l’entrée du marché du travail touchant de plus en plus fort les Français issus de quartiers dits populaires. Aujourd’hui, nous souhaitons éradiquer le plafond de verre auquel nombre de Français sont confrontés dès qu’ils arrivent à mettre un pied dans le sacro-saint marché "conventionnel" du travail.
Aujourd’hui, nous poursuivons le rêve de voir grandir une génération qui prend en main son destin et crée elle-même les emplois de demain sans distinction d’origine, de religion ou d’orientation sexuelle. Ce rêve est à portée de réforme, mais pour le rendre possible, nous nous devons d’uberiser notre marché du travail, d’abattre des décennies de réformes superfétatoires du marché du travail et de coupler enfin économie et travail afin que nos valeurs républicaines de Liberté, Égalité et Fraternité regagnent tout leur sens à destination notamment de cette génération sacrifiée des quartiers délaissés. Et ceci sans dogmatisme dépassé.
Cette nécessaire réforme, les Français mis aux bancs, discriminés dès leur (non) accès à l’éducation d’excellence puis au cours de l’ensemble de leur vie professionnelle, l’ont compris. Cette frange de la population française n’a eu de cesse de se battre et a su ainsi très tôt appliquer l’une des théories célèbres de Jean-Baptiste Say selon laquelle l’offre créée sa propre demande.
Or, l’État n’a eu de cesse que de freiner toutes ces initiatives d’économie collaborative telle qu’Airbnb, le covoiturage, les sites de partage ou encore la libéralisation du marché du transport de personnes. Face à cet immobilisme, l’ambition et le volontarisme du ministre Emmanuel Macron sont naturellement à saluer.
Au lieu d’adapter le marché du travail à cette nouvelle offre ainsi créée, offre répondant par ailleurs à une demande forte tant des utilisateurs que de ceux qui ont ainsi pu créer leurs propres emplois, le gouvernement actuel se borne à rester aveugle face aux mutations économiques rendant nécessaire une réforme majeure de notre marché du travail.
Indispensable uberisation
Aussi, il en va de notre responsabilité de porter aujourd’hui le message de milliers de nos concitoyens, celui d’une nécessaire uberisation de notre économie et, de ce fait, de notre marché du travail. La flexibilité encadrée doit être le fil conducteur d’une prochaine réforme, le lien de subordination ne doit plus être le seul critère validant le salariat, le portage salarial doit être simplifié, l’activité pour compte propre doit pouvoir être proposée sans surcoût fiscal et sans condition irréaliste mise à la charge des entreprises et l’accès aux appels d’offres notamment publics doit être facilité.
La masse salariale est l’un des poids majeurs au sein du bilan de toute entreprise. Or, en proposant un même niveau de service par le biais, notamment, de contrats de prestation de service simplifiée et sans surcoût salarial, nous pourrions, notamment, libérer les entreprises d’un poids certain et offrir de nombreuses perspectives d’emploi à tous.
|
- Date de Publication: 03/12/2015
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Philippe Corrot a confondé la marketplace de la Fnac.com et, préalablement, Keyrus. Il cofonde en 2012 Mirakl pour proposer à tous la solution marketplace développé pour la FNAC. En un peu plus de trois ans d’existence, Mirakl compte déjà parmi ses clients les Galeries Lafayette, Boulanger, Nature et Découvertes, Darty, MisterGoodDeal, Rue du Commerce, le groupe Lagardère, Auchan, Menlook, etc. L’entreprise est devenue leader mondial sur son secteur. Fin 2014, Mirakl a ouvert un bureau à Boston et un autre à Londres. Mirakl a connu une croissance de 200% du CA en 2014 et compte aujourd’hui 55 clients dans 11 pays différents. Philippe Corrot prend ici une approche globale de l'Ubérisation : Uber n’est qu’un cas isolé d’une mutation des modes de consommation globale. On va vers un modèle économique basé sur la désintermédiation (mise en relation directe des consommateurs et des producteurs/prestataires). Ce qui permet aux consommateurs d’avoir accès à une offre plus étendue pour des prix plus bas avec une très bonne qualité de service.
Alors que le service UberPop vient d’être suspendu en France, le débat s’intensifie aussi bien chez les politiques que dans la sphère publique. Uber abandonne-t-il vraiment le marché français ou bien ne fait-il que reculer pour mieux sauter ? Les décideurs français ont-ils vraiment les moyens d’empêcher une véritable tendance de fond qui est bien loin de ne concerner que les transports ?
Innovation vs. conservatisme
Comme Uber, de nombreuses entreprises ayant prospéré grâce à Internet sont, par le passé, allées à l’encontre de la législation en vigueur. On a vu ainsi émerger au début des années 2000, les questions liées au respect du droit d’auteur face au développement d’Internet et en particulier face à celui de Google, Napster ou Youtube. Depuis quelques années, ce sont Facebook et autres réseaux sociaux qui remettent en question les règles autour de la vie privée. Cette problématique n’est pas nouvelle, et elle persistera à mesure que l’innovation entrera en conflit avec les traditions et les intérêts de professions protégées au détriment des autres acteurs du marché et des consommateurs.
On retrouve le phénomène de destruction créatrice, décrit par Schumpeter : l’innovation est condamnée à modifier les structures économiques et à « détruire » certaines activités pour mieux les recréer, de manière plus efficiente. Cela entraine inévitablement des frictions, mais l’histoire nous montre que c’est un phénomène à la fois inéluctable et positif. Exemple proche de nous, l’industrie musicale s’est longtemps accrochée au seul modèle qu’elle connaissait (la vente matérielle d’un disque) et a tenté de contrer la dématérialisation de la musique sans comprendre qu’avec elle les consommateurs avaient d’autres attentes et profiteraient désormais différemment de la musique. Aujourd’hui, l’industrie musicale a intégré cette évolution des mœurs et accompagne la dématérialisation grâce à des plateformes comme Deezer ou Spotify. Mais cela ne s'est fait ni du jour au lendemain ni sans conflit ! Tendance de fond, la dématérialisation de la culture pousse les industries les plus anciennes à s’adapter à la consommation 2.0. Le monde du livre n’est pas exempt et commence d’ailleurs à proposer des réponses numériques adaptées aux usages des lecteurs.
Au lieu de continuer à faire vivre un modèle économique obsolète, les pouvoirs publics ont donc intérêt à accompagner les mutations profondes de l’économie et de la société plutôt que de vainement tenter de les freiner.
Le client est toujours le roi
Si on prend le cas d’école « Uber », nul ne peut nier son succès. Un succès que la jeune entreprise n’aurait jamais pu connaitre si elle n’avait pas répondu à un besoin réel des consommateurs. Le modèle économique d’Uber qui prend la forme d’une place de marché numérique, c'est-à-dire un modèle de désintermédiation qui met en lien direct le prestataire et le client, valorise la qualité de service avant tout. Dans un marché ouvert, ce qui va dans l’intérêt des clients, va dans celui de 150831 – Tribune Libre par Philippe Corrot l’entreprise, de l’économie et de la société. La preuve, les clients des VTC sont aujourd’hui plus satisfaits que ceux des taxis !
Uber a démocratisé l’accès à un service de grande qualité et il n’est pas envisageable aujourd’hui que le législateur et les concurrents puissent retirer cet « acquis » au consommateur. Ce sont les taxis qui devront s’aligner sur cette qualité de service et aux pouvoirs publics de rendre l’accès au marché le plus ouvert possible afin que le métier et les services puissent évoluer en même temps que les attentes consommateurs. C’est une véritable prise de pouvoir du consommateur qui concerne tous les secteurs. Ne pas être à leur écoute conduira les entreprises nécessairement à l’échec. Tous ceux qui ont perdu le sens du service et l’écoute du client, le paient aujourd’hui. Et ce n’est que le début !
Pourquoi le modèle d’Uber finira par sortir vainqueur
Plutôt que de reprocher à ceux qui bousculent le marché de mettre en péril les acteurs historiques qui n’ont pas su innover, il faut les accompagner sur la voie du changement et de l’innovation tout en se remettant en question.
Les taxis le savent peut-être déjà : sur le long terme leur combat est perdu d’avance. Un combat qui aurait pourtant pu être vécu comme une opportunité afin de se libérer des carcans qui les enserrent : au lieu de demander une application des mêmes contraintes à tous, pourquoi ne pas demander une libération pour tous ? Il est essentiel de chercher un bon équilibre entre le choc technologique et les règles de droit existantes au lieu de ne laisser place qu’à la confrontation : résoudre le problème des licences, uniformiser les statuts ou le montant des charges, bref, aller dans le sens d’une économie où l’offre et la demande, les besoins et les solutions, sont agrégés de manière optimale.
Il ne faut pas se leurrer et croire que le conflit Uber/Taxis est périphérique. D’autres places de marché dépoussièrent chacune à leur façon les conventions qu’il s’agisse d’Amazon sur les produits culturels ou d’Airbnb sur l’hôtellerie. On pourra espérer que les conflits entre innovateurs et acteurs historiques seront moins violents à l’avenir.
|
- Date de Publication: 10/11/2015
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Par Julien Perona, cofondateur et PDG d'Addworking, Agence d'emploi digitale spécialisée dans le hors salariat. Diplômé d'ISC Paris, Julien Perona a effectué un parcours de manager chez GE France puis chez Schindler, avant de créer Addworking. Il a publié pour l'Observatoire cette tribune "Ubériser l'interim".
On est en droit de se demander si le salarié et l’actionnaire sont devenus les Capulets et Montaigu du XXIe siècle ou encore si l’ubérisation peut favoriser le marché de l’emploi. Concernant cette dernière, elle rapproche et apporte une alternative digitale à notre économie traditionnelle. En d’autres termes, elle contribue à notre évolution au sein de la nouvelle civilisation numérique.
Le marché de l’emploi doit-il être ubérisé ? On pourrait se contenter du statut quo cependant les formes d’emplois actuelles ne conviennent plus, tout comme les moyens de contractualisation proposés aux entreprises qui hésitent à recruter lorsqu’elles n’y renoncent pas .
Pourtant, une transformation digitale rapprocherait plus facilement l’entreprise de toutes personnes souhaitant proposer un savoir-faire. A plus forte raison si l’on observe le poste recrutement. Car les entreprises ne sont plus en capacité financière d’assumer « une erreur de casting ». S’agissant de multinationales, elles subissent des pressions d’actionnaires de plus en plus fortes se traduisant par des ratios d’effectifs revus à la baisse chaque année.
L’actionnaire et les dirigeants d’entreprises constatent à leur dépend et face à la détresse de certains salariés que le dogme « faire plus avec moins » a ses limites. Ce constat laisse apparaître un taux d’arrêts maladie croissant avec le «burn out» élevé au rang de première maladie professionnelle du XXIe siècle.
Le paradigme des années à forte croissance n’est plus, n’en déplaise aux conservateurs qui pensent que nous pouvons continuer à bâtir, grâce au contrat de travail, notre modèle d’équilibre social.
Contrat de travail : moyen du passé et dépassé ?
Le CDI ne peut plus être considéré comme le summum des contrats de travail. Le considérer comme pièce centrale du XXIe siècle figerait les positions et crisperait davantage l’employeur.
Et l’intérim ? Le portage salarial ? Sont-elles des formes disruptives d’emploi ?
Il s’agit de formes coûteuses pour l’entreprise avec un modèle économique gourmand en marge (marge ou hold-up) et inadapté dans une économie de croissance à 1%.L’intérim fonctionne encore très bien mais pour combien de temps ? Le dernier rapport de la CIETT(1) souligne qu’il a été supplanté par le travail indépendant…Recruter en ligne des intérimaires reviendrait à digitaliser leur processus et à faire « tomber » leur réseau d’agence. En clair, le digital favorise l’accès au canal hors salariat.
Uberiser l’Intérim
Le hors salariat se développe chaque jour en France et en Europe. Aux USA, les travailleurs hors salariat représentent 35% de la population active. En France, nous en comptons déjà 10% pour environ 28 millions de personnes actives au total. Durant les quinze dernières années, ils ont progressé de 85%.
Cette population riche de compétences, flexibles apportent via le web une alternative évidente aux entreprises qui en ont assez du contrat de travail, de l’utopie de ces cabinets de recrutement aux marges astronomiques et de la douloureuse facture de l’agence d’intérim. Mais l’entreprise doit aussi rentrer dans sa phase de mutation pour s’exprimer en mode projet.
Certaines d’entre elles ont bien compris et réussissent parfaitement à proposer leur charge de travail sous forme de missions « externalisées » pour acheter, recruter la compétence hors salariat adéquate et répondre à leur attente.
Externaliser les missions, gagner en productivité.
Le hors salariat encadré, contrôlé et maîtrisé apporte donc cette souplesse dont l’entreprise a besoin, avec un apport en compétence à la carte. Avec le web, l’accès est immédiat. L’offre et la demande sont à portée de clic.
Enfin, le hors salariat propose à bien des personnes un revenu supplémentaire, compensant l’effet des 35 heures. Un salarié avec l’accord de son entreprise peut proposer son savoir-faire pour quelques heures à d’autres entreprises, un retraité peut compléter sa retraite, un étudiant peut démarrer sa carrière professionnelle….Le marché de l’emploi est entré dans une transversalité grâce à la nouvelle civilisation du numérique. Que l’on s’en réjouisse !
Toutes les parties sont gagnantes : la personne propose son savoir-faire sous forme de missions, en divisant son risque avec du multi-employeur (multi-clients) et l’entreprise accède à des compétences flexibles, se rencontrent davantage. La rivalité Capulet / Montaigu peut prendre fin.
N’en déplaise à certains conservateurs ou idéologues, la vraie précarité, c’est le chômage.
(1) Confédération internationale des entreprises de travail temporaire
|
- Date de Publication: 03/11/2015
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Laurent Blondeau est conseil indépendant en stratégie, marketing et développement commercial. Il a travaillé dans de nombreuses entreprises technologiques et se spécialise en innovation, relation et expérience clients, social media et intelligence collective. Contributeur sur de nombreuses plateformes sociales (socialmediaclub, customerthink, deliveringhappiness, socialcustomer…) et animateur de nombreuses pages sociales et blogs. Exec MBA HEC. « opinions are my own ». Animateur du blog http://buzzedinlog.wordpress.com et http://evidencesx.wordpress.com. Il a rédigé une tribune intitulée : Uberisation : « uber alles » ?
Uberisation est désormais un mot. Mot dérivé d’une entreprise qui a complètement bouleversé une industrie, celle des taxis, ou plus largement des transports payants de personnes. On voit par ailleurs que cela ne s’arrêtera d’ailleurs pas là…Et là, figurent pêle-mêle du grand résultat, acteurs isolés, législateurs-régulateurs en peine et sans voix. Parce qu’ils n’ont rien vu venir, n’y ont pas cru, manquent d’imagination. C’est aussi ce qu’ont dit les plus hautes instances de défense Américaines après la catastrophe du 11/09 aux USA : « nous avons manqué d’imagination ».
De quoi s’agit-il ? Tout simplement de possibles rendus réels, par la révolution digitale, celle-là même qui a « disrupté » d’autres industries avant : disque, livre, tickets, conseil médical, restauration, livraison, optique…La liste serait trop longue.
Il y a donc aujourd’hui une grande responsabilité du chef d’entreprise à bien cerner ses choix, succès et compétences pour ne pas que tout ceci s’évanouisse un beau matin par un nouvel entrant, moins cher et meilleur (définition d’une innovation dite « disruptive »).
Rappelez-vous Kodak, qui possédait pourtant en son sein, l’inventeur de la photo numérique et n’y a pas cru, voire ne l’a pas développé au risque de cannibaliser sa propre activité. C’est Steve Jobs lui-même qui a organisé, sans cesse, la cannibalisation au sein même d’Apple…L’Iphone n’a t-il pas rendu secondaire l’IPod, pourtant un franc succès de la marque à la pomme ? Regardons désormais où est Kodak et ce qu’elle est devenue devant ce raz-de-marée numérique. Une société du passé...
Mais si l’uberisation n’est pas forcément technologique (qu’y a t-il de réellement technologique dans Uber aujourd’hui ?), elle bouge les lignes et plutôt de manière sismique. La nouveauté réside dans la capacité et l’opportunité de bâtir une expérience consommateur bien plus plaisante, rapide, efficace et surtout utiliser les outils modernes : géolocalisation, paiement mobile, tag, data et CRM…avec une excellence opérationnelle des « salariés », qui ont intégré les valeurs et l’esprit du service (ce point est aujourd’hui l’objet de révoltes localisées, en raison de précarité du travail, ou de l’inadaptation du modèle juridique, social, économique et fiscal résidant d’une époque trop longue à se réformer).
Il est donc bien de la responsabilité de tous, et non pas pour protéger (nous avons bien assez de tendances protectionnistes) nos acquis, salariés et rentes, mais pour innover et augmenter la satisfaction du client, qui comme nous le savons, augmente la fidélité et donc l’espérance de gain.
Etes-vous prêt pour un diagnostic, ouvert, franc et réaliste de vos activités ? Il vaut mieux prévenir que guérir disait l’autre, et il y désormais des maux incurables, conduisant à l’impasse…économique et sociale.
Pour ceux qui cherchent la croissance, elle existe, mais surement pas en protégeant nos rentes et acquis (cela s’adresse bien évidemment également à l’Etat, aux régimes protégés et autres anachronismes décalés et honteux, au regard de travailleurs ou retraités qui ne sont pas moins méritants). Et au vu de l’essor des plateformes, la démocratie entière pourrait bien être « uberisée »…A moins qu’une révolution plus larvée se prépare. A nos bonnes âmes politiques à avoir en tête, dans les programmes et dans les actions, les bonnes décisions qui entraineront l’uber-croissance. Et pour tous, bien entendu…
|
- Date de Publication: 26/10/2015
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Rémy Oudghiri est sociologue et membre du comité de pilotage de l'Observatoire de l'Ubérisation. Directeur Général Adjoint de Sociovision après un passage chez IPSOS, diplômé d'HEC et de Sciences-Po Paris, titulaire d'un DEA de sociologie, il a tout d'abord effectué plusieurs années de recherche en sciences sociales à Paris et à l'université de Stanford aux États- Unis. Chargé de cours à HEC et à Neoma Business School (Reims), il est l'auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles parus notamment dans la presse professionnelle. Il donne régulièrement des conférences en France et à l'étranger sur l'évolution de la société et les mutations des modes de consommation. Il a publié cet article dans le numéro d'octobre 2015 de la revue Perspectives Entrepreneurs (n° 754). Il revient sur l'ubérisation de l'économie française et la réaction des Français.
« Ubérisation » : depuis que Maurice Levy l’a utilisé au cours d’un entretien à la presse en décembre 2014, ce mot s’est répandu comme une traînée de poudre. Devenu entretemps un concept, chacun y fait désormais référence, mais il n’est pas sûr que tous entendent la même chose. Si l’on veut y voir plus clair, il faut donc commencer par définir ce qu’il recouvre. L'analyse qui suit repose sur les données collectées par l'Observatoire des Français de Sociovision. Chaque année depuis 1975, l'Observatoire interroge un échantillon représentatif de 2000 Français âgés de 15 à 75 ans sur de très nombreux sujets : valeurs, travail, modes de vie et de consommation, etc.
Au-delà d’Uber, une nouvelle révolution
D’une manière générale, l’ « ubérisation » désigne des mutations profondes qui sont aujourd’hui à l’œuvre dans la société française. Ces mutations traduisent trois dynamiques principales. Chacune d’entre elles contribue à remettre en cause les cadres traditionnels de l’économie et de la gestion des entreprises.
Vers une généralisation du numérique. La digitalisation croissante des usages fait bouger les lignes traditionnelles. Les administrations et les entreprises se transforment en intégrant le numérique aussi bien dans leurs offres que dans leur mode de fonctionnement interne. Ceci crée des transferts de compétence et oblige à repenser de fond en comble les organisations.
Vers de nouveaux acteurs de la consommation. C’est le fait le plus marquant des dix dernières années : les consommateurs ont aujourd’hui la possibilité de contourner les acteurs traditionnels avec une facilité de plus en plus déconcertante. Il leur suffit de prendre contact les uns avec les autres sur des plateformes dites « collaboratives » pour vendre, acheter, louer, échanger, créer, financer, etc. Des sociétés comme Airbnb, KissKissBankBank ou Blablacar ont fait de ces pratiques le moteur de leur succès.
Vers de nouvelles valeurs. Un énorme besoin de « respirer » se fait sentir dans la société française. 62% des Français interrogés par l’Observatoire de Sociovision disent ainsi aspirer à « une société très différente, avec plus d'ouverture, de libertés, de possibilités d'entreprendre ». Un nouvel état d’esprit se propage dans des milieux sociaux très différents qui plébiscitent les valeurs de débrouille, d’assouplissement des contraintes et le besoin d’accomplissement individuel.
Triomphe du consommateur, défaite du salarié
En 2015, la population a pris conscience des effets négatifs de ces évolutions sur le marché du travail. Le conflit entre les chauffeurs de taxi et l’Américain Uber a révélé que des pans entiers de l’économie étaient vulnérables. Le succès des nouvelles pratiques ont en effet atteint une telle ampleur chez les consommateurs qu’elles menacent directement les acteurs traditionnels. La mobilisation des chauffeurs de taxi contre l’application Uber Pop a mis le doigt sur ce qui jusque-là était resté dans les coulisses : certes, de nouveaux emplois se créent grâce aux nouvelles plateformes, mais d’autres emplois sont susceptibles de disparaître simultanément. Et il est à craindre, comme le souligna Robert Reich dans une tribune fracassante parue aux Etats-Unis en février 2015, que les nouveaux emplois créés soient précaires et mal payés. De nombreux secteurs sentent déjà les premières secousses de l’ubérisation : les hôtels, les transports ou la banque.
Si elle traduit bien le triomphe du consommateur, l’ubérisation semble ainsi annoncer la défaite à venir du salarié. Car si ces tendances continuent à se développer, de nombreux salariés risquent d’y perdre des plumes.
La population française est partagée
Que pensent aujourd’hui les Français de ces évolutions ? En tant que consommateurs, les Français sont positifs car ils voient tous les avantages qu’ils en retirent : économie, souplesse, bonnes affaires. Même l’argument écologique, s’il n’est pas une motivation centrale, les conforte dans leur engouement. Les achats d’occasion ne se sont jamais aussi bien portés qu’aujourd’hui. Et depuis le retournement de conjoncture de 2008, les Français sont devenus extrêmement friands des formules qui leur permettent de faire des économies. Parmi ces solutions, les pratiques collaboratives suscitent un intérêt croissant. Et elles ne sont pas prêtes de retomber si l’on en croit tous ceux qui, ne les ayant pas encore utilisées, expriment le souhait de le faire prochainement. Le nombre de ces derniers augmente chaque année…
En tant que salariés, les Français sont fragilisés. Depuis l’arrivée d’Internet, les actifs ont bien compris l’intérêt que les nouvelles technologies introduisent dans leur travail quotidien : rapidité, efficacité, meilleure organisation collective... C’est pourquoi une majorité aujourd’hui les plébiscite. Mais environ un tiers pensent que cela va trop vite et craignent d’être « dépassés ». De plus en plus redoutent d’être mis sur la touche dans les années à venir. Si le CDI pour l’instant les protège, ils anticipent un monde où ce statut sera de moins en moins proposé. L’histoire est peut-être en train de leur donner raison. Depuis plusieurs années, les contrats précaires se développent.
La France reste partagée sur ces questions. Quand on les interroge directement, 53% des Français âgés de 15 à 75 ans jugent que ces nouvelles pratiques sont positives car elles « permettent à des personnes d’avoir des ressources complémentaires », mais 47% pensent qu’elles créent une concurrence et mettent en danger des emplois traditionnels. » (source : Sociovision) Une ligne de partage qui divise la France en deux. Par ailleurs, les Français pensent qu’à plus ou moins brève échéance, des professionnels vont récupérer massivement ces pratiques, ce qui leur fera perdre l’essentiel de leur intérêt pour le consommateur.
Quid du futur ?
Pour les Français interrogés par Sociovision, il apparaît évident que le monde de demain va accentuer ces évolutions. Beaucoup pensent qu’il faudra se former en permanence pour rester dans le coup. Ils pensent également qu’il y aura de plus en plus de gens qui se mettront à leur compte ou créeront leur propre entreprise. Enfin, être et agir sur un réseau social professionnel deviendra un must pour s’organiser, trouver un emploi, faire carrière ou, simplement, trouver des solutions à des problèmes de la vie concrète.
Une opportunité pour les petites structures
« Small is beautiful » : ce slogan du début des années 1970 n’a jamais été autant d’actualité. L’avantage d’une petite structure, dans un environnement de plus en plus incertain, c’est sa capacité à réagir rapidement. Se réorienter lui coûte a priori moins qu’une grande organisation. Souplesse et anticipation seront de plus en plus des armes pour affronter la conjoncture. Dans le monde de l’ubérisation, ceux qui les porteront seront plus à même de se développer.
Un enjeu d’accompagnement
Les responsables politiques sont face à un défi majeur et qu’on pourrait résumer de la façon suivante : comment faire en sorte que la transition économique et sociale soit la moins douloureuse possible pour les salariés et pour les organisations, et qu’elle demeure la plus bénéfique possible aux consommateurs ? Équation impossible ? Cela oblige à revoir les statuts actuels et agir dans les deux mondes : assouplir les règles du monde économique traditionnel pour lui permettre de rester viable ; encadrer le monde économique qui émerge pour ne pas fausser les règles du jeu.
|