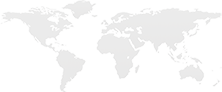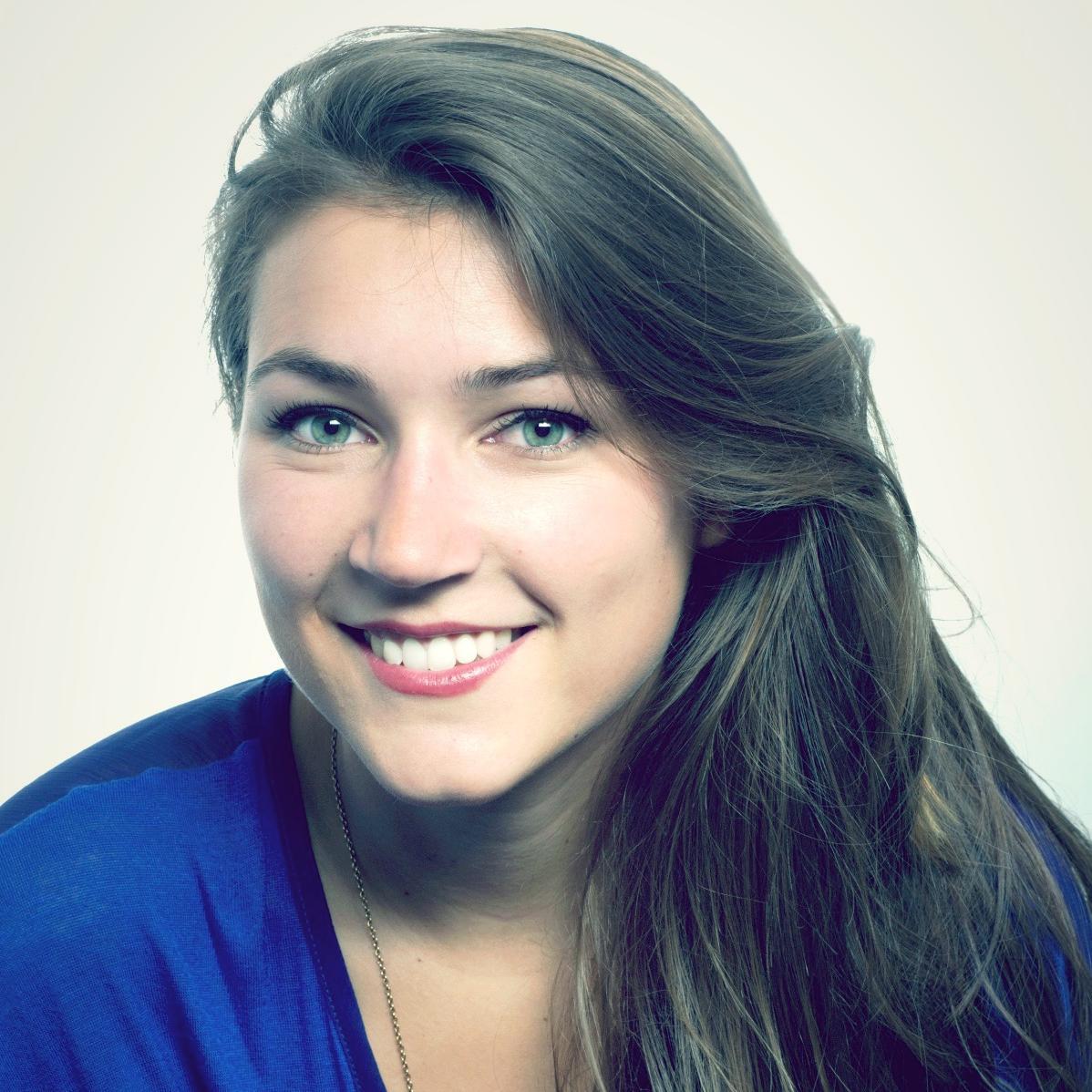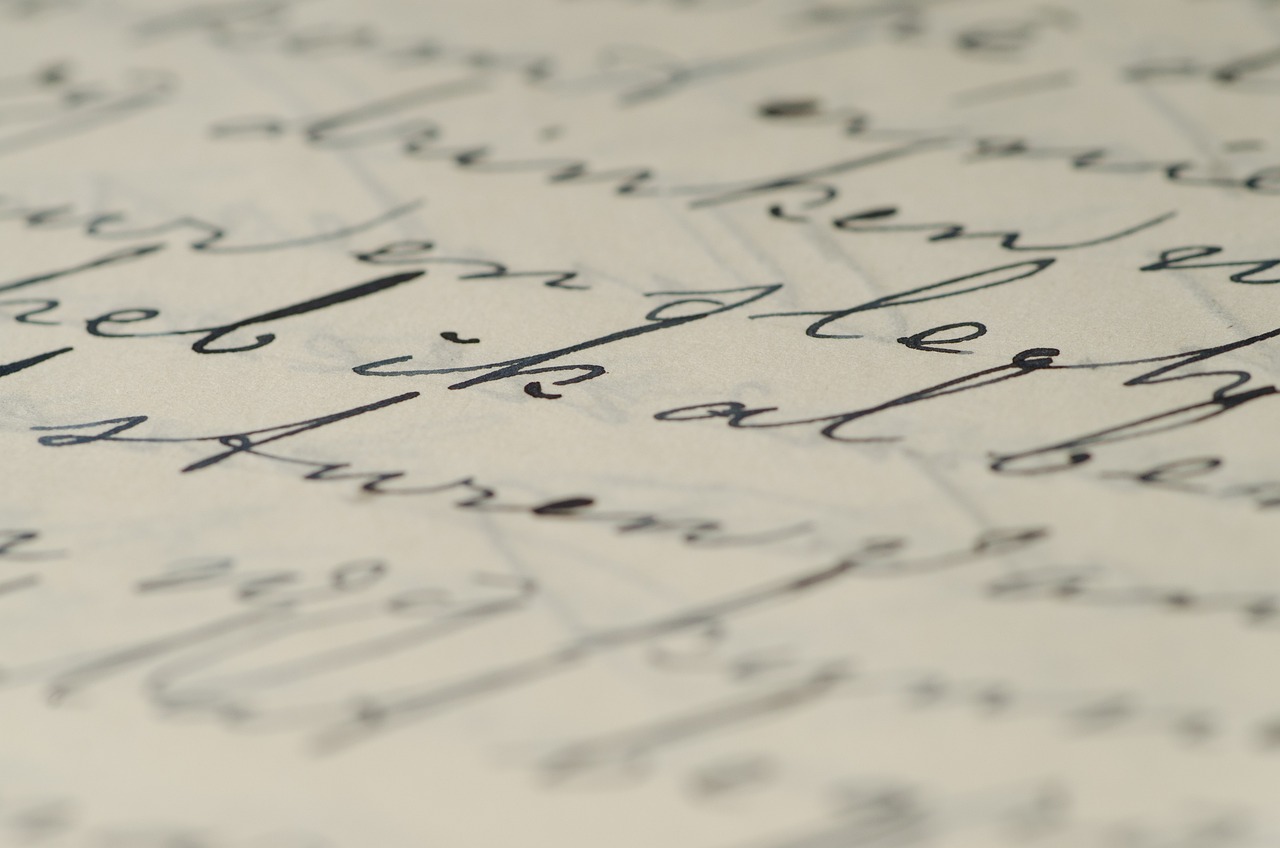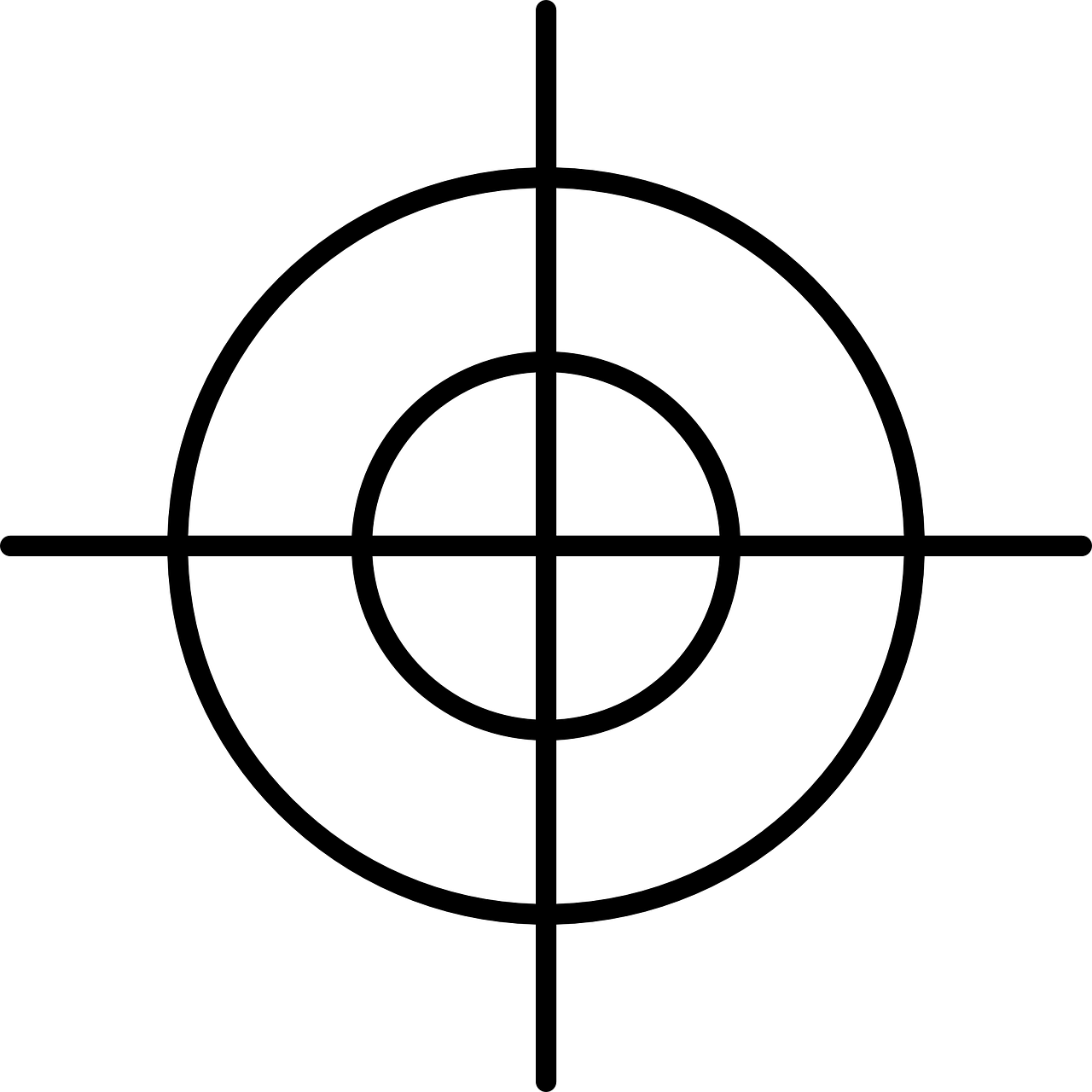Description
Morgane L'Hostis est fondatrice et CEO de Popmyday. Diplômée d'HEC, Morgane L’Hostis est partie découvrir la silicon valley puis a postulé chez Airbnb quelques mois après l’ouverture de leur bureau parisien. elle a fondé Popmyday en mars 2014, une plateforme de réservation de services beauté et bien-être qui fait appel à un réseau de professionnels indépendants pour réaliser la prestation n’importe où. Elle ambitionne de « faire aux services beauté ce qu’Uber a fait aux chauffeurs privés : rendre un service haut-de-gamme accessible au plus grand nombre via une application mobile élégante et efficace ». Morgane a publié cette tribune intitulée "Ubérisation : Faut-il avoir peur ?"
Accusées de torpiller les modèles économiques historiques, les start-up comme Uber offrent, en réalité, de nouvelles opportunités.
Les cris d’alarme se multiplient face à « l’invasion des barbares » de modèles disruptifs et « l’uberisation » de l’économie. Une dure réalité attendrait les travailleurs français : la précarisation par la destruction de leurs postes au profit d’applications mobiles désincarnées et pauvres en créations d’emploi. Quel pessimisme ! Une industrie qui se transforme ne crée-t-elle pas de nouvelles perspectives économiques ?
Les spécificités du modèle Uber
Dans la lignée du pionnier des VTC, le modèle Uber se décline dans tous les secteurs, des services beauté aux baby-sitters, des vétérinaires à la livraison de plats gourmets, en passant par le ménage ou la sécurité. Le modèle rencontre un écho particulièrement enthousiaste dans les secteurs très réglementés ou en situation de fort monopole comme c’est le cas pour les taxis ou les auto-écoles.
Attention toutefois à ne pas tout mélanger, quand on parle d’« Uberisation », on a tendance à confondre plusieurs modèles disruptifs en y intégrant par exemple Airbnb ou Blablacar. Disons-le une fois pour toutes, Uber n’est pas un modèle collaboratif puisqu’il supervise toute l’expérience utilisateur jusqu’à sa réalisation dans le monde physique.
Les services sont réalisés par des cocontractants indépendants professionnels sélectionnés à l’entrée et respectant un cahier des charges : modèle de voiture, gamme de prix, protocole, qualité de service client... On est loin du modèle de la place de marché collaborative où tout un chacun peut proposer ses services, référencer une voiture ou un appartement à partager !
Les opportunités cachées derrière l’« uberisation »
Les start-up s'inspirant d'Uber ont de nombreuses problématiques communes qui ouvrent des opportunités à qui saura y répondre. Elles ont notamment besoin de solutions marketing d’acquisition mobile, de solutions de paiement dédiées aux places de marché mobiles, ou d’outils pour assurer la sélection et la gestion des indépendants référencés sur la plateforme.
Aux États-Unis, un écosystème est en pleine éclosion pour répondre aux besoins de ces start-up. Jeter un œil sur la liste des start-ups recrutées dans les dernières promotions du YCombinator suffit à s’en convaincre. Par ailleurs, la croissance folle du nombre d’indépendants qui accompagne l’« Uberisation » laisse entrevoir d’autres opportunités. Voilà une foule de nouveaux entrepreneurs, qui cumuleront parfois plusieurs casquettes et qui auront besoin d’accompagnement légal, d’une assurance professionnelle, d’une mutuelle, d’outils de comptabilité simples ou d’une solution de transport à prix abordable.
La dernière étape avant la robotisation ?
Mon interrogation porte plutôt sur la robotisation à venir. Uber vient en effet de constituer une équipe de 40 ex-chercheurs de l’université de Carnegie Mellon pour développer sa propre self driving car ; Amazon teste la livraison par drone.
Avec la robotisation annoncée, est-ce que les futures « Uber-start-ups » auront toujours une dimension humaine ? Que se passera-t-il quand les voitures sans chauffeurs remplaceront les autoentrepreneurs ? Que se passera-t-il quand les drones remplaceront les coursiers ?
|
Description
Françoise Grossetête est Députée européenne, vice-Présidente du Groupe du Parti Populaire Européen (PPE). Titulaire d'une maîtrise en droit public et sciences politiques et d'un Certificat d'études supérieures de droit social et de droit du travail, elle a enseigné le droit dans l'enseignement supérieur. Députée européenne depuis 1994, Françoise Grossetête conduit la liste UMP aux élections européennes de 2009 pour la circonscription Sud-Est, à l'issue desquelles elle est réélue. Elle continue de siéger au groupe du Parti populaire européen. Elle publiait le 07/10/2015 dans le Huffingtonpost une tribune intitulée "L'Uberisation de l'économie ou le nouveau paradigme de la relation client", dans laquelle elle explique que face à un consommateur extrêmement exigeant, la relation client devient un enjeu économique et social stratégique. Extraits :
La récente décision du Conseil Constitutionnel d'interdire l'application UberPop fait la joie des conducteurs de taxis. Cependant, dans le cœur de ses utilisateurs, l'application demeure toujours aussi populaire.
Si l'application Uber réussi si bien son entrée sur le marché français et qu'elle est devenue si populaire en un laps de temps réduit, ce n'est pas seulement parce qu'elle propose un service innovant mais parce qu'elle prend avant tout soin de sa relation client : réponse immédiate, enquête de satisfaction après chaque course, paiement simplifié...
En revanche, outre-Rhin, l'application a du mal à s'imposer. En effet, seuls 1 600 chauffeurs Uber y seraient actifs, alors que la société a récemment déclaré être en mesure de créer d'ici fin 2016 jusqu'à 80 000 activités de chauffeurs indépendants rien qu'à Paris. Pourquoi une telle différence ? Tout simplement parce que les Allemands sont globalement satisfaits du service proposé par les taxis contrairement aux Français !
Les modes de consommation ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a vingt ans et le client digitalisé, très informé, est devenu un consommateur extrêmement exigeant. La valeur ajoutée d'un bien ou d'un service ne réside plus dans l'offre en tant que telle mais bien dans la capacité d'établir une relation de confiance, à la fois durable et prospère avec le client.
La relation client est donc un enjeu économique et social stratégique pour les entreprises françaises. Aujourd'hui, échouer à répondre aux attentes des consommateurs entraîne des sanctions immédiates. Selon une étude d'Accenture pour l'Institut National de la Relation Client, 54% des Français auraient ainsi changé de fournisseur en 2013 en raison d'un service client jugé insuffisant. La relation client ne peut plus se contenter d'être quantitative, elle doit aussi être qualitative.
Le digital a aussi complètement transformé la relation client : le big data et la masse d'informations disponibles permettent de mieux connaître le client, de mieux cerner ses besoins et ses attentes, voire de les anticiper. Et même si les outils informatiques sont aujourd'hui indispensables, ils ne sont qu'un support car c'est bien l'humain qui se trouve au cœur de ce cheminement : les facteurs rationnels, émotionnels, matériels ou humains sont tous mobilisés.
L'approche par la relation client, aujourd'hui plus subtile et personnalisée, devient donc un critère essentiel de recrutement pour nos entreprises. Des milliers d'emplois sont en jeu mais les candidats manquent à l'appel.
Le contexte de concurrence internationale doit nous encourager à prioriser ce levier d'action. Nos entreprises, françaises et européennes, doivent comprendre que la fidélisation des clients constitue réellement un levier de croissance et de compétitivité bien trop sous-estimé.
Adapter la formation, proposer une expérience client remarquable aussi bien en ligne qu'en boutique, innover en conservant le côté humain de la relation client, qui est de plus en plus dématérialisée, tel doit être le grand défi de nos entreprises. Fini le consommateur naïf et ignorant, place au consom'acteur informé.
A l'heure où l'Europe revoit sa stratégie numérique et promeut le développement des compétences, il semble essentiel d'intégrer cette approche dans sa copie.
Une prise de conscience au niveau national et européen est donc à espérer voire même nécessaire pour l'avenir de nos entreprises. Les mentalités doivent changer, les Français sont prêts. Arrêtons d'interdire pour ensuite autoriser, soyons malins et pour une fois disons oui à l'innovation, non à la procrastination !
|
Description
Jacques Nantel, Ph. D, est professeur titulaire au département de marketing de HEC Montréal.Jacques Nantel enseigne à HEC Montréal depuis 1981. Au sein de HEC Montréal, il fut successivement directeur du service de l'enseignement du marketing, titulaire de la Chaire de commerce de détail et directeur des programmes. En 2002, il devient le premier titulaire et fondateur de la Chaire en Commerce Électronique. Jacques Nantel est membre ou a été membre de plusieurs conseils d'administration d’entreprises et d’organismes dont : Groupe Vidéotron, PLB international, Groupe Renaud-Bray, Groupe Pierre Belvédère, Hotels Germain, BMO Advisory Board on Retirement, de l’OACIQ ainsi que de Centraide du Grand Montréal. Il revient sur la réaction de l'industrie du taxi face à Uber, mais expose surtout ce que les technologies savent faire de mieux, c’est-à-dire créer des marchés de plus en plus purs et parfaits. L’information ne sert pas à optimiser les revenus de l’entreprise, mais plutôt à maximiser la valeur pour l’usager !
Juin 2015, Paris est en pleine ébullition. Manifestations et violence ciblée viennent une fois de plus troubler la circulation parisienne. Cette fois cependant, ce ne sont ni les étudiants ni les syndicats qui sont dans la rue. Ce sont les chauffeurs de taxi. Ils en ont contre Uber, et en particulier, contre Uber Pop. Le gouvernement promet de donner suite. Entre temps, la cour d’appel de Paris doit statuer sur une éventuelle interdiction de cette plateforme transactionnelle. Juillet, le conflit se transpose au Québec. Le ministre des Transports, Robert Poëti, déclare ne pas exclure la suspension des permis des chauffeurs de taxi offrant le service Uber. Des « états généraux » du taxi seraient appelés. L’industrie devra se réformer selon le ministre. Curieusement, avant l’arrivée d’Uber, personne au gouvernement ne semblait remettre en question le mode de fonctionnement de cette industrie.
Tout ceci se passe au moment même où l’on évalue la valeur d’Uber, cette entreprise de la côte ouest américaine ayant vu le jour il y a une dizaine d’années, à près de 40 milliards de dollars américains. Implantée dans près de 300 villes à travers le monde, avec des revenus de plus de 2 milliards pas mois, Uber, que ce soit dans sa version opérant avec des chauffeurs de taxi reconnus ou que ce soit dans ses versions Uber X ou Uber Pop opérant avec des chauffeurs simplement inscrits au site, dérange.
Déjà, en Allemagne, le tribunal de Francfort a interdit le déploiement de l’application pour téléphone intelligent, et ce, tant que les citoyens désirant offrir leurs services comme chauffeurs ne pourront pas produire d’autorisation officielle. Bien entendu, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, Uber porte toujours la cause en appel.
L’entreprise Uber va-t-elle disparaître? Je vous parierais que non. Va-t-elle évoluer, s’adapter et bientôt s’imposer dans le paysage commercial ? Bien sûr que oui, mais non sans avoir donné un bon coup de pied aux modèles de revenus prévalant dans l’industrie du transport de passagers (taxis, mais aussi autobus). Comment peut-on en être aussi certain? Simplement parce qu’il y a de nombreux précédents d’innovations radicales en matière de modèles de revenus. Prenons le plus connu, celui de la musique. Il y a à peine 15 ans, quatre entreprises, Universal Music Group, Sony BMG, EMI et Warner Music contrôlaient plus de 90 % de la production et de la diffusion de la musique au monde. Aujourd’hui, le leader est une société qui, à l’époque, n’était même pas dans le domaine de la musique. Apple, notamment grâce à iTunes, domine désormais ce marché. Son succès s’explique en partie par sa technologie, mais elle s’explique surtout par l’audace qu’a eue cette entreprise à offrir au consommateur le maximum de valeur pour son argent. Alors que les modèles de vente de musique imposaient aux consommateurs d’acheter tout un CD contenant bien entendu les chansons recherchées, mais aussi des chansons nettement moins recherchées, voilà qu’iTunes, en toute légalité, vous permet de télécharger uniquement ce que vous souhaitez. Le modèle était loin d’être nouveau, puisque 10 ans plus tôt, des entreprises telles que Napster proposaient déjà de tels services. Que s’est-il produit pour que ce ne soit aucun des quatre joueurs majeurs qui émerge comme l’entreprise de musique ayant révolutionné l’industrie? La réponse est simple, une incapacité à vouloir revoir un modèle payant pour elles, mais sous-optimal pour les consommateurs. La suite, on la connaît.
C’est la même chose qui se produit aujourd’hui avec les Uber, Netflix et Airbnb de ce monde. Ces entreprises tablent toutes sur ce que les technologies savent faire de mieux, c’est-à-dire créer des marchés de plus en plus purs et parfaits. Vous vous souvenez de vos cours d’économie ? Ce sont ces marchés dont on disait qu’ils optimisaient la valeur d’un produit ou d’un service. Bien sûr, à une époque pas trop lointaine, nous n’y portions pas trop attention, car après tout, ces modèles étaient largement théoriques. Pourtant, on vous l’avait bien dit, on vous l’avait même enseigné, si l’information venait à être ouverte et transparente, en temps réel, de tels modèles émergeraient. Voilà, nous y sommes.
Le cas d’Uber, et en particulier sa croissance phénoménale, est un parfait exemple de tels modèles, et ce, pour deux raisons. La première est qu’il inverse le processus actuel de mise en relation entre un consommateur et un chauffeur. Dans le mode traditionnel, un appel pour un taxi passe par un répartiteur qui va optimiser, au profit de l’industrie, l’allocation d’une voiture à un client. Cette allocation se fait selon la règle du premier arrivé, premier servi. Vous avez besoin d’un taxi au coin de Peel et Sainte-Catherine? Ce sera la première voiture de la société que vous avez appelée qui aura pris l’appel qui viendra vous chercher. Si cette voiture part de Verdun et qu’il pleut, tant pis pour vous. De plus, si le chauffeur est grossier et que la voiture est sale, vous n’aurez qu’à vous plaindre au Bureau du taxi de Montréal. Leur formulaire de plainte est en ligne et ils sont ouverts du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h et le vendredi de 9 h à 16 h. Profitez-en, car après tout, une partie de la course que vous aurez payée sert à financer ce bureau !
Uber, ou tout autre service du même genre, fonctionne à l’inverse. L’information ne sert pas à optimiser les revenus de l’entreprise, mais plutôt à maximiser la valeur pour l’usager. L’application vous donne la liste des voitures disponibles près de l’endroit où vous vous situez, et le temps requis pour chacune d’elle pour aller vous chercher. Pour chacune, vous avez une évaluation produite par d’autres consommateurs de la compétence du chauffeur ainsi que de la qualité du véhicule. Après votre course, vous pourrez vous aussi produire une telle évaluation. L’information de type « consommateur à consommateur » change la donne.
Autre caractéristique du modèle Uber, le tarif variera selon le moment où vous souhaitez utiliser les services d’un taxi. Une voiture appelée un lundi matin de juillet risque de vous coûter moins cher qu’un taxi conventionnel, mais attention : la voiture appelée le soir du jour de l’an ou pour un trajet vers l’aéroport à l’heure de pointe pourrait vous coûter plus cher. Surpris? Vous ne devriez pas l’être; après tout, c’est le bon vieux point d’équilibre entre l’offre et la demande que l’on vous a enseigné il y a déjà quelques années. La différence, c’est que cette fois, il est matériel et se déroule en temps réel. Par contre, si les tarifs sont plus élevés le soir du jour de l’an, il est à prévoir que le nombre de chauffeurs disponible va augmenter en conséquence. La suite de l’histoire, vous la connaissez.
Monopoles ou oligopoles de fait, entreprises fondées sur un corporatisme latent et inefficacité de marché imposée par le producteur d’un bien ou d’un service : voilà au fond ce qui est remis en cause par les Netflix, Airbnb, Uber et autres modèles de revenus du même type, et ce n’est pas tant la technologie que ce qu’elle permet qui engendre de telles offres. Or, je vous parie que dès que les gouvernements auront trouvé de quelle façon ces nouvelles entreprises pourront leur assurer les mêmes revenus, ils les laisseront tranquilles.
Une histoire à suivre, bien entendu, et qui mériterait, pour bien la comprendre, que vous relisiez votre vieux livre de micro-économie 101. Vous l’avez jeté? Rassurez-vous, vous pouvez sûrement le lire gratuitement sur le Web!
|
Description
Alban Jarry signe pour Les Echos un article de fond sur "L'avenir de la banque traditionnelle face au risque d’uberisation". Alban Jarry est un spécialiste des stratégies de marques et de l’influence sur les réseaux sociaux professionnels. Il est l’auteur de « Twitter conté par 50 personnalités de la banque finance assurance » et « 735 utilisateurs aimantés par LinkedIn ». Depuis octobre 2013, il est Directeur Solvency 2, ORSA et Risques Stratégiques en Mutuelle et Vice Président de XBRL France. Il intervient régulièrement à HEC Paris Executive Education, France Université Numérique (FUN), l’Institut Louis Bachelier, l’Université Paris Dauphine et fait partie du conseil d’administration et du comité scientifique sur le numérique et le Big Data de l’Ecole Polytechnique d’Assurances. Il est l’auteur d’articles pour La Nouvelle Revue de Géopolitique, L’Argus de l’Assurance, La Revue Banque, La Revue Internationale de Compliance et d’Ethique des Affaires, Les Echos, L’Agefi et anime un blog (albanjarry.wordpress.com).
Uber ou Google, quel acteur viendra révolutionner le modèle bancaire dans les prochaines années ? Plus rapidement, l'arrivée d'Orange, Amazon ou des FinTech pourrait bouleverser l'équilibre du secteur.
L’actualité est sans cesse là pour nous rappeler qu’un empire peut s’écrouler du jour au lendemain. Régulièrement, comme dans le cas Volkswagen, une fraude est à l’origine de cette rupture. Dans la banque et la finance, Société Générale avec l’affaire Kerviel, BNP Paribas avec son amende record aux États-Unis, les banques suisses (Crédit Suisse et UBS en têtes)… subissent régulièrement les foudres des autorités. La crise des subprimes n’a fait qu’accentuer la visibilité de ce phénomène.
Depuis 2007, le monde de la banque ne cesse d’évoluer et de se transformer pour résister aux crises de son modèle. Il subit des chocs, ses fondations vacillent, mais jusqu’à présent, à part Lehman, Dexia et quelques autres, finalement peu ont subi des assauts suffisamment violents pour mettre en péril leurs activités.
À côté de ce phénomène, qui commence à être bien suivi dans la liste des risques dits stratégiques, la peur d’une uberisation du secteur se fait une place de plus en plus importante. Elle se matérialise par la crainte de nouveaux entrants qui viendraient bouleverser les équilibres financiers du secteur. Cette activité ultra réglementée peut-elle se retrouver attaquée dans ses fondamentaux dans les années à venir et faire l’objet d’une nouvelle vague de concurrence sans précédent ?
Anticiper les possibilités de l’avenir numérique, anticiper la dématérialisation complète de la relation entre la banque et ses clients, permet-il de disposer d’une boule de cristal de nouvelle génération ? Les FinTech, Uber, Google… Orange, Amazon, des nouveaux entrants semblent pouvoir créer à court terme une très forte rupture dans le modèle actuel.
Il y a 15 ans…
Nous sommes au début des années 2000, dans la fièvre du développement de l’internet, les banques subissent un premier assaut ou créent leurs filiales dédiées à ces nouvelles technologies. La mode des "e-banque" se lance : e-Rothschild, eCortal, e.creditlyonnais.fr. Un industriel comme Bernard Arnaud crée Zebank. Innovantes ? Probablement. Trop chères à mettre en place ? Surement ! Beaucoup ne résistent pas plus de quelques années face au peu de rentabilité de ce nouveau modèle.
Parfois, les pertes sont abyssales. Les Français n’étaient pas encore prêts à "confier" leurs économies à ces banquiers virtuels à une époque où le conseiller bancaire était encore jugé comme un proche de la famille. Le numéro de compte, un emprunt immobilier corrélé à la domiciliation du compte principal, la détention d’une assurance vie furent aussi d’importants freins au mouvement. La confiance dans ce nouveau système n’était pas encore là. Peu de consommateurs achetaient sur le net.
À l’époque, j’ai participé au projet d’e-Rothschild en tant que "client pilote". Nous devions imaginer la banque du XXIe siècle. L’effervescence autour du lancement fut incroyable dans le groupe. Le modèle était complètement disruptif dans l’univers de la banque privée. Lancée le 10 septembre 2001, elle subit de plein fouet la crise qui s’en suivit. Elle disparut quelques années plus tard. Pourtant, elle apporta de nombreuses idées et des innovations remarquables.
CRM, passage d’ordres, traitement des cartes de crédit… tout fut automatisé pour s’ouvrir une autoroute moderne. Elle fut un apport absolument extraordinaire en termes d’organisation et de modernisation de la structure informatique du groupe. Dans les filiales financières, nous avons ensuite utilisé pendant longtemps une partie de l’infrastructure mise en place. Nous avions un TGV à disposition, nous sommes montés dans le train de la modernité et de la rapidité.
Hier
Nous sommes en 2013 et 2014, une nouvelle fièvre atteint les grands groupes bancaires. Les Français ont adopté leurs smartphones, qui sont devenus leurs amis les plus proches, et la modernisation bancaire doit s’accélérer. Hello Bank ! ou Soon d’Axa arrivent pour accélérer la digitalisation de l’espace bancaire. D’une agence à l’ancienne avec ses doubles ou triples sas d’entrée, blindés, pour protéger le peu de monnaie fiduciaire encore stockée, le client passe à l’ère du numérique où tous les services deviennent accessibles au bout de ses doigts.
Ces nouvelles banques rejoignent rapidement le club des leaders survivants de la première époque comme ING Direct ou Boursorama. De nouveau, la course à la technologie s’est enclenchée pour bâtir les services du futur. De nouveau une effervescence agite le milieu. À la différence d’il y a 15 ans, peu d’acteurs externes viennent encore se mêler à la lutte.
Aujourd’hui
Trop tôt ? Trop tard ? Le débat n’est pas tranché. En 2014, sur les 70 millions de comptes à vue en France, seuls 3 millions étaient dématérialisés dans une agence en ligne. Dans le même temps, 71,3 millions de cartes SIM circulent en France, l’équipement est massif et la connexion à sa banque via un smartphone n’est plus un obstacle psychologique. Un compte sur 3 s’ouvre dans une agence en ligne et un français sur 5 envisage d’y basculer (source Brand Advocacy Index 2015 du BCG).
Tous les voyants sont au vert pour les grandes manœuvres qui s’annoncent. Pourtant, pour les banques, un obstacle majeur demeure, les banques en ligne restent peu rentables poussées à une concurrence sur les prix qui les a enfermés dans des modèles low-cost. Bascule des clients contre soucis de rentabilité. Coûts des structures d’agences physiques à intégrer dans le nouveau schéma, l’équation est d’une complexité absolue.
Demain
Pas une semaine ne passe sans annonce d’une innovation dans les Fintech. Spécialisées dans l’attaque des services les plus rentables du modèle bancaire, elles représentent un risque émergent qui devra faire ses preuves. Il faudra probablement attendre un peu avant de voir des licornes émerger de ce côté.
Annoncées pendant l’été 2015, les arrivées d’Orange et d’Amazon pour 2016 risquent de changer le paradigme. Leurs cibles ? Les clients particuliers et les PME. Innovation, faibles coûts de structures, marques reconnues et appréciées par la clientèle, tous les ingrédients sont là pour pénétrer rapidement le marché. L’absence de connaissance des techniques bancaires ne devrait pas être un problème. Orange devrait s’inspirer des techniques où elle fait fureur en Afrique et dans les pays émergents.
Paiement sans contact, rapidité des virements, souscription en quelques clics à des produits financiers… l’assurance est aussi dans le collimateur. Révolution ? Si Orange combine son offre avec une légère transformation de ses agences de téléphonie pour intégrer des DAB et convaincre les accrocs des agences physiques la pénétration peut être rapide. Quelques marques bancaires ont transformé leurs agences pour vendre de la téléphonie, la démarche inverse risque d’être autrement plus impactante.
Amazon va proposer des crédits aux PME à taux réduits. L’attaque risque d’être rude pour les banques sur un segment de marché où les marges restent importantes pour couvrir le risque de défaut de l’emprunteur. Avec le Big data et la connaissance de la santé financière des PME déjà clientes, Amazon optimisera sa gestion du risque expliquant ces taux réduits. L’offre décolle très vite à l’étranger.
Le secteur de la banque est probablement à un tournant de son histoire. Cette fois, des non-banquiers vont peut-être s’imposer. Une fois de plus tout dépendra des clients ? Si les offres sont suffisamment alléchantes, il ne fait pas de doute qu’ils les étudieront très sérieusement et que la concurrence risque d’être rude.
|
Description
Denis Jacquet. Entrepreneur du Net depuis 2000, fondateur de Parrainer la Croissance, devenue en 4 ans la plus grande association au service des entrepreneurs avec 3 600 membres avec un objectif national de 5000 dans 2 ans. Il a fondé le premier incubateur intergénérationnel, en France, qui met les seniors des grands groupes au service de la croissance des PME et start-up. Il signe cette tribune intitulée "Airbnb, Uber… La France mérite la disruption"
Les taxis feraient mieux de jeter un pavé dans la mare de l’innovation que des pavés sur les VTC transportant des enfants. L’aveuglement borné, pousse à des extrémités que rien ne justifie. Pas même l’irrespect de la Loi. Pas même une violation des règles de concurrence. Le respect de la vie humaine est au-dessus de toute loi humaine et les taxis coupables d’actes de violence, sont une sous-catégorie de l’humanité. La lie de la population. Rien ne peut leur servir de circonstance atténuante.
Uber est un acteur louable, car comme toute entreprise à succès, il exploite le besoin insatisfait d’un marché pour en faire un succès entrepreneurial. Rapide. Efficace. Magique. Le fait d’être disruptif contribue à faire bouger un monde qui se réservait à la rente et l’héritage, et oblige les acteurs concurrents à une qualité de service et à la remise en cause. Et profite ainsi à tous. C’est louable et doit être soutenu.
Uber est un acteur condamnable, car aux USA, violer la loi lui vaudrait des condamnations record, et il s’y soumettrait. Mais ici il exploite la faiblesse coupable des Européens, des Français en particulier, avec l’arrogance de ceux qui pensent que les lois ne s’appliquent qu’aux autres et que le succès excuse tous les comportements. C’est inadmissible.
Les taxis, animés par une société qui bénéficie d’un quasi-monopole, G7, bénéficient d’une rente qu’une société libre ne peut tolérer. Tout monopole est condamnable et doit être battu en brèche et « challengé ». Le sens du service n’est même pas un concept pour eux, les prix sont inadmissibles et un cadenas sur la liberté, préservant la rente, a été mis en place sous forme d’un numérus clausus et de prix de licence.
Quelles solutions pour satisfaire tout le monde ?
Enfin, ni l’arrivée de Airbnb, ni celle des VTC, n’a volé de marché aux taxis ou aux hôtels. Ils ont accru la taille du marché sans pénaliser les acteurs présents. Ils n’y perdent rien. Ils permettent notamment en période de pointe à des usagers de trouver un taxi plutôt que s’entasser dans des métros ou de…marcher ! Sans oublier que ce sont des centaines, des milliers de personnes sous-qualifiées, souvent immigrés de seconde génération, qui trouvent ainsi un espoir d’ascension sociale, de reconnaissance, d’intégration, et qui serve avec gentillesse et attention des clients, plus habitués à une radio qui hurle, un avis personnel non sollicité sur la classe politique, des discussions de café du commerce passionnantes, dans des véhicules qui rivalisent avec les conducteurs de rallye.
La solution est simple. UberPop doit continuer. La décision, prise sous la pression est une erreur grave, un refus d’ouverture. Une soumission à l’esprit de rente et un NON au monde de demain. Il suffisait d’exiger d’eux une assurance lourde, qui protège le client, un service impeccable et une certitude de taxation de leurs revenus. Et laisser le marché faire le reste. Les taxis doivent se voir, sous forme de dégrèvement fiscal, rembourser leur licence et ainsi livrer un combat à armes égales avec les VTC, sachant que le client UberPop est souvent un client qui ne prendrait pas un taxi « normal ».
Rien ne doit stopper le changement, l’innovation, la remise en cause de la rente. Mais les taxis ne sont pas des milliardaires rentiers, ce sont les sociétés qui les « exploitent » qui tirent parti de cette anomalie gauloise. Ils doivent donc s’améliorer, mais se battre à conditions équivalentes. Sinon l’innovation est un vol et non un bond vers l’avant. La France mérite la disruption, elle doit rester une terre de droit. L’Etat doit permettre l’évolution des marchés, permettre aux acteurs de s’adapter à cette évolution, mais se faire respecter pour y parvenir. Un état trop lourd étouffe. Un état faible tue son marché. Un compte pop garantira l’innovation rentrante !
Read more at
|
Description
Denis Jacquet. Entrepreneur du Net depuis 2000, fondateur de Parrainer la Croissance, devenue en 4 ans la plus grande association au service des entrepreneurs avec 3 600 membres avec un objectif national de 5000 dans 2 ans. Il a fondé le premier incubateur intergénérationnel, en France, qui met les seniors des grands groupes au service de la croissance des PME et start-up. Il signe cette tribune intitulée "La France mérite la fin du droit du travail".
Le gouvernement a annoncé une grande réforme du Code du travail, à la suite de la remise du rapport Combrexelle. Un deuxième rapport vient nourrir le débat, celui du DRH d’Orange, Bruno Mettling, concernant l’adaptation à l’ère numérique. Denis Jacquet, expert Frenchweb, livre la vision des travailleurs du numérique.
Le passé a du charme. Le passé est la clé de l’avenir, n’en déplaise aux digitaux de tous poils, qui pensent révolutionner le monde, alors qu’ils contribuent seulement à une évolution en marche depuis la naissance de l’humanité. Simplement, certaines marches, construites par l’évolution, sont plus hautes que d’autres, et certains mouvements tiennent plus du tsunami que de la vaguelette estivale. C’est le cas du digital. Mais tant que l’être humain n’aura pas été «trans-humanisé», les fondamentaux resteront les mêmes.
L’homme cherche son intérêt, son épanouissement, sa sécurité, la sienne et celle de sa tribu, et cela avant même de marcher debout et d’être plus épilé qu’il ne l’était alors. Les animaux sont régis par la même logique. Ils cherchent à maintenir (au pire) leur condition ou à l’améliorer. Et pour cela, ils souhaitent que leur environnement permette cette évolution.
Un «nouveau siècle de lumières numériques»
Notre environnement institutionnel, notre société, nos gouvernants, sont les derniers remparts, l’obstacle majeur à l’évolution d’un cadre qui doit s’adapter, non pour faire injure au passé, mais l’honneur à l’avenir. Non pour renier par principe, mais changer par nécessité. Changer, amender, et même révolutionner, n’est pas une insulte à notre héritage, mais une adaptation nécessaire pour lui permettre de rester intemporel. Et là vous vous dites, «qui est cet entrepreneur qui se croit philosophe ? Intellectuel ?». Mais justement, dans une société qui devient entrepreneuriale, ce sont peut-être les gueux, les prolétaires de l’entrepreneuriat que nous sommes, qui, par étincelle de réalisme pourraient embraser la société d’un nouveau siècle de lumières numériques. Ne soyons pas modestes, seulement bienveillant et ouverts, et proposons une société nouvelle, dans laquelle le digital soit un moyen et non une dictature.
Les Français, fatigués de cadres stricts qui leur promettaient la paix et la sécurité, le plein emploi et la lutte du faible contre le méchant riche, ont réalisé que non seulement cet opium ne leur faisait plus d’effet, mais les conduisait irrémédiablement à la misère. 10% de chômeurs, des SDF en masse, une insécurité chronique, des segments de populations ligués les uns contre les autres et des politiques démagogiques, pauvres poupées sans vision, qui agitent encore les bras au journal de 20H pour faire croire qu’ils sont vivants.
Le droit du travail est une de ces illusions. Il est le fruit d’une vision de la société. D’une structure de notre économie. D’une période qui a vu le modèle se dégrader, tout en pouvant encore durer.
Les technocrates, les syndicalistes ont tricoté de mauvais vêtements, qui craquaient de partout pour être totalement déphasés avec la réalité, et ont ainsi bâti un code du travail magnifique, que même Moïse n’aurait pu redescendre de la montage, tant il est lourd, et n’aurait pu expliquer à ses fidèles, tant il est indéchiffrable. A côté de notre code du travail, Champolion a eu un job d’été digne d’un «rubik’s cube» pour débutant.
«Depuis 13 ans, l’emploi est le fait des PME et des start-up»
Le code du travail date d’un temps où les grands groupes étaient les employeurs de notre pays. C’est terminé. L’emploi net depuis 13 ans, est le fait des PME et des start-up. Dans tous les pays développés. Le code date d’un temps où une industrie prédominante demandait des cohortes de travailleurs sous qualifiés, en situation de fragilité. Malgré une tentative médiatique d’un «redressement productif», nous voyons bien que là aussi, comme Capri, c’est fini.
Le code date d’un temps, où syndicats patronaux et salariés représentaient la majorité de leurs populations respectives. Là aussi, c’est bien fini. 6% de syndiqués et l’absence de jeunes et du numériques, à la CGPME ou au Medef, suffisent pour vous en convaincre. L’obsession du code du travail reflétait l’arrogance démagogique des politiques à vouloir préserver contre le licenciement et de contrôler ainsi autoritairement l’emploi. En voulant contrôler l’emploi, on a tué l’embauche. En diabolisant l’entreprise, on l’a chassée de France et rendu frileuse à l’emploi. 10% de chômage. 25% chez certains jeunes, et presque autant chez les seniors.
Le digital pose la touche finale à cet édifice, et en se déposant ainsi sur la société, il achève de sonner le glas de ce modèle dépassé. D’abord parce que la jeunesse n’attend plus après l’Etat pour prendre en main son avenir, elle le créé elle-même. La nouvelle génération a compris qu’elle changerait de job entre 8 et 12 fois dans sa vie, et que rechercher un CDI, une sorte d’emploi à vie, dans une entreprise dont on sait qu’on la quittera rapidement, n’a aucun sens. Elle a aussi compris, que certaines compétences clés étaient valorisables. Et elle a décidé, cette jeunesse, qu’elle les vendrait au plus offrant. Ainsi nombre de jeunes geek, et ce n’est qu’un début, se mettent à leur compte et vendent leur temps et l’organisent ainsi eux-mêmes, sans dépendre d’un droit du travail ou d’une convention collective. Ils décident seuls, de leur temps et conditions de travail. La dite Ubérisation de l’économie est en marche, et cette masse d’indépendants fuit le collectivisme imposé par la société d’avant. Ce qui ne lui enlève en aucun cas sa capacité de solidarité. Mais elle souhaite la choisir.
Les seniors délaissés par la société, se sont fait autoentrepreneurs. Il y en a 1 million en France. Ils sont indépendants et le resteront. Ils ont compris que le droit du travail leur a seulement garantit qu’il ne servait à rien, et ne les pas « garantit » d’être exclu de la société.
Le poids du code du travail «étouffe la dynamique entrepreneuriale»
Bref l’efficacité du code est inversement proportionnelle à son poids, mais son poids étouffe la dynamique entrepreneuriale. Combien de start-up, qui souhaitaient offrir à leurs recrues un salaire plus faible en échange d’actions de la société, se sont aperçues que la convention collective, signée à une époque où le digital n’existait pas, leur interdisait ?
La référence absolue au code, qui remplace le lien de confiance que les hommes peuvent avoir entre eux, a imposé des rentiers du dialogue social, qui vivent à nos dépens sans plus rien apporter au débat. A peine s’ils savent ouvrir un PC ou charger une appli. Supprimer le code du travail, ce n’est pas voler la protection aux plus faibles, c’est donner une chance aux Français de se faire à nouveau confiance, sans intermédiaire (comme sur Internet, la désintermédiation), et surtout aux entreprises de définir, ensemble, les conditions de leur collaboration. C’est surtout, la seule opportunité que nous avons de ne plus mettre un code dépassé entre la France et la Croissance.
|
Description
Jean-Christophe Berlot est ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris (1981), et titulaire d'un Master of Science de Stanford University (USA). Il démarre sa carrière comme Ingénieur de Développement puis entre dans le Conseil, où il prend en charge des missions autour de l’innovation. Il prend la direction des Achats de la Branche Eclairage et Signalisation du Groupe Valeo et fonde « Portance » en 2001, puis « Executive Portance » en 2003. Il est l’auteur de « La Crise ? C’est Moi ! » (L’Harmattan, 1997, préfacé par Yvon Gattaz) et co-auteur de « Dirigeants, que faites-vous ? Pour une approche éthique du Management » (Village Mondial, 2002, préfacé par Michel Bon), « Etre acheteur pour la première fois » (Organisation, 2007, préfacé par Thierry Morin), et « Pour une mise en œuvre rapide et maîtrisée, de la stratégie au terrain » (Organisation, 2008). Il signe cette tribune "Comment contrer l' « Uberisation »"
Des solutions existent pour faire face aux start-up qui font trembler les acteurs traditionnels. Elles reposent sur la création de valeur et la relation client.
« Ubérisation, paupérisation, précarisation » : le phénomène prend des allures de Trafalgar pour des pans entiers de l’économie. Livres, musique, films, agences de voyages hier, hôtellerie et taxis aujourd’hui, banques, santé, éducation demain : les « métiers historiques » voient leurs modes opératoires bousculés, leurs parts de marché phagocytées, leurs marges élimées par des acteurs parfois microscopiques mais infiniment agiles.
Tous les secteurs sont potentiellement impactés. Mais l’expérience montre qu’ils ne le sont pas forcément pour les raisons que l’on croit. Les majors, dotés encore de puissants moyens, cherchent la parade. Politique et juridique, pour enrayer la machine qui commence à les broyer. Entrepreneuriale, en s’ « auto-ubérisant », c’est-à-dire en intégrant eux-mêmes les principes qui font le succès des Booking, et autres Amazon. Mais ces parades, faites essentiellement de pare feux et de contre feux, sont-elles durables ? Peut-on encore se payer le luxe de ne pas saisir les améliorations de productivité associées aux « ubérisateurs » ?
Deux mécanismes contre l' « Uberisation »
Les technologies alliées à l’Internet mettent deux mécanismes en jeu. D’abord, générique à tous les services en ligne, la captation des clients. L’idée ne date pas d’hier : il s’agit de s’introduire, via le service approprié, à un point de rupture de la chaîne de valeur, au plus près du client. Les agences de voyages avaient elles-mêmes utilisé cette tactique : en proposant des « packages », elles ont détourné le contact des clients avec les transporteurs. Les courtiers d’assurance avaient opéré de même : en intégrant des services d’assureurs différents, ils ont capté leurs clients confrontés à la jungle des contrats.
L’autre mécanisme résulte de la facilité d’accès liée aux technologies de l’Internet : les clients ont à faire à des plateformes instantanées, fiables, affranchies des frontières et des coûts de production. La tentation étant de s’affranchir aussi des règlementations, lorsqu’elles font appel au public pour générer une infinité de fournisseurs potentiels. On parle des taxis aujourd’hui ; mais les agences de presse, les photographes professionnels, et de plus en plus les journalistes et les éditeurs, se trouvent aussi progressivement menacés. Les témoins d’événements sont aujourd’hui légions, téléphone à la main, trop heureux d’être publiés, y compris pour presque rien.
Se développer sans cesse
Le premier mécanisme fait depuis toujours partie de l’arsenal stratégique. Des filières entières s’en trouvent bouleversées, sans que personne n’y trouve à redire. Le second mécanisme, en revanche, est plus pernicieux, puisqu’il diminue de manière drastique le niveau de valeur ajoutée des services jusque là assurés par des professionnels. Le niveau de qualité peut y perdre (c’est le cas de la photographie et, dans une certaine mesure, de la presse) : mais les clients semblent s’en contenter. La limite de ce mécanisme est évidemment légale, tant que les nouveaux fournisseurs échappent au système fiscal et social de leur société.
Ces deux mécanismes permettent néanmoins de trouver deux parades plus durables pour les entreprises. Pour contrer la destruction du niveau de valeur, en créer sans cesse. « L’obsession de la valeur ajoutée », comme la prêchait François Dalle, le président historique de L’Oréal : « Il faut courir plus vite que les autres !». La première parade est là : développer sans cesse la valeur de ses produits et services et leurs usages. L’expérience nous montre que les entreprises ont encore un potentiel considérable devant elles.
Pour contrer la captation de ses clients, ne pas laisser subsister la moindre fracture dans la chaîne de valeur, entre le client et moi. Si je connais bien mes clients, si ma relation avec eux est forte, s’ils sentent mon entreprise en proximité avec leurs préoccupations et leurs besoins, je pourrai rester parmi leurs références.
Force est de reconnaître que le bât blesse souvent là : les entreprises se sont bardées de CRM et de données clients. Mais les connaissent-elles vraiment ? Quelle entreprise connaît, de manière exhaustive, le parc de produits qu’elle a vendus à ses clients ? Qui connaît précisément leurs usages ? Nous sommes souvent fascinés de voir à quel point chaque rencontre avec les clients des entreprises pour lesquelles nous travaillons, révèle des besoins nouveaux ou ignorés.
Notre pratique nous a donné un indicateur simple pour évaluer la qualité de relation avec ses clients : chaque produit ou service facturé X € devrait pouvoir générer au moins le même montant tout au long de sa durée de vie : en rechange, en maintenance, en contrôles divers, en conseil d’usage. Si je n’atteins pas ce montant, alors je peux me dire que mon entreprise a un double potentiel devant elle : un gisement considérable de chiffre d’affaires et de marge encore inexploré ; et, surtout en ces temps d’Ubérisation rampante, un renforcement salutaire de la relation avec ses clients. Qu’attendons-nous ?
En savoir plus sur
|
- Date de Publication: 14/09/2015
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Denis Pennel est le directeur général du Ciett, la Confédération mondiale des agences d'intérim (Adecco, Randstad, etc.). Auteur de Travailler pour soi. Quel avenir pour le travail à l'heure de la révolution individualiste ? (Seuil, 2013), il vient de publier dans l'ouvrage collectif Sociétal 2015 (Eyrolles) une tribune intitulée "Vers la fin du salariat ?"
Trends-Tendances: Vous estimez que nous avons franchi "le point culminant du salariat". Pourquoi ?
Denis Pennel: Pour trois raisons principales. Tout d'abord, notre modèle basé sur l'économie manufacturière a évolué. L'emploi standardisé sous la forme du salariat répondait à un besoin généré à l'époque par les processus de fabrication de produits standardisés de masse. Ce besoin est désormais dépassé et le CDI est devenu inadapté à la nouvelle réalité économique. Deuxièmement, les technologies contribuent à la dématérialisation du travail, qui change du coup de nature. Si les salariés ne doivent plus être fixés en un même lieu, la relation salariée perd de son intérêt. Enfin, l'une des raisons mêmes du salariat est en train de disparaître. Si le salarié accepte de renoncer à une part de ses libertés, c'est en échange d'une garantie de stabilité et de visibilité sur l'évolution de sa carrière. Or, les carrières ne sont plus ascensionnelles et le salariat ne garantit plus la sécurité de l'emploi. En France, un tiers des CDI sont rompus après un an. Le pacte est brisé.
Qui seront les gagnants et qui seront les perdants dans ce nouveau monde du travail plus individualiste ?
On risque d'assister à une polarisation du marché du travail. Les personnes hautement qualifiées, qui ont une expertise, qui sont souples et ouvertes au changement, s'en sortiront sans problème. Par ailleurs, il y aura toujours une demande pour les personnes faiblement qualifiées, notamment dans les services à la personne, comme les gardiennes d'enfant. Par contre, la catégorie intermédiaire, celle des employés de bureaux qui effectuent des tâches routinières, risque de souffrir, notamment en raison de l'automatisation croissante de certains métiers. C'est le résultat d'un processus d'"uberisation" du marché du travail.
Si c'est "la fin du salariat", quelles seront les conséquences pour notre modèle fiscal, essentiellement basé sur les cotisations des travailleurs et des employeurs ?
Tout le modèle social bâti sur le salariat est en train de s'effondrer. La sécurité sociale est condamnée si on ne la réforme pas. La solution n'est pas d'aller vers un modèle anglo-saxon, mais notre système ne doit plus être basé exclusivement sur la relation avec l'employeur. Il faut instaurer un système de droits portables, liés à l'individu, et dépendant du travail effectué, que ce soit sous forme salariée ou indépendante. Il faudra aussi, probablement, augmenter la fiscalité directe (TVA) et taxer davantage les indépendants.
|
Description
Serge Darles, directeur de l’équipe Business Technologie & Innovation au sein du groupe Keyrus, propose une vision large de l'ubérisation : 7 secteurs sont déjà en mutation. Il met ainsi en exergue les nouveaux usages induits par l’innovation dans différents secteurs, et la transformation structurelle du business des entreprises qui en découle.
Dans l’univers digital, l’innovation ne cesse d’étonner. On assiste aujourd’hui à l’avènement du web sémantique, au volume exponentiel de données, à la prédiction et recommandation en temps réel. De nouvelles prouesses sont réalisées dans le domaine de l’intelligence artificielle et des objets connectés, de l’impression 3D, la robotique ou encore dans la réalité virtuelle ou la biométrie. En réalité, ce qui surprend le plus dans l’innovation, ce sont les usages qui sont faits de ces technologies et qui induisent une transformation structurelle et durable du business des entreprises. Ce phénomène touche tous les secteurs d’activité, sans qu’il soit nécessairement identifié ou anticipé par les entreprises.
La société, avide d’expériences simplifiant le quotidien et de services apportant une réelle valeur d’usage, est à l’origine même de cette Uberisation de l’économie (cf Bruno Teboul « Uberisation = Economie déchirée ? »). cette origine réside dans la quête de gain de temps entres autres, d’argent, de sécurité, de « fun », tant avec les marques, les distributeurs, les services financiers, les services publics, les professionnels de santé, de l’énergie, de notre sécurité… Plusieurs secteurs sont déjà touchés par l’Uberisation, dont voici quelques exemples les plus parlants.
Les voitures connectées
Le secteur automobile est en pleine mutation : l’entrée en lice mi-2014 d’acteurs comme Google (Android Auto) et Apple (Carplay) dans l’habitacle de la voiture donne lieu à toutes les suppositions sur le rôle exact que chacun va vouloir occuper dans les prochaines années. Par exemple, Google irait-il jusqu’à commercialiser ses « Google cars »? La seule certitude réside dans l’orientation vers une « servicialisation » des véhicules. Des startups de la Valley surnommées les « hackers de la data », associées à des opérateurs téléphoniques, équipent déjà les voitures de boîtiers et proposent aux conducteurs des packs de services en tout genre (diagnostic, paiement de parking…).
L’agriculture
En raison de son image « traditionnelle », le secteur agricole est rarement associé aux technologies numériques de pointe. Or, l’usage de ces innovations se répand rapidement auprès des agriculteurs, car elles peuvent les aider à maximiser leurs récoltes et leurs revenus. De multiples équipements agricoles sont dorénavant connectés entre eux, exploitant également des données de géolocalisation. Cet ensemble permet de coordonner et d’optimiser le système agricole. Par exemple, des bineuses automatisées injectent des engrais azotés à une profondeur et à intervalles spécifiques, tandis qu’un semoir suit et dépose les graines directement dans le sol fertilisé.
La santé
15 millions de français souffrent de maladies chroniques, des affections de longue durée qui représentent 70% des coûts de santé. La télétransmission automatique de données de santé des patients à domicile vers les professionnels de santé permettrait un suivi continu et personnalisé pour le patient.
Autre illustration : 9,2% de la population française est âgée de plus de 75 ans, et le suivi de cette population est un enjeu majeur pour notre système de santé. Le télé-suivi quotidien des personnes âgées permettrait de réduire le nombre de séjours à l’hôpital et d’intervenir rapidement en cas de nécessité.
L’assurance
Le coeur du métier de l’assurance consiste en la protection des biens, mais il évolue vers le bien-être des assurés, l’assistance et la prévoyance. Ainsi, Axa Assistance envisage d’avoir recours à des robots dans un avenir proche afin de proposer un ensemble de services de compagnie aux personnes âgées. Serge Morelli, PDG du groupe AXA, a récemment déclaré : « un robot pourrait aider à la prise de médicaments à heures fixes ». Les robots d’accompagnement pourraient ainsi permettre aux personnes âgées de conserver une certaine autonomie en leur fournissant toute sorte d’aide et devenir un intermédiaire entre le client et le service d’assistance.
La banque
La digue érigée par les réglementations française et européenne préserve le secteur bancaire de l’entrée de nouveaux acteurs, mais le monde du paiement est en train de se standardiser et la digue commence à céder. La menace vient en particulier des services proposés par les fameux GAFA (2), comme Google Wallet et Apple Pay, qui reposent sur l’enregistrement unique des moyens de paiement sur un compte client pour ensuite régler l’ensemble des achats en toute simplicité. Facebook et Snapchat se sont récemment lancés avec un service de transfert d’argent via l’application de messagerie instantanée, pour aisément partager une addition ou rembourser un ami.
L’éducation
Les universités les plus prestigieuses des Etats-Unis – Harvard, Standford, Princeton – se targuent d’intégrer chaque année moins d’un dixième des candidats éligibles, créant ainsi un sentiment d’élitisme par la rareté, et pratiquant à l’occasion des frais de scolarité prohibitifs. Il existe aujourd’hui une alternative beaucoup moins onéreuse et totalement innovante : la nouvelle université Minerva. Celle-ci s’adresse à l’ensemble de la nouvelle élite et est basée sur une plate-forme technologique et pédagogique pensée par un expert de l’enseignement, qui supprime la sacro-sainte conférence et se focalise sur des cours collaboratifs de moins de 20 élèves.
Le secteur IT
Chacun pourrait penser qu’Amazon, Google, Microsoft, IBM sont à l’abri d’une transformation 3.0 dont ils sont aujourd’hui les fières icônes, produisant et opérant les milliers d’ordinateurs et les « data centers » à l’origine de calculs haute-performance. Or une jeune pousse du nom de Qarnot Computing, constatant que ces « datacenters » chauffent terriblement et que leur refroidissement est un gouffre énergétique, a inventé des «ordinateurs radiateurs» qui peuvent non seulement être utilisés pour produire de la puissance informatique, mais également servir à chauffer particuliers et établissements gratuitement.
C’est pourquoi les fameuses « start-ups » (Uber, Airbnb, GAFA(2)…), non entravées par un héritageidentitaire ou figées dans une approche concurrentielle, ont investi cet espace intermédiaire entre une demande toujours plus exigeante et une offre qui n’existait pas. Elles font figure d’« hackers d’industries », prenant une place de leader des écosystèmes industriels qu’elles recomposent, reléguant les acteurs institutionnels à une position de fournisseurs.
Notre conviction est que les entreprises, jeunes ou moins jeunes, peuvent et doivent se prendre en main et (re)trouver une attitude agile, innovante et entrepreneuriale. C’est à ce seul prix qu’elles trouveront leur place, qu’elles créeront de la valeur, dans ces nouveaux écosystèmes dont la finalité est une vie – la nôtre – meilleure (bien être, bien vivre, bien travailler, bien vieillir) !
|
- Date de Publication: 13/09/2015
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
L’autoentreprise : ou comment on travaillera demain, publiée par Les Echos du 11 septembre 2015
Simplification, souplesse sociale et fiscale… l’émergence de l’autoentreprise il y a 7 ans a favorisé la création d’un nouveau droit fondamental et une évolution du rapport au travail, nonobstant les remous politiques et parlementaires que le régime a dû subir.
Jamais ou presque dans l’histoire de la Ve République, un texte de loi n’a connu autant d’amendements ; l’alternance n’ayant rien arrangé à l’affaire. Aussi, suscitant des manifestations d’inquiétudes légitimes de la part de ses affiliés, un message sociétal profond, identitaire a été adressé à l’ensemble de la classe politique : créer une activité est un droit fondamental.
Ce droit fondamental à créer une entreprise est né il y a bien longtemps, mais il est resté finalement théorique, pour ne pas dire empirique. Avec des fonds, une excellente connaissance du système, de l’énergie et du temps, l’aventure entrepreneuriale pouvait prendre forme. C’est parce que notre société a muté et son économie avec que l’auto-entreprise est venue bousculer les certitudes en la matière.
Au-delà du simple droit à entreprendre, c’est la volonté de se réaliser et d’être reconnu socialement qui a pris le pas sur les schémas hiérarchiques ou paternalistes d’hier ; à savoir : se lancer sans connaissance approfondie, sans frais de départ, sans démarches administratives lourdes… Donc, être aventureux au sens noble du terme alors que la crise a atomisé le marché de l’emploi depuis 2007. C’est donc le droit de tester une idée ou un projet, de valoriser un savoir-faire. Le droit de se tester. Le droit d’apprendre la micro-économie et de créer un revenu. Le droit de devenir un actif comme les autres. C’est enfin et aussi le droit d’échouer.
Cette liberté, exercée d’ailleurs dans de nombreux autres pays au monde, amène une seconde réalité, dont tout le monde parle comme "du tournant économique du siècle" : l’uberisation. Cette tendance est poussée par la recherche de plus d'indépendance de la part des Français d’une part, et par la volonté de plus de compétitivité de la part des employeurs d’autre part, au regard des taux des charges salariales comme patronales qui amènent à rechercher, quand c’est possible, d’autres formes de main d’œuvre.
Au confluent de tout ceci, le CDI qui ne peut se réformer ou être réformé parce qu’il représente un symbole trop fort, tout comme les 35 heures, possible obstacle à toute refonte plus approfondie du droit du travail. Et pour finir, un modèle social français esseulé et à court de solutions de financement des retraites notamment.
Avec l'auto-entrepreneuriat, l’indépendance se substitue petit à petit au salariat, le travail "par missions" remplace le contrat figé, la prestation compense largement la présence pendant 35 h. De nombreux pans de l’économie l’expérimentent : nouvelles technologies, secrétariat, conseils techniques et de gestion, monde du spectacle, journalisme, taxis, télévente, services de maintenance et de ménage… Des flots d’autoentrepreneurs travaillent pour le compte d’entreprises qui ne salarient plus !
Le salariat n’est plus la forme optimale du travail pour les entreprises ni pour ses collaborateurs. Il est même oublié pour la grande population des demandeurs d’emploi qui ont pensé pouvoir retrouver un "salaire" avant de réaliser qu’ils pouvaient chercher un "revenu".
Si les Trente Glorieuses avaient sanctuarisé la protection sociale et la société dite "salariale", l’ère est désormais à l’émergence de "salariés indépendants", cumulant plusieurs emplois ou sources de revenus. Hélas, par manque de courage ou de lucidité, elle n’est ni envisagée ni souhaitée par les grandes parties au débat.
Le législateur doit en urgence s'en emparer, au risque de se faire déborder et réinventer les bases du dialogue social avec les syndicats, qui le rejettent jusqu’à présent ; ne maîtrisant pas le nouveau rapport de force qu’il faudra créer. Les institutions publiques, l’URSSAF en tête, peinent aussi à l’envisager et les juridictions rappellent régulièrement la prépondérance du modèle "100 % salarial" à l’occasion d’arrêts en Cour de cassation ou en Conseil d’État.
Alors oui, l’autoentreprise a l’avenir devant elle. Ce n’est ni en changeant son nom, ni en niant son intérêt qu’on en minimisera son impact. Son développement est inexorable, tout comme la réforme de notre modèle social est inévitable !
|