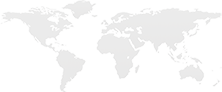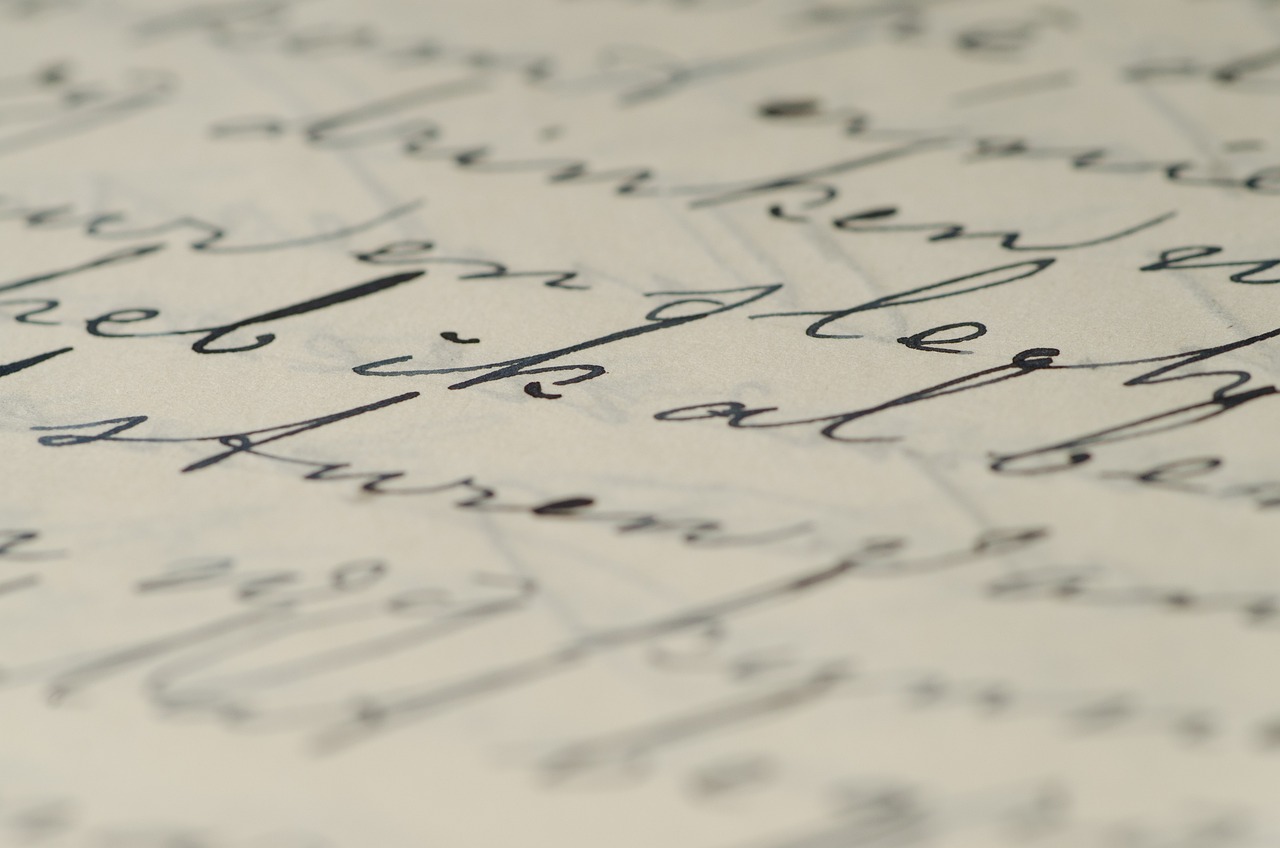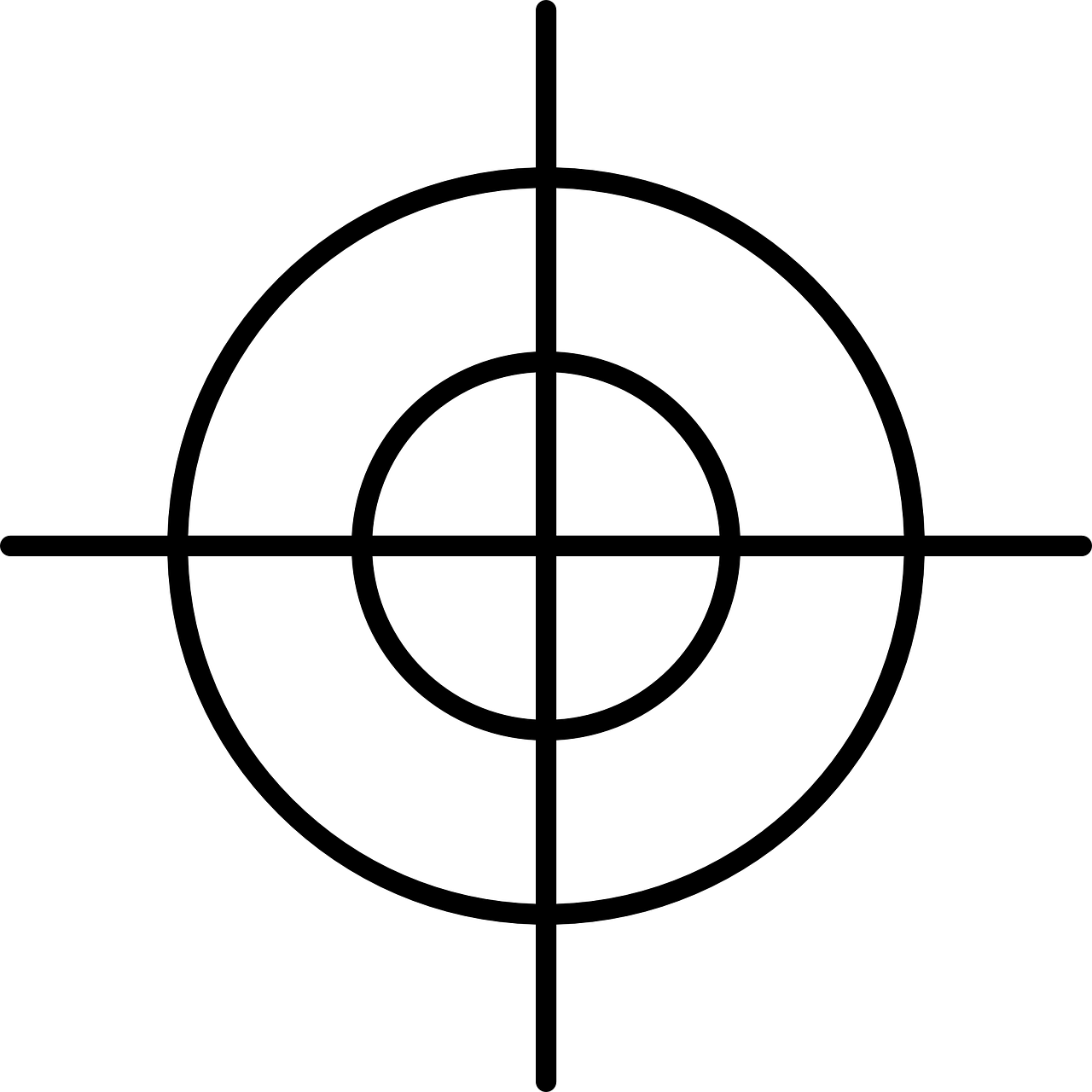Mathilde Damgé a publié dans le Monde un article très complet sur le sujet. Intitulé "De quoi l’« uberisation » est-elle le nom ?", il revient sur 5 exemples qui illustrent le phénomène.
Les réseaux sociaux utilisent depuis quelques mois le terme d’« uberisation », un néologisme formé à partir du nom d’Uber, la fameuse société de transport californienne. Ils s’en gargarisent même depuis les incidents des derniers jours entre les taxis et les VTC (voitures de transport avec chauffeur) :
Entre numérisation et paupérisation, que recoupe ce terme, qui sert d’étendard aux détracteurs de plusieurs réalités économiques ? Le tour du concept en 5 exemples.
Les taxis
CE QUI EST CRITIQUÉ : LA PRÉCARISATION
Au-delà de leur cas personnel et des conséquences sur leur profession, les taxis dénoncent « la précarisation des chauffeurs » de VTC. Dans le cas d’UberPop, qui risque de disparaître, la précarité est encore plus importante. En effet, rappelle l’économiste Evariste Lefeuvre, Uber considère ses chauffeurs comme des contractants individuels auxquels incombe la charge du financement des véhicules et assurances.
« Le capital détenu par la personne dont le revenu (et non le salaire) dépend de sa capacité à exploiter le réseau offert par les grandes entreprises présente un coup de portage, d’assurance et d’amortissement qu’il doit lui-même assumer – même en cas de baisse d’activité. »
Cette critique, l’hebdomadaire britannique The Economist en a fait sa « une » en ce début d’année 2015. Titré « workers on tap » (« main-d’œuvre à la demande »), l’article utilise l’image d’une force de travail disponible comme l’eau sortant d’un robinet, que l’on ouvre ou que l’on ferme à volonté.
De fait, sauf en Californie où l’entreprise sera obligée de les embaucher, les chauffeurs d’Uber sont une force de travail payée au pourcentage, sans ou avec très peu de protection sociale et bien sûr aucun avantage de salarié, mais une grande liberté d’organisation – du moins en apparence – de leurs emplois du temps.
En réalité, analyse le théoricien de l’économie collaborative Michel Bauwens, « Uber ne relève pas de cette économie collaborative ou de partage. Il s’agit plutôt d’une mise sur le marché de ressources qui, jusque-là, n’étaient pas utilisées. La différence entre une production pair à pair et Uber, c’est le morcellement du travail, la mise en concurrence entre les travailleurs pour obtenir un service, sans qu’ils aient accès à ce service, ce bien commun, en l’occurrence l’algorithme contrôlé par la firme. »
Lire aussi : Michel Bauwens : « Uber et Airbnb n’ont rien à voir avec l’économie de partage »
CE QUI EST CRAINT : L’ÉVOLUTION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE
Face à ces arguments, les entreprises de VTC répliquent que ce que critiquent réellement les taxis, c’est la contestation de leur monopole et le changement de paradigme : il n’est plus nécessaire d’acheter une licence et de rentrer dans un quota fixe de chauffeurs.
Pour François Meunier, professeur de finance à l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique, Uber « promet de bousculer en profondeur la profession de taxi. Dans la pratique du métier, c’est une bonne chose ». Une des solutions serait, selon lui, de « multiplier le nombre des plaques et d’imposer une régulation qui oblige tout chauffeur, Uber ou pas, exerçant l’activité de transport de personnes en milieu urbain de façon régulière, à acquérir lui aussi une licence ».
Les libraires
CE QUI EST CRITIQUÉ : L’INTÉGRATION DE SERVICES
« Depuis deux ans, la France subit une tectonique de fermetures de libraires. En 2013, Virgin a mis la clé sous la porte. En 2014, 57 librairies Chapitre ont baissé le rideau », rappelle Olivier Frébourg, écrivain et éditeur, dans une tribune publiée dans Le Monde. Mais, pour lui, ce n’est pas seulement la librairie qui est en jeu :
« Favoriser le développement du numérique, c’est nécessairement tuer les intermédiaires donc la diffusion, la distribution et, dans un second temps, la librairie française. »
Car, outre la distribution, Amazon a investi l’édition avec Amazon Publishing qui propose à des auteurs amateurs de publier leur œuvre de façon électronique. La force de frappe du géant américain est encore amplifiée par l’intégration de moyens logistiques permettant d’assurer une livraison rapide et peu onéreuse.
Amazon, depuis 2005, permet même via son « mechanical turk » de proposer une offre d’emploi aux autres internautes : recherche et indexation de contenu, travail de veille, etc.
CE QUI EST CRAINT : L’ÉVOLUTION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE
Chacun des segments concernés par la révolution Amazon (édition, impression, distribution…) semble incapable de lutter contre cette intégration de métiers.
Hachette, qui s’était opposé à la politique tarifaire d’Amazon aux Etats-Unis, a dû faire face à des mesures de rétorsion : délais de livraison allongés, impossibilité d’effectuer des précommandes et suppression d’éventuelles réductions sur les livres. L’accord trouvé en fin d’année dernière stipule que l’éditeur français fixera les prix de vente sur Amazon.com mais qu’il « bénéficiera de conditions plus avantageuses s’il baisse ses prix ».
Le seul concurrent de la multinationale dans l’Hexagone, la Fnac, a choisi de se diversifier sur d’autres produits, dont l’électroménager.
Les hôteliers
CE QUI EST CRITIQUÉ : LA DÉSINTERMÉDIATION
De plus en plus populaire, AirBnb est dans le viseur des professionnels du tourisme, dont l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih), qui s’inquiète de leur manque à gagner et qui font pression sur le gouvernement pour renforcer la législation sur ce type de location.
Leur principal argument : la suppression des intermédiaires, eux en l’occurrence :
« Le secteur des cafés, hôtels, restaurants et établissements de nuit est traditionnellement créateur d’emplois… [Ces entreprises] emploient un million de personnes en France. Confrontées à une explosion de la concurrence déloyale liée à la multiplication de toutes les formes de commerces illégaux, en 2014, pour la première fois depuis très longtemps, il n’y a pas eu de création d’emploi et les cessations d’activités augmentent… »
CE QUI EST CRAINT : L’ÉVOLUTION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE
Les professionnels le reconnaissent d’ailleurs à demi-mot, pointant le développement d’une « économie de l’ombre » :
« Les professionnels constatent une explosion de la concurrence déloyale liée à la multiplication de toutes les formes de commerces illégaux, notamment la location meublée touristique. Cette activité se développe de manière exponentielle, sans aucun contrôle, et en abusant, la plupart du temps, du flou juridique et devient dans la plupart des cas des activités hôtelières déguisées qui se professionnalisent. »
Pour Denis Thienard, directeur de l’Umih en Gironde, l’arrivée de ces sites peut être « une bonne chose », « bousculés comme nous le sommes avec les propositions de locations de meublés ou encore les plateformes de réservation de chambres ». Mais, ajoute-t-il, la remise en question de la profession est surtout le cas des grands acteurs du secteur. « C’est plus compliqué pour l’immense majorité de nos adhérents qui sont des toutes petites entreprises. »
Les avocats
CE QUI EST CRITIQUÉ : L’EXERCICE ILLÉGAL DU DROIT
De nombreux services juridiques sur Internet proposent une aide en ligne aux justiciables, facturée moins d’une centaine d’euros, afin de préparer leur dossier de saisine du tribunal d’instance, du juge de proximité ou du conseil des prud’hommes – juridictions devant lesquelles l’assistance d’un avocat n’est pas toujours obligatoire.
Face à cette concurrence qu’il juge déloyale, l’Ordre des avocats porte régulièrement plainte pour « exercice illégal du droit » contre ceux qu’il appelle les « pirates » ou les « braconniers » du droit. Ironie de la situation, les notaires reprochent exactement la même chose aux avocats qui veulent empiéter sur leur terrain en rédigeant des actes immobilier. Quand les professions réglementées s’affrontent entre elles…
CE QUI EST CRAINT : L’ÉVOLUTION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE
Les trois créateurs d’une plateforme de services juridiques en ligne, expliquent dans une tribune publiée récemment :
« Concrètement, les innovations qui incarnent ce processus d’uberisation sont de trois ordres : de nouvelles solutions logicielles basées sur des algorithmes de génération documentaire, des outils sémantiques permettant de proposer des solutions juridiques directement à partir des requêtes Web des utilisateurs, et toutes les innovations liées au big data et appliquées au droit. »
De telles innovations permettent en effet aux clients de ne pas avoir recours à un avocat et de faire de façon autonome un certain nombre de démarches juridiques et administratives : création d’entreprise, recrutement de salariés, recouvrement de factures impayées, protection des marques, etc.
Les banques et les assurances
CE QUI EST CRITIQUÉ : LA DÉMATÉRIALISATION
Dans une autre tribune, publiée en avril dernier, deux financiers s’inquiètent de l’uberisation du secteur « banque-finance », définissant le terme comme un néologisme qui renvoie à la numérisation de l’économie :
« On peut imaginer les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) et autre fintech [contraction de sociétés financières et technologiques] prendre position sur des évolutions du business model bancaire et financier, en séduisant l’opinion par une approche nouvelle. Google peut offrir – c’est-à-dire rendre gratuits – de nombreux services bancaires puisqu’elle vendra les informations consommateurs recueillies. »
Les auteurs soulignent enfin l’évolution du secteur vers des « services à bas prix mais à faible valeur ajoutée ».
CE QUI EST CRAINT : L’ÉVOLUTION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE
Un point de vue que ne partagent pas des « pureplayers » bancaires comme Compte Nickel ; son fondateur, Hugues Le Bret, estime ainsi que la tenue de compte « n’est plus un métier à valeur bancaire, mais technologique ».
Autre exemple : l’assurance, qui voit son modèle économique évoluer avec les objets connectés, comme des boîtiers mesurant la sécurité de la conduite (niveau de freinage, anticipation des virages). Avec ce système, un bon conducteur pourra réduire sa facture mensuelle jusqu’à 50 %. A l’inverse, un chauffard pourra voir sa note augmenter jusqu’à 10 %.
CONCLUSION
Plutôt qu’une critique construite d’une nouvelle économie, le terme d’uberisation sert davantage de fourre-tout désignant les craintes de plusieurs secteurs d’activité qui voient leur modèle de rentabilité bouleversé. Ce que résume bien son inventeur, le publicitaire Maurice Lévy, dans une interview au quotidien britannique Financial Times :
« Tout le monde commence à craindre de se faire uberiser. C’est l’idée qu’on se réveille soudainement en découvrant que son activité historique a disparu… »