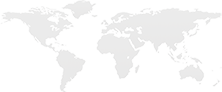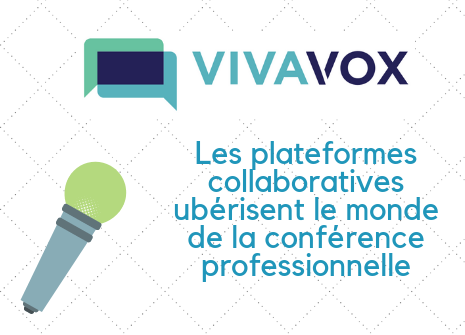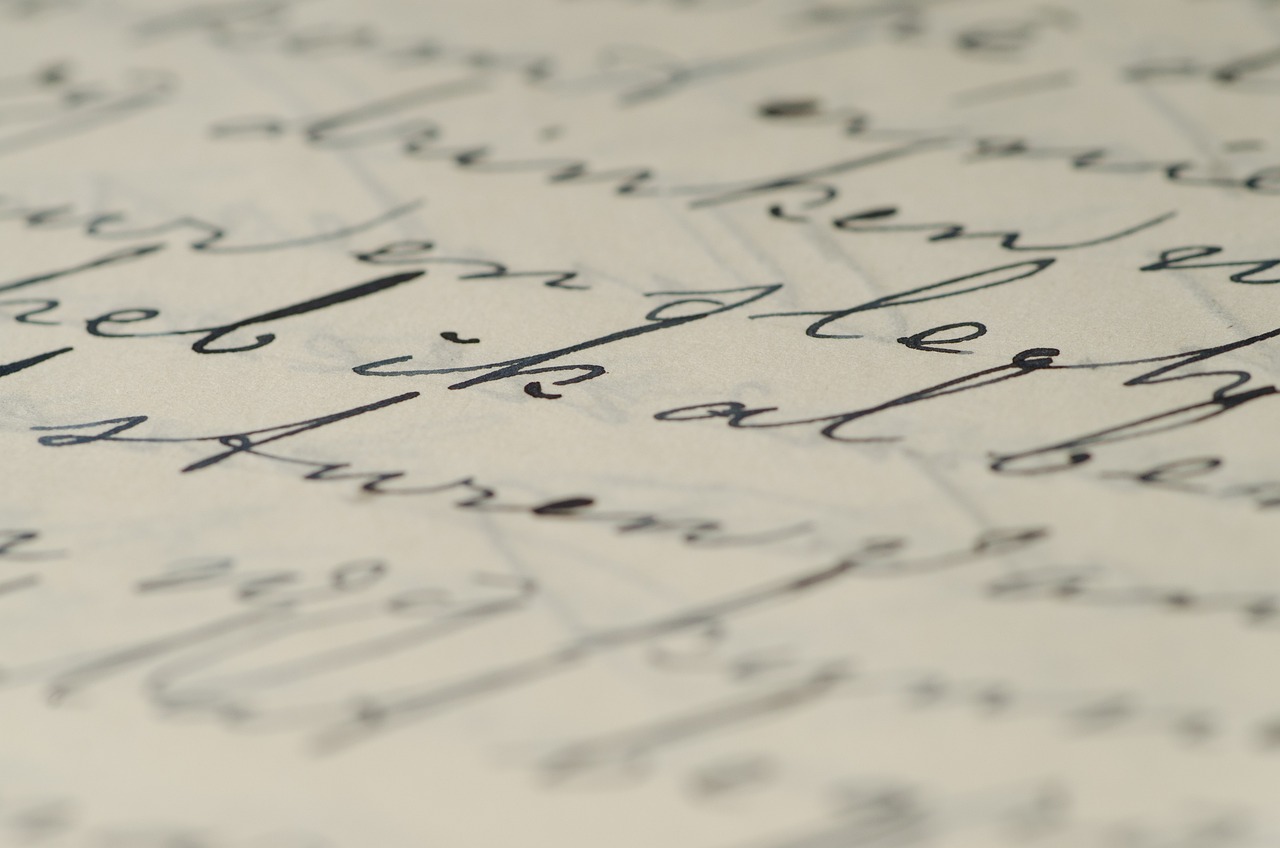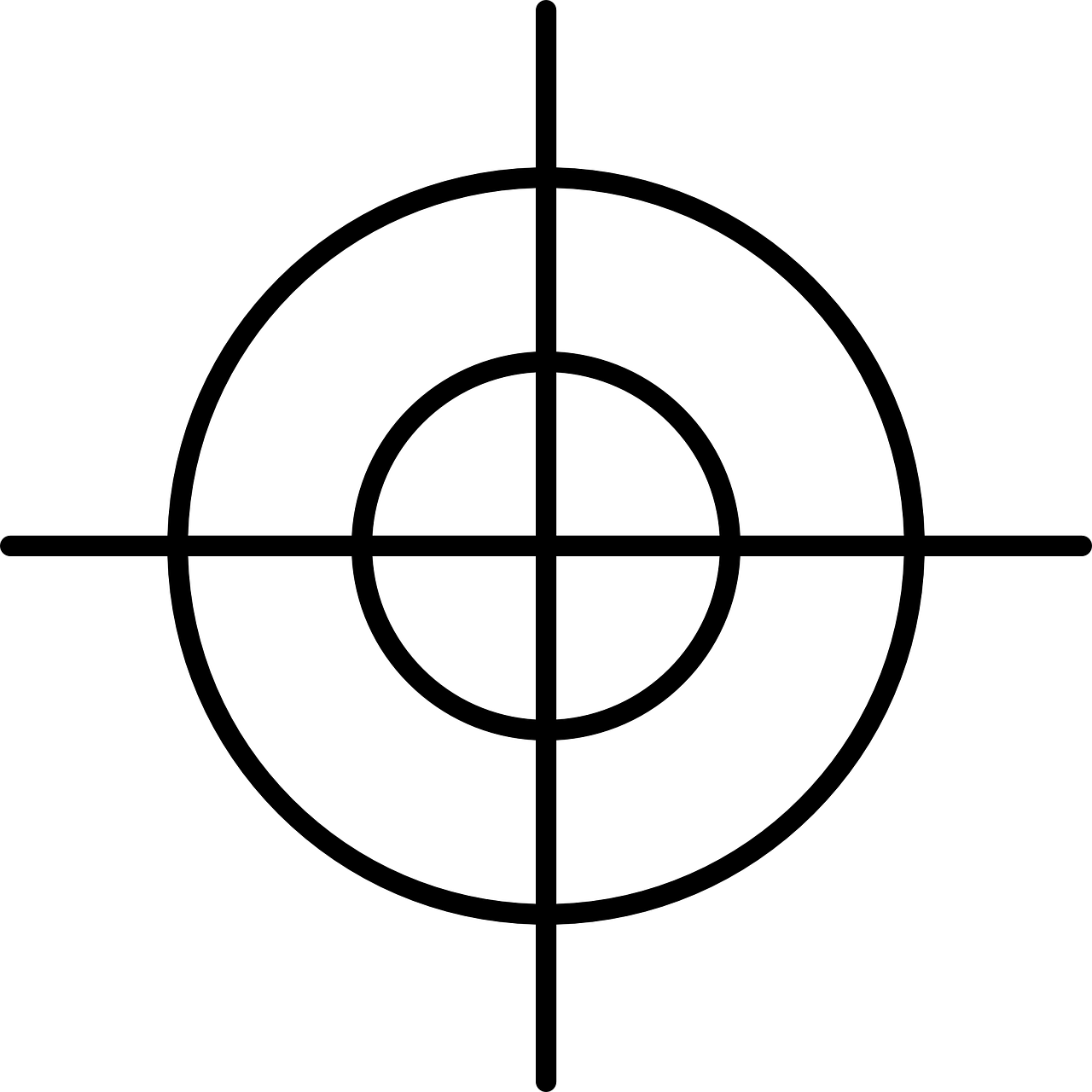- Date de Publication: 05/03/2020
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Par Bertrand Mozolenski, fondateur et CEO d'izispik
Izispik.com est une plateforme de cours de langues en visioconférence créée à l’automne 2019, avec déjà plus de 150 professeurs particuliers freelance qui dispensent des cours d’anglais, d’espagnol, d’allemand, d’italien, de russe, de chinois, de polonais… Les professeurs sont sélectionnés, testés, et 50% des cours particuliers sont en dessous de 10 euros de l’heure. L’offre est très flexible, vous réservez directement sur le calendrier en ligne du professeur, le système de paiement est entièrement sécurisé et le vidéo-chat (équivalent de Skype) est inclus. Les cours particuliers dispensés sur izispik, très efficaces pour progresser à l’oral, s'adressent à tous les niveaux et tous les âges.
Comment est née l’idée de cette plateforme de cours de langues en visioconférence ?
Agé de 37 ans, je suis un ancien officier supérieur des Armées, ayant principalement servi au sein de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Mon épouse étant diplomate, elle a été mutée récemment à l’étranger au sein de l’ambassade de France à Kiev. Pour ma part, j’arrivais à la fin d’une première partie de carrière militaire, et nous avons pris la décision commune de vivre cette aventure d’expatriation. En arrivant en Ukraine, j’ai souhaité dépoussiérer mon niveau dans les langues étrangères que j’avais apprises, à savoir l’anglais et le russe. Je me suis ainsi rendu compte rapidement que le niveau moyen en langues des Français à l’étranger, et des Français de manière générale, était en deçà de celui de bon nombre d’autres nationalités. En Europe centrale et orientale, il existe un vivier de professeurs de langues freelance extrêmement important. Les professeurs sont de qualité, donnent souvent leur cours en visioconférence, et il s’agit d’une offre que nous retrouvons très peu sur le marché français. D’où l’idée d’izispik.com !
Quelle est votre cible clientèle ?
Sur le plan géographique, les clients sont aujourd’hui davantage localisés en France, mais la proportion de clients étrangers devrait rapidement atteindre les 50%. La typologie des clients est assez vaste car elle concerne à la fois les enfants qu’il est nécessaire d’éveiller à l’apprentissage des langues étrangères, les adolescents et les étudiants qui se doivent de réussir scolairement, les actifs qui ont besoin des langues étrangères sur le plan professionnel, les jeunes retraités qui souhaitent voyager et qui se sentent parfois frustrés de ne pouvoir s’exprimer même basiquement à l’étranger. Etre homologué afin de rendre compatible l’offre d’izispik et l’utilisation du compte professionnel de formation est également un objectif à court terme.
Avez-vous besoin de fonds ou de compétences supplémentaires ?
Une Start-Up a toujours besoin de fonds et de compétences afin de pouvoir poursuivre son aventure ! A ce titre, je suis actuellement dans une phase de prospection afin de lever des fonds auprès de Business Angels en les faisant entrer au capital, et je suis également à la recherche d’un (ou deux) cofondateur(s) qui seraient en mesure d’apporter des compétences complémentaires à celles de l’équipe actuelle, à savoir pousuivre la partie développement technique (programmation du site internet et de l’application mobile) et accentuer le marketing autour de l’offre. A bon entendeur ! : )
En quoi votre offre est-elle différente de celle du marché actuel ?
Izispik.com n’est pas simplement une offre attractive en matière de tarifs. Prendre des cours particuliers avec un professeur qui vit à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres relève d’une véritable rencontre culturelle, c’est extrêmement riche ! Par ailleurs, en France nous ne mettons que très peu l’accent sur la pratique orale des langues étrangères, l’offre d’izispik répond à cette carence en permettant de gagner rapidement en fluidité et de se sentir déjà à l’aise après quelques séances. L’inscription est sans abonnement et sans engagement, ce sont des cours à la carte, vous pouvez donc sereinement jeter un œil à l’offre d’izispik.com, progression rapide garantie !
Pour toute information, contactez izispik.com
|
- Date de Publication: 09/10/2018
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Par Fabien Jeanne, président fondateur de la plateforme collaborative www.vivavox.fr
En juin dernier était lancée la première plateforme collaborative venant bousculer le monde de la conférence professionnelle. Un outil mettant en relation automatiquement et sans intermédiaire les conférenciers et les organisateurs d’événements. Une expérience client novatrice permettant de sélectionner de façon ludique et interactive parmi un grand choix d’intervenants, de consulter les avis des clients précédents et de livrer à son tour sa propre impression. Un échange gagnant-gagnant instaurant une relation de confiance.
Diversifier l’offre, garantir le juste prix
Chaque année en France se déroulent 15 à 20 000 conférences professionnelles organisées par des entreprises de toutes tailles, des agences événementielles et de communication, des organismes publics, des écoles, des associations et des groupements professionnels. Pourtant une minorité d’intervenants (une centaine sur plusieurs milliers) truste la très grande majorité des tribunes des organisations (plus de 50 %), grâce la plupart du temps à leur couverture médiatique et/ou à leur présence au sein des agences traditionnelles de speakers (qui disposent toutes des mêmes portefeuilles de conférenciers confirmés, l’exclusivité étant extrêmement rare dans ce milieu). Le tout se déroulant dans un contexte d’opacité des prix…
VivaVox est une plateforme collaborative qui propose de se passer de l’intermédiation par une mise en relation automatique entre les organisateurs d’événements et les conférenciers. Elle diversifie l’offre en proposant une vitrine à l’ensemble des intervenants, qu’ils soient expérimentés, en pleine ascension ou débutants. Elle offre une baisse des prix par la réduction des coûts d’intermédiation (10 % fixe contre 30 % en moyenne dans une agence traditionnelle).
Plus de transparence et de partage d’information
VivaVox instaure une relation de confiance et de transparence entre les entreprises et les organisateurs sur la base d’un juste tarif de collaboration (le prix unique affiché est défini librement par le conférencier et applicable à tous sans commission d’intermédiation en sus). Il ne s’agit plus d’un prix aléatoire déterminé par une agence ou un conférencier en fonction du client.
La plateforme assure une communication active sur les réseaux sociaux professionnels, notamment LinkedIn, pour offrir encore plus de visibilité aux conférenciers auprès des professionnels de l’organisation d’événements, dans une démarche de partage de l’information inédite pour le secteur.
L’expérience client au cœur de la réussite
Cette plateforme se veut l’Agora numérique du 21e siècle. Elle a vocation à réunir le plus grand nombre d’orateurs, intellectuels, penseurs et acteurs, de tous horizons, afin de nourrir le débat d’idées plurielles et contradictoires et faire naître l’innovation. Les enjeux de l’intelligence artificielle par exemple peuvent être abordés par un philosophe, mais aussi un économiste, un scientifique, un enseignant-chercheur, un chef d’entreprise, un consultant, un start-upper, un informaticien, un sociologue, un anthropologue, un médecin, un expert des matières premières, ou encore un journaliste spécialisé… Tout dépend des attentes du client qui pourra choisir par lui-même l’intervenant sur la base de filtres de recherche (thématiques, métier de l’intervenant, budget, caractéristiques de l’intervention, nombre de conférences par an, âge…) et de l’évaluation des clients des précédentes interventions (notations, recommandations, témoignages).
La plateforme valorise donc naturellement les conférenciers les plus appréciés des clients. Plus un speaker est sollicité en ligne plus son profil est mis en avant par les retours-clients. Il bénéficie des meilleures évaluations et obtient beaucoup de recommandations. Un cercle vertueux s’instaure. Ainsi, à l’instar de AirBnb ou de Malt, VivaVox multiplie les opportunités pour les conférenciers préférés des entreprises. De son côté, la plateforme met en avant ses coups de cœur et les conférenciers identifiés comme appartenant à « la relève », afin de garantir une visibilité aux jeunes pousses prometteuses.
L’idée est donc d’offrir plus de voix aux conférenciers et plus de libertés et de garanties aux organisateurs. Pour que Vivent toutes les Voix !
|
- Date de Publication: 22/05/2017
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Par Grégoire Leclercq, cofondateur Observatoire de l’Ubérisation, ancien officier de gendarmerie, et Laurent Selles, fondateur de Guardio
Santé, transport, tourisme, restauration, logistique, petite livraison, artisanat, beauté : de nombreux secteurs racontent comment ils se font bousculer par des startups agiles et innovantes sachant savamment manier nouvelles technologies (plateformes internet, IoT, Big Data, IA et Robotisation) et modèles économiques (modèle flexible de désintermédiation ayant recours aux indépendants). Tour d’horizon dans le monde de la sécurité.
Un secteur large
Sécurité régalienne (Gendarmerie, Police, Services de Secours, etc.) ou sécurité privée (Sociétés de sécurité privée, éditeurs de logiciels, fabricants de matériel), ce secteur couvre de multiples missions (Contre Terrorisme, renseignement, police judiciaire et administrative, secours aux personnes, surveillance des biens, télésurveillance, systèmes d’alarme, cybersécurité, sécurité informatique…). Pour près de 60 milliards d’euros par an, il emploie 330 000 salariés rien que dans le privé.
Les 250 acteurs majeurs de la sécurité (dont Securitas, Prosegur) de plus de 500 salariés captent les ⅔ du marché de la surveillance humaine en vendant à grande échelle le métier d’agent de sécurité. Métier parfois décrié mais contrôlé et régulé depuis 2012 (date de création du Conseil National des Activités Privées de Sécurité). Cependant, les stratégies de protection et de sécurité ne sauraient se limiter au seul déploiement d’agents de sécurité. On parle ainsi de technologies variées, allant de la vidéosurveillance à la détection d’intrusion, de la domotique aux objets connectés (qui ouvrent aux particuliers un marché jusqu’alors essentiellement tourné vers les professionnels). L’autosurveillance offre par exemple la possibilité d’être alerté par sa caméra connectée dès lors qu’elle détecte un mouvement: une notification est envoyée sur votre smartphone et une intervention permet de lever les doutes si nécessaire.
L’Ubérisation de la sécurité privée
Avec 170 000 agents de sécurité, soit près de trois fois plus que de chauffeurs de taxis, et un contexte de très forte demande suite aux attentats, le modèle de plateforme d’« agent de sécurité à la demande » émerge. Comment trouver un agent de sécurité ? A quel prix ? comment payer ? Quand est-il disponible ? Pour répondre à ces questions, Guardio a appliqué le « modèle Uber » à la sécurité privée et permet de réserver simplement les services d’agents de sécurité, partout en France. Les demandes en ligne des clients sont redirigées vers des prestataires sélectionnés et triés sur le volet. Le prestataire acceptant la demande en premier est rémunéré via la plateforme après que Guardio a prélevé le client. Le prestataire et le client sont invités à noter et commenter l’expérience à la suite du service.
Résultat immédiat : Guardio s’appuye sur plusieurs milliers d’agents répartis sur tout le territoire et offre leurs services aux professionnels comme aux particuliers, un développement qui a valu à la startup une nomination aux Trophées de la Sécurité.
Plus de données, plus de risques
L’autre enjeu posé par ce modèle (et notamment par les systèmes collaboratifs) concerne la donnée. Ces plateformes collectent une donnée immense, très fiable, géolocalisée, de façon permanente et très ouverte. Cela pose des questions de fond sur de nombreux cas d’usage :
- Je tague sur Facebook mes amis : son moteur de reconnaissance faciale est devenu l’acteur mondial numéro 1 d’identification de visages (programme DeepFace et acquisition récente de FacioMetrics, startup spécialisée dans le domaine)
- Je laisse les empreintes de mes déplacements du fait de la géolocalisation permanente de mon smartphone : un hacker en herbe peut de manière quasi instantanée retrouver ma position, et donc me nuire, ou cambrioler sereinement mon domicile car me sachant à l’autre bout du pays. Le cas d’usage est identique en matière de domotique (piratage des webcams, caméras de surveillance ou autres systèmes de pilotage de la maison)
- Je signale sur Waze la position des forces de l’ordre : quel jeu d’enfant pour les braqueurs ou les dealers en Go-Fast que de les éviter désormais !
Ubérisation et intégration des données : deux leviers pour mieux protéger
L’ubérisation de la sécurité transfère sur la toile une expérience qui était jusqu’alors entièrement hors ligne et optimise notre sécurité. De même avec la donnée consolidée et intégrée qui devient la fondation d’une intelligence augmentée : me sachant à l’étranger, mon système d’alarme ajuste automatiquement sa sensibilité aux intrusions et sollicite directement une intervention.
L’homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique - Albert Einstein
L’avenir incontournable de la plateforme collaborative dans la sécurité est donc d’évoluer en véritable plateforme technologique, connectant les acteurs humains, les alertant intelligemment et leur offrant les moyens d’intervenir de manière adéquate dans les situations à risque. Pour mieux protéger, l’agent de sécurité devient 100% connecté. Et demain ? L’agent de sécurité du futur sera-t-il un robot ? Autonome et intelligent ?
|
Description
François Hurel est président de l'UAE et publie cette tribune : "Ne réduisons pas le débat sur les indépendants à l’ubérisation". A retrouver sur le site de l'UAE
Les nouvelles formes de travail induites par le développement des plates-formes numériques changent notre modèle. Elles ne sont pas les seules à le faire. Face à la flexibilité subie ou recherchée, il faut pouvoir opposer une sécurité pour tous les indépendants.
Accorder un revenu de base à tous les Français, permettre aux jeunes de démarrer avec un patrimoine universel en leur octroyant un prêt, créer un statut général du travailleur indépendant adossé à une protection sociale... Les réflexions autour de nouvelles protections seront au coeur du débat présidentiel qui s'ouvre. On peut y voir le signe d'un marché du travail à bout de souffle, mais aussi celui d'une prise de conscience de la nécessité de faire évoluer notre modèle social désormais inadapté aux nouvelles formes de travail. Car l'avènement de l'économie numérique, un chômage latent, mais aussi une certaine aspiration à l'indépendance et à la liberté ont profondément transformé le travail, et surtout le regard porté par nos concitoyens sur le travail. La pluriactivité est devenue si fréquente qu'elle en est presque devenue une règle. L'essor du travail indépendant, porté par l'émergence des plates-formes numériques et le développement du travail en mode projet, ne se dément pas. Et même le salariat n'apparaît plus aussi protecteur quand le licenciement économique est facilité. Face à cette flexibilité subie ou recherchée, il faut pouvoir opposer une sécurité pour toutes les facettes que revêt désormais l'activité, en proposant à l'ensemble des actifs une protection sociale équivalente incluse dans un véritable « droit de l'activité ».
Cette réflexion doit s'engager sur des fondements partagés et intangibles. Tout d'abord, l'universalité d'une nouvelle protection pour les travailleurs indépendants. Car, s'il est vrai que, du chauffeur Uber au designer free-lance, en passant par l'entrepreneur souhaitant tester son activité, les profils des 13 millions de travailleurs indépendants (étude McKinsey) illustrent la grande diversité des situations, le droit doit prendre en compte cette tendance de fond dans son ensemble et ne surtout pas se morceler en fonction des caractéristiques des uns ou des autres. C'est pourquoi l'instauration d'une responsabilité sociale des plates-formes collaboratives, celles fixant un prix, par la loi travail apparaît peu pertinente. Pourquoi améliorer la protection sociale des seuls travailleurs indépendants utilisant ces plates-formes en leur octroyant des droits supplémentaires et exclure tous les autres, créant ainsi un régime à deux vitesses ? Ce serait la pire des recettes ! Les travailleurs indépendants, qui se définissent et se distinguent des salariés par le risque économique qu'ils supportent, doivent être appréhendés de la même manière en dépit de leur formidable diversité. Ils sont une chance pour notre pays, donnons-leur justement toutes les chances !
Second fondement qui devra guider la réforme des protections sociales, l'équité. Il nous faut en effet voir plus loin et sortir de la discrimination entre salariés et travailleurs indépendants sur laquelle repose notre modèle de protection sociale en enclenchant une véritable convergence des protections. Cela passe d'abord par la mise en place d'amortisseurs sociaux ouverts aux indépendants, et notamment d'une allocation perte subite d'activité qui serait financée conjointement avec les donneurs d'ordre. Le système de retraite doit également être rendu plus équitable, car il n'est pas acceptable que les travailleurs indépendants continuent de bénéficier d'une validation trimestrielle bien inférieure pour un même niveau de revenu qu'un salarié. Enfin, si le volet assurance-maladie, sujet de clivage politique majeur, est actuellement le moins inégalitaire, des divergences subsistent. Comment justifier qu'un travailleur indépendant ne puisse bénéficier d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie ou de congé maternité ou paternité ?
Protéger l'ensemble des travailleurs indépendants, depuis les plus fragiles qui ont créé leur activité mais dont les revenus ne leur permettent pas d'accéder à un minimum de droits sociaux jusqu'aux professionnels libéraux les plus aisés, résoudrait de fait la question de la requalification, mise en lumière par l'affaire Uber-Urssaf, qui trouverait ainsi un dénouement positif pour l'ensemble des parties. Donner à tous les travailleurs des protections équitables serait aussi un fantastique appel d'air pour l'activité. J'appelle les personnalités politiques qui cherchent à imaginer une couverture universelle du risque à s'intéresser d'urgence et en priorité à ces actifs non salariés qui sont la force vive de notre économie et recèlent des gisements considérables de développement pour notre pays.
|
- Date de Publication: 27/10/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Nathalie Chiche a été rapporteure au Conseil économique, social et environnemental. Elle est membre de l’Observatoire de l’ubérisation et fondatrice de la société Data Expert spécialisée dans l’accompagnement de ses clients pour faire face aux mutations du droit des données et de la mise en conformité avec le règlement général de la protection des données à caractère personnel.
La nouvelle réglementation en matière de protection des données personnelles au sein de l’Union européenne a été adoptée après coordination des « Cnil » nationales. Elle entrera en vigueur en 2018.
Le règlement sur la protection des données crée une nouvelle Europe des données. Est-ce une avancée pour les entreprises de l’Union ?
Nathalie Chiche. Oui, puisque l’Europe se dote enfin d’un outil de protection des données, contrairement aux États-Unis et à la Chine qui ont une logique de monétisation des données. La France et l’Europe restent pour l’instant une « colonie du numérique », ce qui explique l’ubérisation de notre économie.
Le règlement répond à un état de fait : les Gafa ‒ Google, Apple, Facebook et Amazon ‒ et les nouveaux entrants, les Natu ‒ Netflix, Airbnb, Tesla et Uber ‒, sont devenus des géants dont le succès repose sur nos données personnelles avec une domination sans partage. Et la data est la première matière du numérique : d’ici 2020, il y aura cinquante milliards d’objets connectés. Or, aucun acteur européen majeur n’a pour l’instant émergé en raison de la diversité des régimes de réglementation au sein de l’Europe. Mettre un terme à cette fragmentation juridique crée une politique uniforme de protection des données des personnes physiques sur le territoire communautaire, à l’inverse de la politique actuelle américaine. À terme, deux régimes de protection des données émergeront : l’un plus protecteur en Europe, l’autre plus libéral aux États-Unis.
Le nouveau règlement est la clé de la réussite du secteur du digital pour les entreprises européenne car la transparence et la sécurité, piliers du règlement, seront source de confiance pour les citoyens européens
De quelle manière exactement ?
Pour le moment, la règle du « winner takes all » prime et bientôt nous n’aurons plus que des situations quasi monopolistiques : un seul moteur de recherche, une seule application de tchat, un seul site de e-commerce, etc. C’est la raison pour laquelle nous souffrons tellement de l’ubérisation ‒ ou de la « plateformisation » ‒ de notre économie. Après le 25 mai 2018, date d’entrée en vigueur du règlement, les Gafa et les Natu qui ciblent les consommateurs au sein de l’Union seront soumis aux mêmes règles que les entreprises établies sur le sol européen. Ainsi, une totale égalité de concurrence entre tous les acteurs du numérique sera instaurée.
Si les entreprises sortent renforcées de cette protection accordée à la valeur « donnée », elles doivent instaurer elles-mêmes de nouvelles règles internes. De quoi s’agit-il ?
Le nouveau règlement européen, d’application directe, simplifie les formalités relatives à la gestion des données personnelles. Au moment où il entrera en vigueur, les formalités préalables auprès de la Cnil seront supprimées et remplacées dans la majorité des situations par la tenue obligatoire d’un registre interne aux entreprises. Le new deal du règlement, c’est plus donc de responsabilité (principe d’accountability) en échange d’une simplification des formalités.
En outre, le responsable de traitement sera tenu de nommer un data protection officer (DPO). S’il peut être assimilable à un correspondant informatique et libertés (Cil), le DPO est en réalité bien plus que cela. Au-delà d’un simple correspondant entre l’entreprise et la Cnil, le DPO est responsable du contrôle de la protection de la data. Dès la conception des projets digitaux, ce spécialiste sera en charge de la politique de protection des données personnelles. C’est la notion de privacy by design qui va prendre de l’ampleur dans les prochaines années.
Peut-on parler d’une sorte de renversement de la charge de la preuve ?
Exactement, puisqu’avec l’abrogation de la directive 95/46/CE au profit du nouveau règlement, ce ne sont plus les Cnil nationales qui seront chargées de vérifier la conformité du traitement des données à la loi mais aux entreprises elles-mêmes de prouver que leurs traitements sont conformes au règlement en cas de contrôle du régulateur. Chaque entreprise va devenir une petite Cnil, sans avoir les pouvoirs de sanction de celle-ci bien entendu !
Que se passera-t-il en cas de violation du règlement ?
La sanction est très dissuasive : l’entreprise est susceptible d’être condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à vingt millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial. Cette arme de dissuasion massive n’a rien à voir avec les faibles pouvoirs coercitifs actuels des Cnil nationales. Dorénavant, les géants du Web devront y réfléchir à deux fois avant de lancer un projet susceptible de violer le nouveau règlement.
Toutes les entreprises sont-elles concernées ?
Les sociétés qui récoltent et utilisent la data – toutes aujourd’hui ! –, doivent commencer par procéder à un audit dès que possible. Ensuite, elles doivent mettre en place des outils de protection, grâce au DPO notamment. Pour le moment, le règlement n’a pas précisé quelle était la taille des entreprises concernées.
À terme, le respect des bonnes pratiques en matière de protection des données et du respect de la vie privée constitueront un avantage compétitif pour toute entreprise et un marqueur certain pour sa réputation, même si la mise en conformité avec le règlement peut être ressenti comme contraignante au départ.
|
- Date de Publication: 29/08/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Par Grégoire Leclercq (FEDAE, Observatoire de l'Ubérisation), et Morgane L'Hostis (PopMyDay, Observatoire de l'Ubérisation)
La mise en redressement judiciaire de Take Eat Easy, célèbre startup Belge de la « Food Tech », a fait naître à la faveur de l’été une polémique de fond sur l’ubérisation.
Chacun a voulu donner sa version des faits, chaque partie a tenté d’expliquer ce qu’elle y perdait, comment elle en était arrivée là, chaque expert ou commentateur en croisade contre l’ubérisation y a vu « l’exemple que tout ceci était voué à l’échec ». Le point culminant du débat a été atteint lorsque, en réaction au billet de Chloé Roose (cofondatrice de la startup) intitulé « Les mots justes pour vous dire au revoir », une restauratrice s’est exprimée dans un texte intitulé « Les mots justes pour te dire merde ». Quelques jours après, Deliveroo, un de ces grands concurrents, levait 275 millions de dollars.
La polémique est passée (ou du moins perd de sa violence initiale), et il est grand temps de tirer quelques enseignements de cette histoire. D’abord parce que c’est la première occurrence de ce type impliquant un nombre conséquent d’acteurs indépendants, et ensuite parce que c’est l’occasion inespérée de faire évoluer les modèles pour prendre en compte des cas nouveaux.
Take Eat Easy a-t-elle bien géré ?
La première question à se poser est évidemment celle de la gestion de TEE. Quelques chiffres : 160 salariés, 20 villes déployées, 3200 restaurants Fournisseurs de repas, 350,000 clients, 1 millions de commandes depuis la création. Comme l’explique très bien le fondateur, le business est assez simple : sur chaque commande, TEE facture au restaurant une commission de 25-30%, et une livraison des frais de 2,5 € au client. Avec ce revenu de 10 € de chiffre d'affaires net par commande, TEE doit alors payer le coursier à vélo.
Mais la commission prise au restaurant est globalement fixée par le marché, le panier moyen évolue peu, et les frais de livraison facturés au client final sont là encore dictés par le marché. Il reste donc un seul levier pour rendre les choses équilibrées : les coûts de livraison, et donc très logiquement la capacité d’un coursier à livrer pour un prix faible. Et c’est là que le bât blesse car :
- un coursier espère gagner au minimum 15 € / heure sinon il se désabonne et change de plateforme (donc TEE lui garantissait 17€ par heure travaillée)
- mais il est difficile en phase de montée en puissance d’assurer 1,5 livraison / coursier / heure, surtout sur un secteur large
- donc une sollicitation des coursiers plus faible implique que TEE perd de l’argent dans l’exercice opérationnel (et en perd aussi beaucoup en marketing et en publicité).
On voit bien apparaître le dilemme cruel de cette histoire :
- soit vous payez le coursier à la course plutôt qu’à l’heure engagée et vous pouvez espérer être rentable, mais vous avez peu de chance que les coursiers acceptent de travailler pour 10€ la course sans revenu horaire minimal
- soit vous payez le coursier à l’heure engagée et vous perdez de l’argent tant que votre zone de livraison n’est pas saturée, et vous espérez que les fonds et autres actionnaires sauront patienter jusqu’à l’équilibrage de la zone… Ce ne fut pas le cas pour TEE.
Les livreurs sont-ils désavantagés ?
La question des livreurs est évidemment au centre de la polémique, alimentée par quelques va-t-en-guerre (qui sont rarement livreurs eux-mêmes et qui ne cachent pas leur idéologie), et qui se battent désormais nuit et jour pour la mort de ce modèle.
Leur principaux arguments sont sensiblement toujours les mêmes : les livreurs ne vont plus pouvoir exercer immédiatement, ils ont perdu de l’argent, ils ne vont rien percevoir pour la perte d'activité, ils étaient en situation d’emploi salarié parce qu’ils portaient l'uniforme de l'entreprise, ils devraient être au chômage et bénéficier d’un Plan Social. Bref, ils se sont fait avoir car ils ont travaillé et
- Ils n’ont pas été payés pour la totalité de leur travail
- Ils n’ont pas la protection sociale qui devrait correspondre à leur situation
Mais cette position est évidemment une position théorique et idéologique, déconnectée des réalités de terrain. Et il est bon de rappeler quelques réalités :
- TEE n’était pas rentable avec un modèle où l'explosion de la foodtech entraine l’explosion des couts d'acquisition et de fidélisation VS des commissions trop faibles pour le livreur. Dans ces conditions concrètes de marché, il était évidemment impossible pour TEE comme pour n’importe quelle autre entreprise de salarier du personnel pour la livraison (seules 160 personnes sont salariées de TEE à ce jour).
- Concernant les livreurs, ils sont presque tous repris chez Deliveroo, Foodora, Stuart, preuve que l'ubérisation doit passer par le "multiplateforme".
- Les livreurs à vélo de Take Eat Easy Belgique seront payés pour le travail fourni entre le 1er et le 25 juillet car ils facturaient leur prestation à la Smart (la société mutuelle pour artistes), un organisme payeur qui fournit une protection sociale aux travailleurs freelance. Au total, cette dernière leur versera quelque 340.000 euros en salaires impayés de juillet, et devient donc elle-même créancière de Take Eat Easy. Un modèle inégalé en France, peut-être à copier.
Enfin, la question de la requalification potentielle en contrat de travail de ces coursiers se pose désormais. Les obstacles sont légion, à commencer par le calendrier hasardeux (personne ne tente d’action en justice tant que la start-up paye, considérant donc que la situation juridique est correcte, mais dès la faillite engagée, les intéressés estiment que la situation juridique ne convient plus…)
Les restaurateurs dans tout ça ?
Vue la taille de la commission perçue chez le restaurateur par TEE, il est à peu près évident que toute la marge passe dans la livraison. (1/3 de matières premières, 1/3 de main d’œuvre, et 1/3 de marge, comme l’explique la restauratrice citée en introduction). Le restaurateur ne le fait donc pas vraiment pour gagner plus d’argent mais pour gagner en visibilité et atteindre une clientèle au delà de la clientèle d’ultra-proximité. C’est le même enjeu pour tous les acteurs « tradi » impactés par l’ubérisation (hôtels, coiffeurs, consultants, pressings, déménageurs)…
Le modèle alternatif est celui d’AlloResto : le coût de la livraison pèse sur le restaurant qui doit salarier ses livreurs et superviser la logistique de livraison ; l’apport du modèle TEE est double :
- Il fait économiser ce coût salarial
- Il est aussi technologique avec un dispatch des commandes qui permet mutualiser la flotte de livreurs entre tous les restaurants
- Il optimise les trajets pour au final servir au mieux les intérêts du consommateur final qui voit son délai de livraison diminuer
- Il apporte un gage de qualité : être sur TEE, c’est faire partie des restaurants branchés du moment
- Il qualifie la mise en avant : la photo de la carte est faite par TEE qui connaît mieux que le restaurant comment « apater » le consommateur final
Le modèle TEE donnera finalement naissance à un nouveau modèle pour les restaurants : en plus de leur salle, ils pourront développer une cuisine sans service uniquement dédiée aux plateformes. C’est le paroxysme de la digitalisation de l’économie. Les modèles anciens reposaient en grande partie sur l’emplacement et le passage ; les modèles nouveaux reposeront sur une visibilité online et les frais de structure (loyer ou main d’œuvre) diminueront significativement (un emplacement de zone 2 suffira, les serveurs seront inutiles…)
La food tech est-elle morte ? L’ubérisation est-elle condamnée ?
Certes, cet échec est douloureux pour de nombreux acteurs fragiles financièrement (petits restaurants, coursiers à vélo), mais il faut aller plus loin. La question de fond qu’il faut se poser touche plus à l’avenir de ce modèle de façon générale qu’à l’échec relatif et finalement assez circonscrit d’une startup parmi d’autres.
Quelle position de l’entrepreneur face aux nécessités de l’hyper croissance, voulue par le marché de l’uber-économie, par les fonds et par le modèle économique à marge faible ?
Quel choix raisonnable entre salariat et travail indépendant pour réaliser des missions parfois connexes au « core business » ? La déroute de Homejoy a notamment fait bouger les lignes chez les créateurs qui redoutent le risque juridique…
Quelle évolution du droit et de la doctrine en matière de requalification en contrat de travail ?
Quelle place pour la plateforme et sa responsabilité sociale à l’égard des travailleurs indépendants (livreur, coiffeur…) surtout quand la dépendance économique est forte ?
Quelle répartition de la réussite : les livreurs auraient-ils perçus quelque chose si TEE avait réussi et avait pu « partager » ses bénéfices ?
L’Uberisation est-elle condamnée ? La réponse reviendra au consommateur final. Dans un monde où tout s’accélère, où notre mobile devient une télécommande de vie qui permet de faire venir à soit toutes sortes de biens et de services dans un délai de temps de plus en plus réduit, les acteurs traditionnels devront in fine intégrer une part de technologie pour répondre à cette nouvelle exigence de consommation. Le modèle TEE/Deliveroo semblait être le seul modèle économiquement viable pour satisfaire cette demande sans que le surcoût ne devienne dissuasif pour le consommateur final. D’autres modèles voient le jour, intégrant une part de salariat (Frichi salarie ses livreurs mais assure ses marges arrière en préparant lui même ses plats) : affaire à suivre donc. Une chose est sûre, cet échec tout comme celui de Homejoy l’an dernier, est une gageure de plus pour tous les entrepreneurs qui se lancent sur ce type de modèle et qui devront densifier leur argumentaire pour convaincre de la pérennité économique du modèle.
Sources
|
- Date de Publication: 25/05/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Delphine Nouvian co-fondatrice de www.trouvetoncommercial.com a derrière elle 18 ans d’expérience professionnelle en marketing et innovation et la création de deux cabinets de conseil. Elle a décidé d'utiliser cette expérience acquise autour des pratiques commerciales innovantes pour aider concrètement les TPE PME à développer leur activité en leur proposant outil permettant de démultiplier leur force de frappe commerciale.
Le commercial : un terreau fertile pour l’uberisation
Malgré l’existence du statut d’agent commercial depuis la fin du 19ème siècle, les entreprises ont souvent privilégié les forces de vente internes ; généralement par souci de simplicité et surtout de confidentialité. En période de croissance ce modèle n’est pas remis en question : le commercial représente un coût indirect pour l’entreprise et il ne devient rentable que lorsqu’il couvre, à minima, son fixe chargé, avec la marge générée sur les ventes.
Les périodes d’instabilité économique de la fin du vingtième siècle ont amené les entreprises à remettre en question le modèle unique de force de vente « interne » et opter pour l’externalisation de leur force commerciale comme un nouveau mode d’organisation efficace, permettant de développer le chiffre d'affaire grâce à plus de flexibilité. Longtemps considéré comme un coût indirect, la fonction commerciale est devenue un coût direct, adaptable aux pics et aux creux d’activité de l’entreprise.
Ce phénomène s’est amplifié avec le développement du numérique, avec l’apparition des premières plateforme de mise en relation entre des entreprises et des professionnels de la vente : principalement des agents commerciaux.
Du commercial traditionnel à une forme plus inédite
Ces statuts traditionnels - salariés ou mandataires indépendants - sont aujourd’hui concurrencés par l’arrivée de nouveaux acteurs plus inédits, qui n’ont pas toujours de formation commerciale mais disposent d’autres atouts : un réseau – acquis via la sphère professionnelle ou privée – la connaissance d’un secteur, d’une profession, d’une communauté ou d’une région qu’ils peuvent mettre à disposition des entreprises, contre rémunération, afin de leur permettre de se développer à moindre coût.
Qui sont ces acteurs ? Ce sont des particuliers, des indépendants, des auto-entrepreneurs, des étudiants, des seniors, des demandeurs d'emploi,… qui souhaitent compléter leurs revenus, tester leur appétence au commerce, développer leur employabilité ainsi que leurs expériences.
Les rencontres entre les entreprises et ces citoyens lambda qui possèdent les compétences ou connaissances qu’elles recherchent sont aujourd’hui rendues possibles par des plateformes de mises en relation, qui facilitent et démocratisent l’accès à des forces commerciales qualifiées grâce à des processus de « matching » intelligent entre annonces et profils.
Des avantages évidents pour les petites entreprises
Embaucher un commercial représente un investissement, voire parfois un pari, pour une entreprise. Le Turn over est de plus en plus fort et une fois formés les bons commerciaux sont souvent débauchés par la concurrence.
Recruter un premier ou nouveau commercial, c’est souvent pour attaquer une nouvelle cible, une nouvelle région… Comment s’assurer de l’opportunité que représente ce nouveau marché avant de recruter et alourdir son compte de résultat avec des frais de structure et des coûts salariaux supplémentaires sans aucune idée de ROI ?
Une solution : faire appel à une ressource externe pour mieux appréhender son marché. Ce n’est plus la pure compétence commerciale que l’entreprise vient chercher à ce stade, mais bien les connaissances qui lui permettront d’avancer vite et à moindre coût.
Cela permet de recentrer les commerciaux internes sur les phases de vente, telles que la négociation et le closing, qui nécessite des compétences plus pointues, et de transférer les phases amont d’ambassade et de prospection à des tiers parfois plus légitimes et pertinents sur les cibles identifiées. Le caractère d’instantanéité est également un atout vis à vis des cabinets de recrutement ou des agences de placement de force de vente supplétive.
Vers une généralisation à tous les entreprises
Si les premiers utilisateurs de ces plateformes sont les petites et les jeunes entreprises, toujours à la recherche de bons plans, de flexibilité et de personnalisation, les entreprises plus traditionnelles font leur apparition. Ainsi certaines entreprises comme les compagnies d’assurance, les agences immobilières, les entreprises du bâtiment, … recherchent des nouveaux outils pour faciliter le développement de leurs réseaux.
Ces nouvelles plateformes sont en passe de changer la vision que l’on a sur la fonction commerciale. Ces métiers encore souvent mal perçus et surtout « mal vendus » dans les écoles sont pourtant indispensables car pas de commercial, implique pas de commandes, et donc pas de chiffre d’affaires !
|
- Date de Publication: 20/05/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Grégoire Leclercq est président de la FEDAE, cofondateur de l’Observatoire de l’Ubérisation et dirigeant d’entreprise. Cette tribune a été publiée le 19 mai sur la Tribune et sur Le Nouvel Economiste.
Chère URSSAF,
Le dernier rebondissement en date dans la grande affaire Uber est donc votre arrivée parmi les protagonistes. Vous portez à votre tour le fer contre le grand méchant américain, car d’après vous, il doit payer les cotisations de Sécurité sociale et les allocations familiales de ses chauffeurs, dont vous prétendez qu’ils sont en fait des salariés déguisés.
Vous le savez bien : en agissant ainsi, vous rejoignez la grande cohorte grincheuse de tous ceux qui s’opposent à Uber et à son modèle. Après le gouvernement, les taxis traditionnels, certains parlementaires, les syndicalistes, les manifestants de #NuitDebout (qui rentrent quand même chez eux en Uber parce que c’est plus pratique), voici le dernier adversaire d’Uber.
Il faut dire que les analystes attendaient depuis longtemps cette estocade et que les pronostics sur la requalification des chauffeurs allaient bon train. Après le cas américain et la class action avortée en Californie, il fallait bien que, sur le vieux continent, Uber soit en prise aux mêmes problèmes. Bingo ! Vous n’avez fait mentir personne, pas même Uber qui a du provisionner ce qu’il faut comme frais juridiques pour mener ce nouveau combat.
Mais il ne faut pas s’y tromper : votre combat dépasse largement le cas Uber. Et pas seulement parce que l’ensemble de l’économie de plateformes est suspendue aux décisions qui seront prises dans cette bataille. Derrière cette confrontation se cache en effet une question beaucoup plus ample : pourrons-nous faire perdurer notre modèle salarial dans un monde numérique et désintermédié ?
Votre combat est juridique, économique, culturel, social
Oui, votre combat est juridique et, de surcroit, loin d’être évident. D’une part parce qu’Uber (de même que toutes les autres plateformes de VTC d’ailleurs) n'impose pas de clause d'exclusivité à ses chauffeurs, qui travaillent ainsi très souvent pour deux ou trois plateformes. D’autre part parce qu’ils ont une liberté totale dans le choix de leurs horaires, choisissant de se connecter ou de se déconnecter à l’heure de leur choix. Enfin, parce qu’il n’existe en réalité pas de vraie dépendance géographique, les chauffeurs n’étant liés à aucun lieu de travail fixe ni même approximatif.
Votre combat est ensuite économique : les plateformes numériques fondent leur modèle sur le recours aux indépendants, et calculent ainsi leurs mages en fonction des coûts liés à ce mode de collaboration. Vouloir les soumettre aux charges salariales et patronales d’un modèle dépassé est comme les vouer à disparaître sur-le-champ. Car aucune d’entre elles ne transformera les indépendants en salariés, aucune d’entre elles ne pourra recréer de l’emploi dans ces conditions ! Et donc de l’emploi sera détruit par cette procédure… Economiquement, vous avez tout faux !
Votre combat est bien sûr culturel : entre la vision du travailleur d'hier lié pour longtemps à un seul employeur et l’autoentrepreneur de demain partageant son temps entre plusieurs entreprises, il y a un gouffre, un abime, un chemin irréconciliable. Vous ne comprenez pas cette nouvelle économie : vous la rejetez presque parce qu’elle sort du modèle social maîtrisé où l’employeur paie les charges, l’employé exécute, et vous contrôlez et sanctionnez. Vous cherchez à faire rentrer dans le rang ceux qui veulent plus de liberté. Culturellement, vous avez tout faux !
Sur un plan social, il faut oser réfléchir à un autre modèle. Vous le voyez, vous le redoutez même : notre modèle social est à bout de souffle. La loi Travail piétine, les négociations sur les retraites ou les indemnités chômage se font au forceps, les entreprises ont toujours plus de mal à embaucher en CDI, la complexité de notre droit social effraie, les rapports et études qui demandent plus de souplesse et une remise en cause complète affluent… Bref, l’urgence est à trouver un autre modèle, en collaboration avec ces nouveaux acteurs. Mais vous vous cramponnez, vous refusez l’évidence. Socialement, vous avez tout faux !
Votre position idéale vous permet de proposer une solution durable !
Chère URSSAF, ne soyez pas extrémiste, ne soyez pas braquée : aidez-nous à écrire pour demain les règles de notre droit social. Votre position est idéale. Du haut de votre tour de contrôle, vous voyez mieux que personne arriver la révolution numérique, vous savez comment mieux comptabiliser les droits d’un actif, vous savez où mettre le curseur en matière de protection sociale, de recouvrement. Vous sauriez discuter avec les plateformes pour en faire des partenaires de confiance, tiers déclarants de leurs indépendants affiliés. Bref, d’un acteur qui châtie, devenez un acteur qui construit !
Si Uber et tous les autres peuvent contribuer à faire évoluer un Code du travail, c’est tant mieux ! A vous de vous en saisir et de proposer pour demain un modèle pérenne et intelligent ! Nous vous en serons tous reconnaissants !
|
- Date de Publication: 02/05/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Jean-Philippe Cunniet participe aux débats de l'Observatoire de l'Ubérisation par sa connaissance des nouvelles technologies pour le marketing. Après avoir dirigé travaillé dans de grands groupes à l’international et fondé 2 start-ups, Jean-Philippe conseille de nombreux dirigeants d’entreprises sur leur transformation digitale. Il intervient également dans des instituts de formation & de grandes écoles de commerce sur des modules de « technologies du marketing » et de « techno-social selling B2B.
L’internet des objets à fait une victime de la route : Bison futé ubérisé, après 40 ans de bons & loyaux services !
La transformation digitale de bison futé n’a pas eu lieu, et les policiers qui gèrent Bison Futé vont devoir être réaffectés par l’état et être transférés dans un autre service, après 40 ans de bons & loyaux services.
L’essor du GPS et des applications pour smartphones telles que Waze a eu le scalp du petit indien, car lorsqu’une organisation n’opère pas sa transformation digitale (ou son « auto-uberisation », elle disparait.
Dans notre « nouveau monde » fait de données et de capteurs électroniques embarqués dans nos smartphones, GPS et détecteurs de radars, les applications routières permettent (sans aucune intervention de la part du conducteur) de déduire que nous sommes arrêtés dans un bouchon lorsque un centaine de smartphone « roulant » à 80 km heures se mettent tout à coup, les uns après les autres, à réduire considérablement leur vitesse sans changer de trajectoires. Les données de vitesse de déplacement sont mesurées automatiquement par l’accéléromètre (un capteur électronique qui permet de connaitre les mouvements que nous faisons avec, nos téléphones), et la position géographique est mesurée par le GPS embarqué dans tous les smartphones actuels. Ainsi l’agrégation de l’ensemble des données de tous les smartphones de cette petite centaine d’automobilistes permet d’indiquer que nous sommes tous « à la queue leu leu » les uns derrières les autres sur une route à grande vitesse : c’est le bouchon !
La durée du bouchon est ensuite estimée en fonction du nombre de « smartphones sur roues » qui se sont arrêtés peu de temps avant vous. Comparez ces données avec les données historiques locales de circulation, et votre précision sera plus précise que tous les petits indiens sur le bord de la route.
Ajoutez à cela le fait que l’application demandera de « signaler » aux autres automobilistes les causes de l’arrêt et tous les utilisateurs d’une application routière connectée recevront la photographie des ouvriers en train de réparer la route 3 kilomètres plus loin sur la route. Dommage qu’on ne puisse pas utiliser la même application comme réseau social des « bouchonnés », et trouver un partenaire pour jouer aux échecs, échanger de bonnes blagues ou partager un repas. Quitte à attendre, autant attendre à plusieurs.
Les capteurs (GPS & accéléromètres) et les données (position, durée, vitesse) sont donc tout à fait suffisante pour remplacer un service d’analystes des conditions de circulation. C’est l’ubérisation de la sécurité routière, qui ne fait que commencer. En effet, les villes, les routes, l’infrastructure et les véhicules vont également être connectés pour – mieux encore – nous informer et nous aider à circuler, jusqu’à conduire à notre place.
A sa création, l’application Waze (qui appartient désormais à Google), a même « dessiné la carte des routes » de son pays d’origine (Israel) sans l’intervention d’aucun cartographe, puisque les déplacements des véhicules (transportant les smartphones connectés) « dessinaient » eux-mêmes le réseau routier du pays pour Waze, selon un principe simple : « Si suffisament de smartphone roulent à 80 kilomètres heures selon un chemin précis, c’est probablement qu’il doit y avoir une route ! ».
CQFD.
A l’avenir, ce sera un plaisir de moins pour ceux qui aiment conduire (le plaisir de la conduite), mais pour tant d’autres, ce sera des vies sauvées. Dans le premier cas, on sait ce que l’on perd. Dans l’autre cas, on ne saura pas ce que l’on vient de gagner (éviter un accident). En tout cas, en ce qui me concerne, la voiture autonome va me libérer d’une corvée en augmentant mon temps libre.
Merci l’internet des objets !
|
- Date de Publication: 29/04/2016
- Catégories:
- Secteur(s)) impacté(s):
Description
Par Mehdi Benchoufi (président du Club Jade) et Nathalie Chiche (membre de l’Observatoire de l’ubérisation)
La « Blockchain » est la promesse technologique du moment, attendue et annoncée comme une réorganisation complète du paysage de l’Internet.
Rappelons qu’il s’agit d’un protocole assurant l’échange d’informations entre pairs, sans intermédiaire, l’ensemble du réseau étant garant de l’intégrité des échanges par le biais d’un système de validation cryptographique complexe ; tous les utilisateurs détiennent en effet une copie infalsifiable des échanges, une sorte de grand livre des transactions appelé « ledger ».
Cette technologie est révolutionnaire car elle instaure d’emblée la confiance dans le réseau, sans dépendre d’une autorité centrale.
Dans ce contexte, la Blockchain donne naissance à de nouvelles formes d’organisation d’associations, d’entreprises, totalement décentralisées, qui prendraient la forme dite DAO, (« Decentralized Autonomous Organization »).
La Blockchain offre désormais une alternative entre une gestion étatisée des noms de domaines DNS [« Domaine Name System », l’annuaire d’Internet qui convertit les adresses des sites en une série de chiffres, l’adresse IP], encore sous la férule des Etats-Unis, et une gestion prétendument étendue à la société civile.
Enjeu géopolitique majeur
En à peine plus de vingt ans, Internet est en effet devenu un enjeu géopolitique majeur. Depuis toujours, les Etats-Unis, convaincus d’avoir une responsabilité historique dans le fonctionnement et le développement d’Internet, ont orienté sa gouvernance selon leurs intérêts. Ils ont placé une association de droit privé californien, l’Icann, au centre du dispositif d’adressage et de nommage : allocation des adresses IP et gestion des noms de domaines ressources assurée par le DNS.
Le passage au WorldWideWeb a renforcé durablement la position de grands acteurs privés, principalement américains, qui consolident leur place en récoltant et croisant les données personnelles dont ils disposent, sans que les internautes-consommateurs en aient nécessairement conscience. Les Etats-Unis reprennent là ce qu’ils ont concédé ici : l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann) [la société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet] dépend d’ailleurs encore directement du département du commerce américain.
La Déclaration de Tunis, lors du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) en 2005, n’avait fait qu’acter un état de fait, en affirmant qu’acteurs privés, entreprises et sociétés civiles sont, autant que les Etats et les organisations internationales, légitimes à réguler l’Internet. Même si le Web est un bien commun, des divergences entre les protagonistes sur les contours et le rôle de la société civile persistaient.
Dix ans après, Internet reste le carrefour d’enjeux critiques économiques et géopolitiques, l’enceinte où se lient et s’opposent des rapports de force de dimension globale, un laboratoire de conception de règles de gouvernances d’échelle mondiale.
Renfort de la société civile
Mais avec les révélations d’Edward Snowden en 2013 relatives aux écoutes de masse réalisées, la confiance des utilisateurs-citoyens a été définitivement altérée et a porté un coup fatal à la suprématie des Etats-Unis sur l’Internet. La technologie Blockchain vient assurément en renfort de la société civile, là où les gouvernements n’ont pas concrètement eu les moyens d’assurer le respect de leurs normes dans le cyberespace.
Précisons que la Blockchain ne concerne pas uniquement les transferts de monnaies sans intermédiaires tel le bitcoin, elle est parfaitement générique et assure tous types de services : des actes notariaux sans notaire, une mise en relation entre taxis et usagers sans Uber ou opérateur centraux, un registre de cadastre infalsifiable, conçu par exemple au Honduras, pour éviter les fraudes.
La gestion des DNS par l’Icann est structurellement liée à la gestion d’une ressource rare, le nom de domaine, et à la nécessité d’en certifier l’authenticité et l’unicité. Or, la Blockchain propose une nouvelle gestion décentralisée et sûre d’un tel dispositif avec l’apparition il y a quelques années, des extensions «. bit », des « top-level domain », tiers au DNS, système aujourd’hui dominant. Les web-services «. bit » sont servis via une infrastructure bâtie sur une Blockchain appelée « Namecoin ».
Cette technologie permet une gestion robuste, sûre et parfaitement décentralisée des URL et concrétise la possibilité de soustraire la gouvernance de l’Internet à une autorité centrale.
Sécurité et fiabilité
Même s’il existait déjà des systèmes de gestion des URL alternatifs au DNS tels que Yeti, OpenNIC ou OpenRoot, la Blockchain offre la possibilité historique de faire fi de tous les tiers tout en garantissant un haut niveau de sécurité et de fiabilité.
La technologie Blockchain redistribue la gouvernance de l’Internet et ouvre une troisième voie au diktat de la politique américaine, en dotant les sociétés civiles de nouveaux modèles de gouvernance, plus horizontaux, ouverts, transparents, inclusifs. Elle fait figure de laboratoire de gouvernance d’enjeux globaux à l’échelle mondiale.
Il ne nous faut pas manquer ce tournant, comme naguère nous avions dédaigné les enjeux de gouvernance de l’Internet, les abandonnant ainsi aux Etats-Unis.
Avec une communauté de plus de deux milliards d’individus qui contribuent à façonner l’Internet en dessinant de nouvelles formes d’organisation telles que la Blockchain, la société civile s’érige en partenaire responsable de la gouvernance de l’Internet. Ce rôle ne peut plus être éludé, sauf à accentuer les frustrations.
Nathalie Chiche est rapporteure de l’étude du Conseil économique social et environnemental « Internet : pour une gouvernance ouverte et équitable ».
Mehdi Benchoufi (Président du Club Jade) et Nathalie Chiche (Membre de l’Observatoire de l’ubérisation)
|